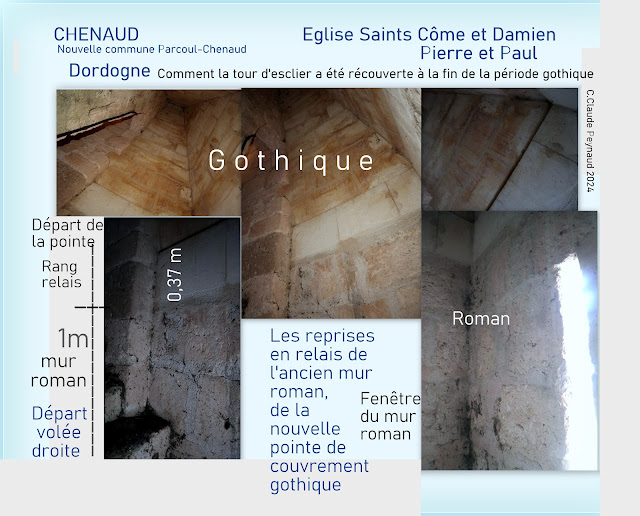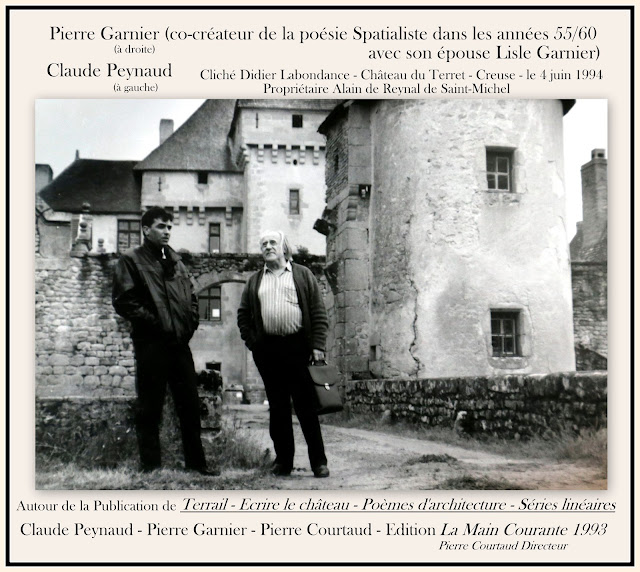La Tour : un mode architectural français pour la guerre et pour la paix, du XIII° au XVI° siècles. Un exemple à l'Est du département de la Charente.
Iconologie - Un couvercle de sarcophage mérovingien - une corniche de l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau (Charente) - Archéologie médiévale.
http://coureur2.blogspot.fr/2012/01/perret-freres-le-clocher-des-freres_10.html
Avec un détour par le Land-Art pour fêter la nouvelle année 2024 en article inaugural
Commune de La Genétouze (Cressac et La Genétouze)
Monsieur Michel Marty, maire de la commune
Madame Valérie Poumeyrau, Secrétaire de Mairie,
Monsieur Raphaël Flandrin, technicien des services de la Mairie,
Monsieur le Révérend-Père Bernard Houffet, curé de la Paroisse
Mesdames les secrétaires de la Mairie annexe de Saint-Aulaye Puymangou
Monsieur Jean-Louis Mercadet descendant direct de la famille Frichou qui donna plusieurs maires à la commune de La Genétouze, descendants des Ecossais venus s'installer sur les terres de La Genétouze à la fin du XVII° siècle au hameau de La Maurine (Frichou La Maurine) eux mêmes descendants d'une branche cadette des ducs d'Hamilton, avec le titre de marquis.
Une généalogie historique de cette famille est donnée par l'instituteur David aux pages 108 et 116 de son ouvrage sur La Genétouze publié en 1909.
Madame Colette Tardat, professeur en retraite, historienne d'art, élève et amie de Monsieur le Professeur Jacques Lacoste de l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'art roman du Sud-Ouest de la France et du Nord de l'Espagne. Madame Tardat et son mari sont à l'origine de la réouverture au public de la chapelle des Templiers de Cressac. Madame Colette Tardat anime les visites depuis plus de quinze ans et continue actuellement. Ce sont ses propres approches et analyses qui sont utilisées par de nouvelles bénévoles qui se greffent sur l'action de Madame Tardat.
Monsieur Yves-Michel Foucaud pour une série de documents relatifs à la Commune.
Monsieur Roland Body agriculteur propriétaire à Cressac, retraité. pour des informations orales sur l'état architectural de la chapelle de Cressac avant la suppression du clocher en avril ou mai 1953. Monsieur Body ne possède pas de clichés anciens ciblés sur l'architecture de la chapelle.
Madame Pénélope Cartier : deux clichés intérieurs de la chapelle de Cressac, publiés sur le Net.
La famille Cogo, père, frère et fils, pour leurs autorisations à photographier et à publier mes clichés pris au village de Tournier dont ils sont propriétaires. Village qui fut le lieu de résidence de Lanza del Vasto et de sa communauté de l'Arche en Charente-Maritime. Monsieur Cogo père et frère m'ont également donné beaucoup d'informations inédites sur le quotidien de la communauté à Tournier et la personnalité "bien trempée" de Lanza del Vasto, en épisodes assez contrastés du message de douceur et de paix du poète. Les sites identifiés sont ceux donnés par Monsieur Cogo père. C'est dans ce village, dans un site admirable et bucolique à souhait, que Lanza del Vasto réalisa ses vitraux, pour l'église de La Génetouze dont je vous présente un compte rendu en fin de rédaction de l'étude archéologique des monuments de La Génetouze.
Commune de Parcoul-Chenaud
Monsieur Jean-Jacques Gendreau, maire de la commune,
Monsieur Joël Trufley, maire délégué sur le site de Chenaud,
Madame Nathalie Bruneau, Secrétaire de Mairie à Chenaud,
Madame Gina Schuster Directrice de la bibliothèque de Parcoul.
Messieurs les techniciens de la commune
Monsieur le Révérend-Père Philipe Doumenge, Curé de la Paroisse.
Madame Janie Piens, pour une somme documentaire sur l'église et sur la peinture que j'ai découverte lors de cette recherche, ainsi que pour des échanges d'avis éclairés.
Monsieur Stéphane Perry, pour un premier avis concordant avec ma relecture de la devise des armoiries de la Chaire.
Monsieur Eric Guilbaud, propriétaire des terrains au chevet de l'église sur les berges de la Dronne.
Madame Annie Duflot et son mari Marc Duflot, respectivement professeur d'Histoire et Ingénieur des Collectivité Locales, pour une première et spontanée participation à la recherche sur la peinture murale païenne de l'église que j'ai découverte lors de cette recherche.
Commune de Pillac
Monsieur Dominique Streiff, maire de la commune,
Monsieur le Révérend Père Benoît Lecomte, Doyen Sud-Charente
Madame Anne Lirio pour de premières informations sur l'église et premiers contacts.
Monsieur Benoit Le Grelle brocanteur "L'incontournable" à Bors-de-Montmoreau, pour avoir initié l'étude de l'église et les prises de contacts avec les autorités de tutelle et modalités d'interventions, ainsi que pour son aide très efficace et pertinente dans l'exercice des relevés des cotes pour la réalisation du synoptique de l'église. Qu'il en soit vivement remercié.
Monsieur Maxime Marcadier, charpentier, pour les informations qu'il m'a donné sur la charpente qu'il a refaite, la confirmation d'une nef reconstruite avec deux côtés d'inégales largeurs telle qu'elle figure sur le plan de mon relevé ici publié , et son sage conseil de ne pas monter sur la voûte de la nef refaite en plâtre en couche très fine. D'où le codage en "partie non renseignée" sur mon relevé en synoptique.
Monsieur le Révérend-Père Benoît Lecomte, Doyen du Sud-Charente.
Commune de Montignac-le-Coq
Monsieur Alain Desert, maire de la commune,
Monsieur le Révérend-Père Benoît Lecomte, Curé de la Paroisse.
Monsieur Jean-Marie Gillaiseau, ancien maire, pour des informations historiques sur le site.
Monsieur Gilles Prezat, employé communal, pour une assistance technique sur le site.
Monsieur Maxime Marcadier qui m'a hissé gracieusement et fort aimablement en deux fois avec tout mon matériel de relevé archéologique, en compagnie de Monsieur le Maire à l'initiative du projet (19 décembre 2024 et 25 janvier 2025), jusqu'à l'accès à la base de l'escalier en vis du clocher seulement accessible par une entrée de 50x80 cm à 5 mètres de hauteur sur la face sud-ouest de la tour de cloches, contre l'angle Est du contrefort. Monsieur Marcadier a utilisé une grande cage montée en benne sur un engin élévateur. Sans ce dispositif sécurisé les relevés eussent été impossibles. Que ces Messieurs soient vivement remerciés.
Commune de Saint-Laurent-de-Combes
Monsieur Christophe Damour, Maire de la commune,
Monsieur le Révérend-Père Benoît Lecomte, Doyen du Sud-Charente
Monsieur Pierre Péron, Guide-Conférencier à l'abbatiale de Brantôme, pour la journée
qu'il a consacrée à me faire visiter l'ensemble du dispositif, sans les grottes.
Monsieur Alain Ménager, Conseiller Municipal, et son épouse Nelly, propriétaires du terrain d'où s'élève le chevet de l'église.
Madame Véronique Delorme-Lewis et Monsieur Nicholas Lewis, pour la gestion des clés de l'église, leur courtoisie et leur disponibilité. Madame Delorme-Lewis est Conseillère Municipale.
Monsieur Gérard Giret, habitant de la commune, pour des informations historiques et
géographiques du site. Leur propriété, qui est l'ancien site militaire des contrôles aériens d'avant les radars, est exactement en bordure du chemin qui sépare l'Angoumois de la Saintonge et les communes de Saint-Laurent-des-Combes et de Saint-Martial.
Monsieur Jean-Claude Chaumet et son épouse Michèle, propriétaires du Petit Moulin à la queue de l'ancien étang de la commune, pour des informations historiques et géographiques.
Monsieur Jean-Pascal Pontéry propriétaire d'une maison au chevet de l'église, pour son autorisation à produire des photos de ses murs extérieurs en rapport avec l'histoire médiévale du site.
Pour les communes des autres monuments présentés sur cette page, je renvoie le lecteur aux remerciements qui figurent sur ces pages
Une fois n'est pas coutume, je donne en page de garde de cette étude deux extraits d'une publication de Gaston Bachelard Le nouvel esprit scientifique, Paris, 1934.
"Les rapports entre la théorie et l'expérience sont si étroits qu'aucune méthode, soit expérimentale, soit rationnelle, n'est assurée de garder sa valeur. On peut même aller plus loin: une méthode excellente finit par perdre sa fécondité si on ne renouvelle pas son objet".
p.14.
" Cette mobilité des saines méthodes doit être inscrite à la base même de toute psychologie de l'esprit scientifique car l'esprit scientifique est strictement contemporain de la méthode explicitée. Il ne faut rien confier aux habitudes quand on observe. La méthode fait corps avec son application. Même sur le plan de la pensée pure, la réflexion sur la méthode doit rester active. Comme le dit très bien M.Dupréel " une vérité démontrée demeure constamment soutenue non sur son évidence propre, mais sur sa démonstration".
p. 140.
Le secteur géographique sur trois départements au sud du bassin de la Tude aux environs de son confluent avec la Dronne
précis de la zone géographique 1 - La Commune de La Genétouze
Charente Maritime
L'essentiel de cette présentation historique de la commune de la Genétouze provient de "Monographies communales - Historique et Géographique sur la commune de La Genétouze (Charente Inférieure)". Par David (instituteur). Saintes 1909.
Pour une bibliographie utile à l'ensemble de cet article :
Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI° au XV° siècle. Edition de 1997.
Jean George et Alexis Guérin-Boutaud, Les églises romanes de l'ancien diocèse d'Angoulême. Paris, 1928.
Vincent Flipo, Mémento pratique d'archéologie française. Paris, 1930.
Jean George, Les églises de France - Charente. Paris 1933.
Louis Papy, Aunis et Saintonge. Paris, 1937.
Jean Secret, Les églises du Ribéracois. Périgueux, 1958.
Charles Connoué, Les églises de la Saintonge - Jonzac et ses environs - Le roman saintongeais en Gironde. Saintes, 1961, p. 72, 73.
André Mussat, Le style gothique de l'Ouest de la France (XII°-XIII° siècles) Paris, 1963.
Zodiaques (éditions) Itinéraires romans en Périgord. La Pierre qui Vire, 1977.
Eliane Vergnolle, L'art roman en France. Paris 1994/2003.
Eliane Vergnolle, "Passages muraux et escaliers : première expériences dans l'architecture du XI° siècle". Dans, Cahiers de Civilisation Médiévale. Centre d'Etudes Supérieures des Civilisation médiévale, Poitiers, Année 1989 - 32-125, p 43 à 60
Jean Flori, Aliénor d'Aquitaine - La reine insoumise. Paris, 2004.
Sylvie Ternet, Les églises romanes d'Angoumois - Bâtisseurs et modes de constructions en Angoumois roman - Deux volumes. Ouvrage publié grace au soutien du Conseil Général de Charente. Paris 2006.
Nicolas Reveyron, "Culture technique et architecture monumentale : analyse structurelle des types de contreforts dans l'architecture romane ". Dans, Actes du VI° Congrès international d'Archéologie Médiévale (1-5 octobre 1996, Dijon - Mont Beuvray - Chenôve - Le Creusot - Montbard). L'innovation technique au Moyen-Âge. Année 1998 - 6 - pp.211-218
Guy Penaud, Histoire des diocèses du Périgord et des évêques de Périgueux Sarlat - Préface de Monseigneur Michel Mouïsse Evêque de Périgueux et de Sarlat. Bergerac 2010;
Pour des présences contemporaines : Arnaud de Mareuil, Lanza del Vasto - Sa vie, son œuvre, son message. Paris, 1998.
Pour des mémoires de la culture locale et vernaculaire Revue poitevine et saintongeaise - Histoire - Archéologie - Beaux-Arts et Littérature - Revue mensuelle. : 7° année, cinq articles :
- un article de A.F.Lièvre, "La motte, les tours et les châteaux de Ganne", article publié dans le Tome VII, 7° année, n°77 du 15 mai 1890, p. 129 à 131.
- Quatre articles sous le même titre de J.-L.-M. Noguès, "Les mœurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis",
1 - 7°année, tome VII n°80, 15 août 1890, p. 230 à 247.
2 - 7° année, Tome VII n° 81, 15 septembre 1890, p. 265 à 277,
3 - 7° année, n° 82 du 15 octobre 1890, p. 299 à 314,
4 - 7° année, n° 83 du 15 novembre 1890, p. 324 à 338 avec cette très rare information sur l'emploi de la graisse humaine à fins thérapeutiques et esthétiques ainsi que contraceptives "C'était aussi un préservatif " (sic) (p.324). C'étaient les bourreaux qui tenaient négoces à prix d'or de ces prélèvements humains. Ceci n'étant qu'un épisode qui illustre les pouvoirs accordés aux prélèvements et restes humains (voire l'étonnante histoire des mains de gloire). D'une façon élargie à d'autres pratiques et usages de traditions elles constituent un second champ scientifique iconologique complémentaire aux apocryphes et texte bibliques. Pour un investissement de la zone historico-géographique sur laquelle je développe cette étude archéologique je propose une nouvelle référence bibliographique avec la très belle étude ethnographique de Robert Colle, Sorciers, sourciers et guérisseurs en Aunis et en Saintonge. La Rochelle, 1979. On peut mesurer l'importance que prennent dans le champ scientifique moderne ces recueils et ces études dont l'émergence la plus célèbre au XIX° siècle est celle des Légendes rustiques de George Sand avec les dessins de son fils Maurice élève de Delacroix, publiées en 1858. Ces recherches et recueils de mémoires qui ont investi l'ethnologie ou que l'ethnologie a investie ont depuis le XIX° siècle alimenté nombres d'articles publiés par les Sociétés Savantes. La publication la plus spectaculaire, la plus documentée d'un point de vue de l'iconographie chrétienne étant sans doute l'énorme et non moins somptueuse publication des éditions Mazenod : Maria-Christina Boerner, Angolus & diobolus - Anges diables et démons dans l'art chrétien occidental. Sous la direction de Rolf Tornan, avec la collaboration de Bruno Boerner, de Johann Ev. Afner, Thomas Rusner. Photographies d'Achim Berdnorz. Conception de Thomas Paffen. Paris 2015.
Hélas si le secteur de La Genétouze est riche en traditions écrites et orales inscrites dans la culture de ces régions frontalières des diocèses et des guerres du XII° siècle entre royaumes de France et d'Angleterre, entre Plantagenets et Capétiens se disputant l'Aquitaine, dont l'épisode le plus célèbre est lié à Aliénor d'Aquitaine, l'ornementation et donc l'iconographie parvenant jusqu'à nous reste très pauvre, tant sculptée que peinte.
La commune de la Genétouze est très étendue. Elle est le résultat de la réunion en 1790 de trois paroisses : Haut-Mont, Cressac et La Genétouze qui doit son nom au paysage de landes couvertes de genêts et de bois, cadre de son environnement principal. Une autre source donnée par Monsieur Yves-Michel Foucaud est celle d'un lien avec les Plantagenêts desquels dépendaient ces territoires au XII° siècle. Siècle de la construction admise des deux églises qui restent encore visibles : église ou chapelle Saint-Léonard à Cressac et église Saint--Antoine à La Génetouse, celle de Haut-Mont étant détruite depuis fort longtemps . Ces deux églises vont être le point de départ d'une étude qui a pour objet de poursuivre la recherche que j'ai entreprise sur le Bassin de La Tude en Sud Charente sur le passage de l'art roman à l'art gothique qui infiltre la région de façon très sinueuse, discrète aux très fortes résistances romanes d'autant plus que le gothique plantagenêt y a son mot à dire pendant la période romane du XII° siècle avant qu'on ne ressente les accents du gothique parisien, voire des courants languedociens du début du XIII° siècle.[A ce sujet voir la thèse de Marylise Ortiz, Les débuts de l'architecture religieuse gothique et l'introduction du gothique du Nord dans la diocèse d'Angoulême (fin XII°-Début XV° siècle) sous la direction de Jacques Lacoste. Université de Bordeaux 3, 2001].
Si des vecteurs architecturaux de la période romane sur ce bassin de la Tude franchissent les étapes de la formation admise de l'art roman par des héritages directs de la période carolingienne brutalement relayés par de premiers accents gothiques mis en chantiers à Poullignac sans véritable transition romane, d'autres vecteurs y sont néanmoins présents dont la découverte à partir de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Bors-de-Montmoreau d'une veine de chapelles de routes et d'escaliers romans à partir de Saint-Amant-de-Montmoreau en descendant au sud de la zone géographique jusqu'à Rioux-Martin à la rencontre de la construction d'une dépendance de l'abbaye de Fontevraud à la Haute Lande sur un secteur compris entre Médillac, Rioux-Martin et La Genétouze, sans que nous ne sachions rien de l'architecture de cette dépendance sinon une datation évaluée dans la seconde moitié du XII° siècle par les vestiges conservés par les agriculteurs propriétaires des terrains où s'implantait cette communauté mixte.
Et encore, pour l'intelligence du sujet je dois écarter la belle église de Médillac qui offre une singulière voûte en berceau continu et un accès haut à un escalier de clocher, par-dessus la corniche de la nef, ce qui définit une autre variante de l'art roman très présent dans le bassin de la Tude mais pour lequel il faudra ouvrir une autre page (Sylvie Ternet avance que ces berceaux continus sont plus caractéristiques des églises des Templiers. S.Ternet, op.cit. T.1, p.117).
Ces régions de genêts de la Double Saintongeaise sont pauvres, très pauvres et de petites chapelles de routes peuvent avoir fait office d'églises paroissiales alors que l'église de La Genétouze fut une plus grande église que celle que nous voyons actuellement, au moins par une nef plus importante prévue, avec des raffinements d'architecture qui surprennent pour une décoration ancienne qui reste pauvre, au moins dans l'état, jusqu'à un brutal et inattendu enrichissement par les vitraux de Lanza del Vasto au XX° siècle,
L'histoire médiévale de l'architecture de ce petit territoire est donc à construire et à mettre en lien avec d'autres et pour ma modeste part avec des outils d'investigations en archéologie du bâti, tels que je les ais élaborés et perfectionnés depuis 1986, d'où cette double citation de Gaston Bachelard que je produis en début de cette étude.
Des textes de légendes compensent cette pauvreté toute en contraste et le principal développé pour Cressac me semble par des détails d'architectures, comme les distributions en couloirs, être né entre les origines romanesque et l'esprit romantique éclos du XVIII° au XIX° siècle, depuis la naissance du roman picaresque avec La vie de Lazarillo de Tormes du milieu du XVI° siècle en Espagne suivi du Don Quichotte de Cervantes au XVII° siècle et enfin le basculement dans la littérature française du début du XVIII° siècle par le Gil Blas de Santillane et Le Diable Boiteux d'Alain-René Lesage avant le Mauprat de George Sand au XIX° siècle,
délaissant la veine française pré-romanesque du XVII° siècle par le roman psychologique à partir du Page Disgracié de Tristan L'Hermite à celle du roman précieux avec la Princesse de Clèves de Madame de La Fayette en passant dans le XVIII° siècle avec Manon Lescaut de l'Abbé Prévost.
Ce texte rapporté par l'instituteur David est un très beau morceau de littérature française à lire comme on lit les romans périgourdins de la veine de Jacquou le Croquant.. Un extrait est repris sur le cartel signalétique devant la chapelle de Cressac (ci dessous)
Je conserverai donc ce texte à sa place devant la chapelle, comme une construction littéraire qui aurait, pourquoi pas, une assise sur un site en tertre sur une crête de distribution des vallons en carrefour de routes, tel l'implantation d'un château de Motte contrôlant un site stratégique, voire aussi à fonction d'épicentre d'une petite économie agricole, détruit et remplacé par une chapelle de routes.
 |
Le dimanche qui suit le 6 novembre, jour de la Saint-Léonard, la chapelle et tout le village était
le site d'une importante fête (frairie) dont l'instituteur David nous
donne les détails : David, 1909, op.cit., p. 60 et 61.
"Des marchands et des jeux forains sont installés dans les rues du village, jusqu'au cinématographe nantais; dans un pré on lance des coqs et des tireurs
venus de loin, parfois même de la Ville-Lumière...chaque coups de fusil rapporte deux sous
à l'éleveur et, comme la distance est d'au moins 100 mètres, que les tireurs manquent d'adresse, par suite de libations ou de parties fines...les patients
résistent longtemps à la fusillade...
Je suis arrivé sur le champ de tir à 6 heures du soir, le 9 novembre 1908; j'estime à 1500 les personnes présentes...
les hommes avec leurs fusils au dos, ils ressemblaient à ces Vendéens de mon pays...
Les baraques regorgeaient de monde et dans la salle transformée en auberge 300 chasseurs au moins avec leurs armes s'apprêtaient à faire le bigage,
à échanger leurs fusils contre d'autres armes ou objets quelconques.
Plusieurs bals s'ouvrirent ensuite sous des tentes avec planchers
bien installés, entrée : 0 fr.75." |
Les monuments qui sont à l'origine de belles histoires et d'une part de rêve ont en eux l'essence même de leurs pérennité face aux hommes et à l'histoire.
Il faut absolument préserver ces contes, ces légendes voire faire revivre ces coutumes.
En allant plus avant dans ces recherches de l'âme populaire dont j'ai assez étendu le sujet avec la présentation des chapelles de routes et des croyances liées aux sources et aux fontaines miraculeuses associées, au sein même de la rédaction archéologique de mon article sur l'église de Bors-de- Montmoreau, aux approches ethnologiques et autres digressions, nous avons pu comprendre comment cette famille architecturale des chapelles de routes intimement liée à l'âme chrétienne et populaire des survivances païennes avait eu autant d'importance dans la transmission des usages, coutumes, patrimoine bâti et oralité des cultures loin des normalisations sèches, scolaires et de l'université.
Un article de Revue poitevine et Saintongeaise - Histoire - Archéologie - Beaux-Arts et Littérature - Revue mensuelle, intitulée "La motte, les tours et les châteaux de Ganne" (1890, op.cit, p. 129 à 131) nous ramène aux regards portés sur les usages et brigandages des seigneurs hobereaux, un retour vers des sources "picaresques à la française" : "Il y a dans la commune de Vivonne un petit fortin en terre qu'on appelle de Ganne. C'est un tertre circulaire, de quatre mètres de haut, entouré d'un fossé où s'égouttent les terrains alentours...Nous ne parlons de celle de Vivonne qu'à cause de son nom mentionné dès 1469 et qui a été chez nous appliqué à d'autres constructions anciennes, toutes en ruines... M. de Longuemar, a cru pouvoir rattacher ce nom de Ganne au mot latin "Ganea", que Du Cange, à l'en croire aurait ainsi défini : "Loca occulta subterranea et meretricia" ["Lieux souterrains cachés et bordels"], et il ajoute sûr de son fait : "Voilà donc la trace non équivoque de lieux de débauche anciens retrouvée dans cette contrée, débauches qui s'accomplissaient dans des lieux souterrains assez voisins des lieux habités"...[...]...Voilà bien des mauvais lieux, s'il est vrai que Ganne vienne de Ganea, et les vilains du moyen-âge nous paraitraient , dans ce cas avoir été singulièrement osés d'appeler ainsi la demeure de leurs maîtres".
Surpris par ces concordances des regards et des récits
et
fort de ce succès à travers la littérature vernaculaire publiée en articles de Sociétés Savantes,
continuant mes investigations, dans l'esprit de la même recherche que celle autour des chapelles de routes assez fréquemment accompagnées de leurs fontaines de guérison, mais cette fois-ci avec comme cible la chapelle dite église de Cressac sur son petit tertre pouvant évoquer un autre dispositif soit celui du site primitif d'une motte gardienne de mémoire, je rencontre un troisième texte, moins local, qu'il me plait pourtant de signaler au lecteur; une façon de lutter contre l'oubli et de savoir d'où nous venons. Il s'agit d'un texte sur 17 pages, signé J.-L.-M. Noguès, publié dans la 7°année, tome VII n°80 du 15 août 1890, p. 230 à 247. de la même Revue Poitevine et Saintongeaise (1890) qui , après avoir établi une liste des artistes poitevins ou ayant travaillé en Poitou, cède la place à un second article intitulé "Les mœurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis". VII - Le Merveilleux. Croyances et préjugés. : Faire planer sur un évènement , sur une circonstance quelconque, une influence surhumaine , mystérieuse, accorder à des actes ou a des moyens futiles ou vains une vertu extraordinaire, surnaturelle ; tel était le côté vraiment légendaire du caractère de nos bons aïeux. Ils avaient jusqu'à l'excès, le goût, la peur du merveilleux; ils en voyaient partout...Nous devons maintenant entrer dans le cœur du sujet.
On a voulu distinguer trois sortes de merveilleux : le religieux, l'allégorique, le fantastique..."
Chers lecteurs souffrez donc qu'avec le merveilleux de l'archéologie religieuse et de ses récits populaires entrés dans les outils scientifiques des Sociétés Savantes, par les églises de Cressac et de La Genétouse avant celles de Chenaud et de Pillac, que je poursuive le chemin de ma jolie fable pour vous ravir ou vous faire sourire,
comme il vous plaira ...
1. A : Cressac
Eglise Saint-Léonard sur la commune de La Genétouze
Pour des approches comparatives d'architectures et de sites entre les églises à nefs uniques, voûtées, sans transept et chevets plats du bassin de la Tude avec l'originalité de l'église ou chapelle - selon les appellations - Saint-Léonard à Cressac.
Nous pouvons introduire la méthode comparative avec les autres églises du bassin de la Tude par l'église de
Sérignac
et ensuite continuer en exposant les autres exemples.
L'église romane de Sérignac est voutée en trois travées en plein cintre sur doubleaux, au cœur du bassin de la Tude près de Chalais. La commune de Sérignac a été la première à avoir été intégrée à la communauté de communes de Chalais.
Synoptique de restitution à mettre en parallèle avec les relevés in situ de l'état actuel de l'église de Cressac. Les proportions sont déjà très différentes.
Sérignac
est la parente de celle de
La Ménècle
sur l'actuelle commune de Rouffiac - Sud-Charente - Bassin de la Tude.
Cadastre de 1838 par lequel nous voyons que l'église est complètement intégrée au village avec le cimetière en bord du seul axe de circulation qui provient d'un carrefour hors agglomération et sans chapelle de route. La chapelle de route la plus proche est celle de La Fontaine de Guérison au creux du vallon au bout de la piste au sud-est du village. Voire sur ce blog : Bors-de-Montmoreau - Eglise Notre-Dame - Une introduction aux chapelles de routes - Identification d'une chapelle romane ouverte aux mouvements de fermements des petits sanctuaires du XVII°s. - Charente et versants alpins français. https://coureur2.blogspot.com/2022/10/bors-de-montmoreau-eglise-notre-dame-un.html
La partie centrale de l'église s'étant effondrée il ne reste d'origine que les façades occidentale et orientale.
L'église était voûtée en plein cintre.
Le voûtement en berceau plein cintre sur ce type de monument, plus développé que Cressac, s'étend aux transformations intérieures en travées voûtées sur ogives, très vraisemblablement sous l'impulsion du gothique angevin, comme l'analyse André Mussat.
Sur ce registre nous pouvons avancer vers
MARTRON
L'église est reculée du bord de la route qui vient de Chalais. Une piste contourne en cul de sac la parcelle d'implantation de l'église entourée d'un cimetière, à l'écart du carrefour où il n'y a pas de chapelle de route.
Cette façade atypique avec son seul portail sous arcs articulés au caractère roman conservé n'est peut-être qu'un vestige ou une évolution de la façade romane qui accompagne les contreforts d'angles qui sont également différents de ceux du chevet qui pour leurs parts sont conformes à ceux rencontrés sur les édifices romans intérieurement voûtés en plein cintre ou sur travées d'ogives. Cette façade peut tout autant appartenir à la famille des façades sans divisions [
S.Ternet, 2006, op.cit., T.1, p. 150]
Sur la présentation plus bas des modèles produits dans le Dictionnaire Raisonné de Viollet le Duc nous pouvons repérer la figure 8.
Il y aurait donc sur le bassin de la Tude non pas deux mais trois systèmes de contreforts d'angles. Je reviendrai sur cette question après la présentation de l'église ou chapelle de Cressac
Puyfoucaud
En 1834 l'église n'est plus recensée comme bâtiment religieux. Elle est actuellement en ruine incorporée en bordure des
bâtiments agricoles de la ferme.
Sud-Charente - Ancien Diocèse de Périgueux - Bassin de la Tude
Eglise dans un domaine privé. L'architecture de cette église rejoint certaines caractéristiques architecturales de Martron.
Cette église était un prieuré dépendant de La Couronne
Marylise Ortiz, "L'abbaye Notre-Dame de La Couronne - Les parties médiévales". Dans, Société française d'archéologie - Congrès archéologique de France - Charente. Paris, 1999, p. 189 à 208.
Christian Taillard, " Les bâtiments monastiques de l'abbaye de La Couronne". Dans, Société française d'archéologie - Congrès archéologique de France - Charente. Paris, 1999, p. 209 à 216.
Marylise Ortiz, Les débuts de l'architecture religieuse gothique et l'introduction du gothique du Nord dans le diocèse d'Angoulême (fin XII° - début XV° siècle) Thèse pour l'obtention du doctorat de l'Université Michel de Montaigne, sous la direction de M. le professeur Jacques Lacoste. Université de Bordeaux III - Michel de Montaigne, 2000, 6 t, 581 p., 588 planches.
Marylise Ortiz, Christian Vernou, L'abbaye Notre-Dame de La Couronne - Charente. (non daté).
Pierre Pommarède, Richesses insoupçonnées - Tome III - Le Périgord des églises et des chapelles oubliées - Préface du cardinal Paul Poupard Président du Conseil Pontifical de la Culture. Photographies de Jacques Brachet. Périgueux 2007.
Voir François Tarda ....
(Pour une articulation avec les origines de la recherche sur la transition roman-gothique sur le bassin de la Tude, sur ce blog, nous retrouvons ces monuments sur la première page d'introduction à ce sujet qui est celle de l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau : Saint-Amant-de-Montmoreau, Sud-Charente - Des vestiges du Haut-Moyen Âge à la naissance du gothique sur les marches Périgord/Angoumois/Saintonge- une maison tour - Première Renaissance Française.
https://coureur2.blogspot.com/2021/07/saint-amant-de-montmoreau-sud-charente.html )
1. B : Cressac
Etude en cours de construction/rédaction
Etude en archéologie du bâti
Chapelle ou église Saint-Léonard
Un seul premier regard nous fait comprendre que cette église ou chapelle de Cressac n'appartient à aucune des deux familles à nef unique sans transept et chevet plat éclairé par des lancettes, présentes sur le bassin de la Tude
C'est encore une autre architecture originale. Mais quelle en est l'origine ?
L'enduit blanc qui va tant "déranger" la lecture archéologique de ce bâtiment pour l'étude est toutefois la reconstitution d'une certaine réalité des édifices médiévaux. Eliane Vergnolle le souligne et le précise "Au Moyen Âge, en effet, une église n'était pas terminée tant qu'elle n'était pas enduite et peinte. Les textes désignent cette opération sous le nom de "dealbatio"* qui suggère, sinon l'éclat du blanc pur, du moins une certaine clarté de ton, ce que confirment de nombreux vestiges." [E.Vergnolle, op.cit., 1994/2003, p. 140]. Nous garderons en mémoire cette citation de cette éminente spécialiste de l'art roman et médiéval en général, pour toutes les approches des églises déjà étudiées ou en devenir d'études. [*de-albô (inf albare; de albus) v blanchir, peindre, crépir.].
A ceci il faut ajouter les résultats de mes propres recherches en thèse doctorale de 3° cycle, soutenue en 2001, sur la polychromie architecturale - la première du genre - et les façades peintes de la fin du Moyen-Âge/Renaissance à nos jours dans le Sud-Ouest des Alpes. Recherche par laquelle j'avais été amené à chercher dans les provinces françaises où j'avais mis à jour des programmes peints historiés ou à thèmes iconographiques en frontispices et tympans peints associés ou non à des programmes sculptés. Dans d'autres pays autour de ce secteur de recherches ces ornements peints extérieurs, tant sur les édifices civils que religieux que militaires que temporaires et encore en ornements de fabriques de jardins ne sont pas rares, ces programmes extérieurs étant indépendants des programmes ornementaux intérieurs. Ces apports de programmes peints polychromes n'étant pas limités aux seules façades ou en sites sélectionnés (fenêtres, portes, frises, corniches, soubassements, cadrans solaires, etc...).
Sur ce blog le lecteur peut trouver les résultats de ces recherches :
Techniques et vocabulaires de l'art de la façade peinte
http://coureur2.blogspot.fr/2012/08/un-tour-dans-le-massif-central.html
Les Vecteurs Impériaux de la polychromie occidentale
http://coureur2.blogspot.fr/2012/06/philippines-les-Vecteurs-imperiaux-de.html
Le clocher des Frères Perret à Saint-Vaury
http://coureur2.blogspot.fr/2012/01/perret-freres-le-clocher-des-freres_10.html
Le Palais Princier de Monaco
http://coureur2.blogspot.fr/2012/09/palais-princier-de-Monaco-palais-of.html
Versailles - Monaco - Carnolès - Menton: présence de l'art français en Principauté de Monaco
http://coureur2.blogspot.fr/2012/09/versaillesmonaco-larchitecture.html
Primitifs Niçois - Les chapelles peintes des Alpes Maritimes
http://coureur2.blogspot.fr/2012/03/primitis-nicois-les-Chapelles-facades.html
Eglises du sud-ouest des Alpes A travers l'art de la polychromie architecturale
http://coureur2.blogspot.fr/2013/02/eglises-du-Sud-Ouest-des-alpes-alpes.html
Des cérémonies et des fêtes Autour de Saint-Nicolas de Monaco
http://coureur2.blogspot.fr/2013/09/des-cérémonies-et-des-fêtes-Autour-de.html
Langages de l'art contemporain - répétition, bifurcation, ...
http://coureur2.blogspot.fr/2013/09/repetition-ordinaire-bifurcation-art-du.html
La polychromie architecturale et l'art de la façade peinte (1° partie) - des édifices civils dans les Alpes-Maritimes
http://coureur2.blogspot.fr/2014/07/la-polychromie-architecturale-et-lart.html
Façades peintes - édifices civils du sud-ouest des Alpes - 2° partie - XX° siècle
http://coureur2.blogspot.fr/2015/01/facades-peintes-edifices-civils-du-sud.html
Aspects de l'évolution des seigneuries historiques de la Principauté de Monaco à travers quelques
exemples d'architectures polychromes ponctuelles.
http://coureur2.blogspot.fr/2016/01/aspects-de-levolution-des-seigneuries.html
L'entrée de la partie voûtée est marquée par une demi-colonne sur dosseret. Ce dispositif projette le voûtement plus avant sur l'espace intérieur que le second voûtement supporté par un pilastre plat à chapiteau également plat très peu saillant du pilastre, avant de finir de s'enfoncer dans le fond du sanctuaire avec un mur légèrement oblique qui achève ce jeu à partir d'une entrée resserrée, des volumes dilatés une fois la demi-colonne sur dosseret dépassée et rétrécie depuis le pilastre plat, pour finir en oblique contre le mur plat de fond alors que les murs extérieurs sont parfaitement alignés [peut-on voir ici une diffusion des idées de certains chevets de l'angoumois qui ont des absides intérieures semi circulaires pour des enveloppes extérieures carrées ? Voir S.Ternet, 2006, op.cit. T.1 p.126 - Nanclars, Bougneau] . C'est un système rare et extrêmement sophistiqué pour un si petit bâtiment. Et bien sûr cette recherche a une raison d'isolement et de claire distinction du sanctuaire voûté d'un vestibule ou porche sous charpente ou planchéiée bien que des culots soient à remarquer directement articulés avec le chapiteau des demi-colonnes Ouest. Cette dernière observation réorientant fermement vers un porche voûté sur nervures.
Cette apparente ou réelle continuité architecturale en deux temps peut faire partie d'un autre raffinement de cette architecture qui surprend, en relai architectural d'un support de nervures d'un porche directement positionnées dans la continuité, dans le prolongement du retrait du mur support des arcs de la voûte en berceau du sanctuaire proprement dit.
La première étape pour une approche restitutive du parti architectural d'origine c'est de rétablir la coexistence contemporaine des deux voûtements : Est en berceau sur doubleaux et Ouest sur nervures - en noir et hachures sur le relevé in situ - en prenant en compte le témoignage de Monsieur Roland Body d'un ancien clocher détruit en 1953, élevé sur une partie centrale du bâtiment, à deux mètres de haut environ précise encore Monsieur Roland Body.
Jusqu'ici, en ce qui concerne l'organisation intérieure de la partie orientale voûtée nous avons tous les marqueurs d'un édifice de la période romane ou romano-gothique, bien qu'atypique si on s'en réfère aux modèles directeurs ci dessus produits.
Pour ce qui est de la partie occidentale le voûtement en ogives sur nervures doit être retenu avec la plus grande prudence pour une attribution à la période gothique à partir du XIII° siècle. En effet Vincent Flipo nous livre une réflexion qui doit retenir notre attention : " Voûtes de pierre sur la nef : la voûte d'ogives n'a pas d'autre origine que la voûte d'arêtes déjà employée dans la période romane. Les arêtes sont soutenues par dessous au moyen de deux arcs ou ogives qui se coupent à la façon d'un X, et on ne peut en aucun cas, désigner l'arc brisé, comme certains auteurs l'avaient cru autrefois...Le style gothique emploie ce type de voûtes à l'exclusion de tout autre, sauf dans le Midi de la France qui conserve longtemps encore ses méthodes de construction romanes. Dès son apparition dans la première moitié du XII° siècle (Morienval) ...". [ Vincent Flipo, Mémento pratique d'archéologie française. Paris, 1930, p. 149] Le gothique angevin nait également à la même époque romane et nous sommes sur le diocèse de Saintes.
Atypique aussi et très sophistiqué en véritable réflexion architecturale originale par le jeux des volumes du sanctuaire qui se dilatent et se resserrent sous la voûte en berceau sur doubleaux jusqu'au fond du sanctuaire : deuxième travée voûtée. Autre aspect singulier : la travée resserrée sur fond du sanctuaire, éclairée par une seul grande verrière plus d'esprit gothique que roman, est précédée d'une travée d'entrée aux murs non enduits dont on a conservé le parement en grand appareil régulier à valeur ornementale et traces d'une niche récupérée pour une plaque commémorative sur le mur Nord [sur deux photos anciennes publiées sur le net par Pénélope Cartier nous voyons sous des enduits blancs de ces parties sous arcades les tracés d'organisation du mur Nord par une niche centrale. Cette trace nous oriente assez fermement vers un total traitement ancien d'origine des deux murs tels qu'ils apparaissent de nos jours dégagés de l'enduit blanc] Sommes nous ici dans un probable substitut d'avant-chœur sans traces de débordement de couvertures articulées entre avant-chœur et chœur ?
(une même niche était à l'entrée de la chapelle de route isolée à Bors-de-Montmoreau - J'y ai proposé une niche pour une statue de dédicace ?)
Des traces de polychromie principalement rouges sont encore visibles sur le mur de fond de la chapelle.
A partir de là on doit pouvoir avancer fermement que la chapelle a été conçue et murement réfléchie en deux parties distinctes pour un même plan d'ensemble d'origine.
Nous entrons là, déjà dans les conception des chapelles de routes en plusieurs temps architecturaux : soit porche charpenté, sanctuaire voûté, soit porche voûté sur nervures, sanctuaire voûté en berceau, soit porche voûté en berceau, sanctuaire voûté sur arêtes ou en ogives.
A ceci il faut ajour une autre travée possible de portique ou auvent en dur ou en bois.
Il faut encore remarquer un mur plus fin sur la partie actuellement non voûtée entre le contrefort sud-ouest du sanctuaire voûté et le contrefort oblique de façade Ouest, c'est-à-dire sur toute la partie qui aurait pu être voûtée en ogive offrant la possibilité d'une large ouverture sur la façade Sud-Ouest de la chapelle. Il y a là, sur une conception aussi pensée et réfléchie, une intention, une raison architecturale. La diminution du mur est de 35 cm entre la plus grande épaisseur du contrefort à l'Ouest (90 cm) et son épaisseur la moins importante à la rencontre du mur du sanctuaire (55cm). C'est comme l'assise d'un mur qui n'a jamais été poursuivie en élévation mais qui rétablit la parfaite géométrie rectangulaire de l'ensemble, celle de la chape d'une dalle de béton pour l'implantation des élévations d'un bâtiment dirions nous de nos jours. Ce débordement au pied du mur Sud-Ouest extérieur joue en contrario du départ d'une nervure sur culot (disparue dans le remaniement de1953 lorsqu'on a supprimé le clocher en surélévation, clocher auquel on accédait par une échelle nous précise l'instituteur David). Forcément le traitement particulier de ce mur en retrait bas extérieur et en adaptation haute intérieure nous oriente vers un accès ancien muré ou reconstruit et ce remaniement est en faveur d'une ancienne ouverture sur une bonne proportion du mur. Autre indicateur d'un mur entièrement ouvert c'est l'articulation courbe du contrefort qui ne fait pas ressaut par son oblique sur l'espace intérieur mais qui accompagne le départ du mur Ouest. Cette ouverture accompagnait selon toute vraisemblance toute la face Sud- Ouest du monument. Les culots ne se repèrent pas sur les angles intérieurs de la façade Ouest. On doit alors admettre que ces angles ont été remaniés et que dans ces remaniements les culots récepteurs occidentaux ont été supprimés.


 |
[Pour une claire lecture de l'outil je n'ai pas restitué l'épaisseur des voûtes sur les arêtes du porche, ménageant un
choix possible de voûtes en tiers points, puisque la voûte est sur plan rectangulaire. Pour la restitution finale je proposerai un lien entre la clé
de voûte centrale
et celles des formerets que je dessinerai en cintres brisés pour des questions de cohérence des quartiers et des deux départs sur culots parfaitement
documentés en articulation des supports de la voûte en berceau,
au bénéfice d'une combinaison tiers-point/plein cintre, émancipée des voûtes
uniquement sur plan carré des débuts du gothique, suivant la remarque plus haut citée de Vincent Flipo.
Pour une restitution des voûtes si le lecteur le souhaite qu'il ajoute simplement 25 à 30 cm au-dessus des nervures.
Cette épaisseur des voûtes reprend la hauteur des claveaux des voûtes appareillées en simple
rangée unique d'une multiplication de claveaux posés côte à côte. Technique que nous allons retrouver à La Genétouze]
La démonstration est convaincante, non seulement nous retrouvons l'exacte configuration en deux volumes distincts
identifiés à Bors-de-Montmoreau
sur un porche largement ouvert en façade Sud-Ouest, mais en plus les hauteurs des
contreforts d'angles extérieurs Ouest à Cressac prennent en compte les points précis d'impacts
intérieurs des retombées des nervures sur les culots : ces contreforts sont rigoureusement
d'origine.
Tous les éléments d'étude pris au plus près des relevés terrains vont encore dans le sens
d'une première construction en chapelle de route.
|
La façade actuelle, elle-même, ne répond en rien à l'usage traditionnel des rangées d'arcs en façade, sur un ou plusieurs niveaux, qui signent le style roman des églises de toute la région.Même si la façade de l'église de Martron est à un seul portail il est dans l'esprit roman de multiplication des arcs et dans l'esprit des façades sans divisions de l'Angoumois [ [S.Ternet, 2006, op.cit., T.1, p. 150] . Celui de Cressac est d'un esprit très différent, sans ressaut d'ébrasement. Avec beaucoup de paramètres de probabilités cette façade, même en place, n'est pas d'origine romane. Elle a été fermée ou ouverte d'un portail dans un chantier bien plus tardif que celui de la première construction. Et ce percement peut-être assez récent vu la succession de linteaux plats en bois qui couvrent le passage dans le mur épais. [Pouvons nous essayer de nous orienter vers un portail récupéré en 1809 dans la destruction de la chapelle de Haut-Mont ?]
 |
Nous devons également remarquer que cette ouverture d'un style tardif est associée à deux départs de corniches de part et d'autre des impostes de la porte,
sans chapiteau. Ce type de dispositif existe dans l'art roman comme en façade occidentale de Notre-Dame d'Oulmes en Vendée. Toutefois le portail lui-même est d'un caractère roman très affirmé, ce qui n'est pas le cas du portail de Cressac. Aussi je propose d'aller chercher des éléments de sources beaucoup plus modernes et géographiquement plus proches. Compte tenu des recherches antérieures sur ce blog nous devons prendre ces
éléments en compte en tant qu'improbables ou
précieux vestiges vers un dispositif non repris ou fermé de baies à claustras, telle l'organisation
de la petite chapelle Saint-Jean de la Fontaine de Guérison (1° moitié du XVII° s.)
sur l'ancien domaine de La Ménècle en propose un modèle en vestige très rare mais in situ
(fig.2 du relevé ci-dessous)
en architecture partielle à pan de bois. A Cressac nous pourrions avoir
ce vestige d'une cristallisation architecturale en pierre
(sur le modèle des thèses retenues du passage des architectures de bois en architectures en
pierre de la constitution des ordres de l'architecture grecque; voire inversement)
Pour une étude complète de cette chapelle voir sur ce blog :
Bors-de-Montmoreau - Eglise Notre-Dame - Une introduction aux chapelles de routes - Identification d'une chapelle romane ouverte aux mouvements de fermements des petits sanctuaires du XVII°s. - Charente et versants alpins français. https://coureur2.blogspot.com/2022/10/bors-de-montmoreau-eglise-notre-dame-un.html Les structures ornementales extérieures du XVII° siècle ne sont plus celles décrites par Eliane Vergnolle pour le Moyen-Âge. Il n'en reste que la façade et le mur latéral exposé sur le passage des voyageurs avec son préau.
|
Si nous reprenons l'essentiel des éléments caractéristiques de ce bâtiment pour réévaluer la partie non voûtée, quelle lecture peut-on alors en faire plus précisément ?
Les éléments jusqu'ici recueillis et révisés au fur et à mesure de l'avancée de la recherche qui conserve sa cohérence vers l'identification d'une chapelle de route permet d'émettre plusieurs hypothèses plausibles mais qui prennent obligatoirement en compte un monument en deux temps : un secteur sous deux travées en berceau et un secteur qui démarre par une travée sous nervures.
Nous sommes là encore au plus près, avec une situation en carrefour de chemins ou de routes, d'une chapelle de routes ouverte en porche sur au moins la face Sud, de la période apparemment de transition roman-gothique ce qui expliquerait que l'instituteur David date cette chapelle du XIII° siècle (p.61). Une chapelle de route de transition roman/gothique, ce qui serait en somme la première trace d'une conception architecturale originale encore en place de cette période. Cette appréciation peut également se conforter par des manières de tailles des chapiteaux qui rejoignent à la fois les chapiteaux et les bases des remaniements gothiques de l'église de Poullignac, avec cet accompagnement du tore d'astragale sur tous les organes de la sculpture.
 |
Sur ce blog : Eglise Saint-Martin à Poullignac - Architecture et décors peints - Une source de recherches pour les églises des diocèses du Sud-Charente et principalement du bassin de la Tude entre Diocèses de Saintes, d'Angoulême et de Périgueux, de leurs origines aux évolutions et modifications du XIX° siècle .https://coureur2.blogspot.com/2023/06/eglise-de-saint-martin-de-poullignac.html
|
Il faut maintenant avancer vers le clocher signalé par Monsieur Body, auquel on accédait par une échelle, précise l'instituteur David. Seulement la partie centrale, peut-être déjà surélevée en valorisation d'un porche sous nervure, aurait été transformée en clocher rejoignant ici les dynamiques repérées à Bors-de-Montmoreau, pas totalement cependant, mais nous donnant une sérieuse indication sur le dispositif original des deux élévations distinctes Est et Ouest.
C'est d'abord ce dispositif original de la partie occidentale qu'il faut retrouver avant d'entreprendre des hypothèses d'insertion d'un clocher "au milieu du bâtiment", clocher en surélévation de "2 mètres environ" au dessus du toit, précise M Body.
Il nous faut un ancrage pour avancer
|
Pour de plus amples explications voir sur ce blog : Bors-de-Montmoreau - Eglise Notre-Dame -
Une introduction aux chapelles de routes -
Identification d'une chapelle romane ouverte aux mouvements
de fermements des petits sanctuaires du XVII°s. - Charente et versants alpins français.https://coureur2.blogspot.com/2022/10/bors-de-montmoreau-eglise-notre-dame-un.html
|
Ce cheminement c'est celui que nous reprenons à Cressac, après Bors-de-Montmoreau, au plus près, avec une situation en carrefour de chemins ou de routes, d'une chapelle de route ouverte en porche sur nervures, en face Sud-Ouest, de la période de transition roman-gothique, avec un couvrement du porche sur nervures que l'instituteur David donne au XIII° siècle comme déjà dit. Une chapelle de route dont le schéma directeur isolé sur ce blog à Bors-de-Montmoreau serait plus fermement exprimé à Cressac en choix des deux couvrements de transition roman/gothique des deux organes principaux composants d'un module de base commun. Ce qui serait en somme la première trace d'une conception architecturale originale en terme de nouvelle famille architecturale, encore en place, de cette période sur la région. Cette évaluation historique se trouve également confortée par les manières ornementales de tailles des chapiteaux qui rejoignent à la fois les chapiteaux et les bases des remaniements gothiques de l'église de Poullignac, avec cet accompagnement du tore d'astragale et la corbeille à collerettes des chapiteaux des demi-colonnes.
C'est donc ici une recherche, en complément de l'étude de Bors-de-Montmoreau, à considérer comme un point de départ archéologique - en l'absence de traces plus anciennes sauf par les textes - pour une recherche d'autres partis architecturaux de la même famille et de la même époque, parents des chapelles ouvertes en abris du voyageur.
L'instituteur David signale une importante voie de communication dont il donne l'itinéraire(op.cit. 1909, p.8) :"On mentionne une voie romaine, ou chemin de Charlemagne, de Périgueux (Vésonne) à Bordeaux par Coutras (Carterate) station militaire des Romains.
"En partant de Burdiglia (Bordeaux) cette route se dirigeait sur Varatedo (Vayres), traversait la Duranius (Dronne)...et franchissait à quelque pas de là le Lary sur un pont dont il ne reste plus qu'un bloc en forme...Après avoir franchi les côteaux qui surplombent la vallée de la Donne ... et passé para Corterate (Coutras) ...C'est le tracé de la table théodosienne, 70 milles gaulois, environ 103 kilomètres. Cette voie , dont la largeur suffisait à trois chariots de front, était formée de plusieurs couches de pierre carrées, revêtues d'un lit épais de ciment".
Ce qui va articuler ce premier édifice de Cressac à l'église de La Genétouze jusqu'à Pillac, sur un mode de constructions romanes, c'est l'emploi des contreforts d'angles.
S'ils se justifient pleinement en façade Ouest avec les retombées de la voûte d'ogive du porche, ils sont plus sujets à controverses en façade orientale recevant les poussées d'une voûte en berceau.
Nous laisserons pour l'instant la probabilité à Cressac d'une division du sanctuaire en chœur et avant-chœur sous une même voûte en berceau, bien que cette restructuration du sanctuaire en deux espaces sous un même voûtement plein cintre enrichisse considérablement le modèle initial de référence à Bors-de-Montmoreau.
La variante en porche, avant-chœur ou travée intermédiaire entre le porche et le chœur à valeur de courte nef existe et même avec une chapelle partiellement fermée, ouverte d'une simple arcade décalée en façade occidentale sous porche maçonné en trois arcades et couvert sous charpente à Sigale, vallée de l'Estéron dans les Alpes-Maritimes ( 1536 : datation inscrite des décors peints).
Le porche bien que charpenté est épaulé de contreforts d'angles
|
La chapelle, après un porche en dur et charpenté donne accès par l'angle Sud de sa façade occidentale, à une travée unique couverte en berceau
alors que la travée unique du sanctuaire est voûtée sur nervures.
Ce qui est un plan inversé et très simplifié de la chapelle de Cressac.
On comprend alors que ce parti architectural, moins ancien, est issu de la période Cressac/Bors-de-Montmoreau, bien que la façade soit ouverte à l'Ouest. Ouverture justifiée par la présence directe du très profond ravin au départ géré en restanques sur la face Sud de la chapelle.
En revanche la question d'un toit à plusieurs niveaux n'apparaît qu'avec le couvrement du porche ouvert en arcades sur trois faces.
Ce type d'architecture se forme et s'isole depuis au moins la période romane, voire de transition roman/gothique, comme une famille à part entière, qui va
évoluer en fonction des configurations particulières locales des implantations et terrains,
voire des particularités climatiques (vents dominants, pluie, neige, etc...). |
L'église de La Genétouze nous en apprendra beaucoup plus sur cette question de l'apparition des avant-chœurs supports de tours de cloches, reliés par des escaliers.
La question des contreforts d'angles.
Bibliographie complémentaire :
Pour ma part je peux reprendre l'étude des voûtements et supports de Saint-Amant-de-Montmoreau qui régit à peu-près tous les contreforts des chevets plats et façades du bassin de la Tude. Nous retrouvons essentiellement la figure 6 des modèles de Viollet Le Duc alors que nous sommes plus en plan sur la recherche d'un avatar de la figure 8..jpg) |
Il n'y a aucune ogive dans l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau, tout le chœur et l'avant-chœur
sont voûtés d'une succession de berceaux articulés comme en témoigne la
photographie ci dessous que j'ai prise en extrados de cette succession de voûtes. La partie centrale a été refaite en 1999, date inscrite sur le site de la réfection.
L'avant-chœur modifié est couvert d'une coupole sur pendentifs, percée d'un oculus zénithal et la nef est charpentée. |
On ne peut rédiger des études archéologiques en monographies d'églises et autres monuments, mises à disposition du public et des chercheurs ainsi qu'aux autorités de tutelles, qu'avec des éléments archéologiques répertoriés sur les sites, fiables et prouvés ainsi qu'avec des éléments de bibliographie et d'archives tracés en sources et publiés en outils scientifiques, dûment cités dans le compte rendu pour vérifications si besoin.
Tout le reste n'est que fantaisie et vue de l'esprit, abus des lecteurs ainsi que des caisses et clients payants.
Les contreforts d'angles obliques en sont absents sur la période romane.
Il y a donc une autre origine aux contreforts obliques romans de Cressac.
Cherchons dans les zones limitrophes des diocèses de Saintes, de Périgueux et d'Angoulême,
A travers les églises romanes du Ribéracois, publiées par Jean Secret (1958)
Type figure 8 de Viollet le Duc :
Chevet plat de Saint-Pierre-ès-Liens à Douchapt, p.16.
Chevet plat et file de coupole de Saint-Pierre et Paul à Grand-Brassac, p.22.
File de coupoles chevet plat de Saint-Thimothée à Palissac-et-Saint-Vivien, p.30.
Chevet plat de Saint-Pierre-ès-liens à Chanterac ancien voutement en berceau, p.86.
Chevet plat de Saint-Germain à Saint-Germain-du-Salembre p.99.
Ancien chevet plat et ancienne façade plate, file de coupoles, de Saint-Pierre-ès-Liens à Allemans-en-Périgord, p.109.
Façade plate de Saint-Martin à Villetoureix, p.135.
Façade plate de Saint-Pierre-ès-Liens à Gouts-Rossignol p. 182.
Ancien chevet plat de Saint-Eutrope à Lusignac, p.184.
Soit un total de 10 églises avec ce type de contreforts sur chevets 7 plats
pour 3 églises à façades plates
pour 1 églises à chevet plat et façade plate
voutées en berceaux dont trois à files de coupoles.
Types figures 2 et 6 de Viollet-le Duc
Un seul contrefort en façade Saint-Pierre-ès-Liens à Chanterac, p.85.
Façade plate occidentale de Notre-Dame-du-Bouquet à Bourg-du-Bost, p.113.
En façade animée à Saint-Pierre-de-Faye à Ribérac, p.121.
Chevet plat et façade plate pour deux travées uniques en files de coupoles de Saint-Martin à Ribérac, p.123.
Chevet plat animé de Sainte-Marie, alias Saint-Barthélémy à Bourg-des-Maisons, p. 165.
Façade plate de Saint-Cybard à Cercles, p.167.
Chevet plat et façade plate pour file de deux coupoles encadrées d'un chevet en berceau et narthex sur arrêtes de Saint-Martial à Saint-Martial-de-Viveyrol, p. 187.
Façade plate animée de Notre-Dame-de-l'Assomption à Vendoire, p.193.
Ces types de contreforts qui peuvent être confondus sont systématiquement utilisés aux quatre angles d'églises à nef unique seulement sur deux églises sur 8 où on en repère l'emploi.
Tous les contreforts obliques d'angles, qui ne figurent pas au chapitre des contreforts romans chez Viollet-le-Duc, sont donnés aux XV° et XVI° siècles par Jean-Secret sur le Ribéracois - diocèse de Périgueux - voisin de la Genétouze.
Pour la Saintonge dans l'état actuel des publications de
Charles Connoué (1952 à 1955) - secteur de Cognac/ Barbézieux/ Jonzac et ses environs.
Les volumes publiés sont indépendants par secteurs. Donc les références de pages doivent suivre le choix de l'auteur en plusieurs volumes qui renvoient les documents iconographiques regroupées à la fin des volumes rédigés. Dans les rédactions les types de contreforts n'étant pas souvent pris en compte il ne reste que les vues d'ensemble (photographies ou dessins) pour les repérer lorsqu'il n'y a pas de plan. Ce qui est le cas des publications de Charles Connoué, contrairement à celles de Jean Secret. L'inventaire s'en trouve donc un peu appauvri et moins scientifique mais fiable tout de même).
Commençons par le secteur de
Jonzac
qui est celui dans lequel nous trouvons les pages relatives aux deux églises de La Genétouze (p.72 et 73) mais sans aucune vue publiée des deux églises ou église et chapelle. Les documents que je produis sur cette page pour ces deux monuments en plans, coupes et élévations sont donc les premiers mis à disposition du public.
La présentation suit l'ordre de publication des planches
Type figure 8 de Viollet le Duc
Façade de Saint-Pierre de Bois à Bois texte p.45, planche 3.
Façade de Saint-Etienne à Chepniers p.57, planche 8.
Façade de Saint-Séverin à Nieul-le-Virouil, texte p.104, planche 26.
Façade de Saint-Palais - nef lambrissée - à Saint-Palais-de-Mirambeau, p.149, planche 65.
Une seule église sur quatre est signalée avec une nef planchéiée (lambrissée).
Type figure 2 et 6 de Viollet le Duc
Façade de Saint-Martin - en croix latine du XII° s, anciennement voûtée en berceau - à Arthenac, p.39 et 40, planche 2.
Façade de La Vierge de la Nativité, très remaniée au XIX°s., à Boresse-Martron, p. 47, planche 4,
Façade de Saint-Pierre - plan en croix latine du XII° s. - à Champagnolles, p. 53 à 55, planche 7.
Façade de Saint-Christophe à Celles, p.51, planche 14.
Chevet plat de Saint-Christophe à Léoville, p. 85 et 86, planche 18.
Façade de la Vierge de l'Assomption à Neulles, p. 101, 102, planche 25.
Chevet plat de Saint-Christophe à Rouffignac, p. 117,118, planche 29.
Façade de Sainte-Colombe à Sainte-Colombe, p. 121, planche 30.
Façade de Saint-Philippe et Saint-Jacques à Saint-Simon-de-Bordes, p. 154 et 155, planche 39.
Façade de Saint-Palais à Saint-Palais-de-Phiolin, p.150 et 151, planche 42.
Façade de Saint-Christophe - énormes contreforts - à Villexavier, p.167, 168, planche 47.
Façade de Saint-Seurin à Galgon (Gironde), p.55, planche 55.
Façade et bras du transept de Saint-Denis à Saint-Denis-de-Piles, p.122,123, planche 62.
Treize églises pour de groupe 2 et 6, auquel nous pourrions rattacher des églises contreforts-colonnes en façade pour des contreforts carrés en départs de murs gouttereaux : les avatars ne sont pas rares.
Les chevet plats sont moins fréquents mais ils existent.
Voici qu'apparait ce nouveau groupe des contreforts obliques d'angles, contreforts associés à des constructions romanes, celui que nous recherchons pour Cressac.
Toujours en explorant la même publication de Charles Connoué sur le secteur de Jonzac.
L'écueil dans les lectures architecturales c'est que les auteurs ont tendance à attribuer systématiquement ces contreforts d'angles à des remaniements d'esprit gothique du XIII° au XVI° s., sans débattre de ces questions. Une fois de plus nous trouvons pages blanches sur ces contreforts. De rares exemples conservés, d'après les littérature publiées, inscrivent cette position en faux.
Façade de Saint-Romain (nef du XII°s. voûté en berceaux brisés appareillés à Guitinières, p.75 à 75, planche 56.
Façade de Sainte-Lheurine - présentée comme très reconstruite aux XV° et XVI° conserve néanmoins un très cohérent programme roman entre la façade et le mur gouttereau sud articulés par un très gros contrefort oblique en angle. La photo présente le même contrefort au Nord-Ouest. L'auteur ne dit mot de ce programme. Le choix d'une modification des voûtes intérieures peut avoir pris en compte ce programme d'origine sans le modifier ou alors avec peut-être des renforcements de ces contreforts mais pas le contraire, soit des changements radicaux de parti architectural extérieur - à Sainte-Lheurine, p137 à 139, planche 37.
Façade de Saint-Vincent à Réaux - L'auteur ne remet pas en question l'origine romane des contreforts de biais en angle mais signale seulement la modification du portail central à la période gothique. Avec une nef intérieure re-voûtée au début du XV° siècle, nous pourrions nous retrouver dans le cas évoqué pour Sainte-Lheurine - p.116, planche 46.
Nous passons au second volume sélectionné dans l'ensemble des publications par secteurs de Charles Connoué.
Ici le secteur de Cognac et Barbezieux
Façade de Saint-Hilaire à Mouthiers-sur-Boëme - cette façade épaulées de deux puissants contreforts obliques n'est pas datée hors construction au XII° siècle. Elle dépendait de l'abbaye bénédictine de Limoges - p. 104, planche 38.
En conclusion de ces deux explorations d'un auteur qui a beaucoup travaillé sur le secteur de la Saintonge, nous devons admettre des contreforts obliques en façades romanes, et peut-être aussi sur certains autres organes comme les clochers (Moulidars) et pour tous les diocèses sur les chevets semi-circulaire par destination et nécessité.
Evidemment lorsque les façades se trouvent amputées de ces gros contreforts comme à Berneuil il ne fait aucun doute qu'ils appartiennent au remaniement de la façade, mais lorsqu'il s'inscrivent en articulation de deux programmes cohérents (Sainte-Lheurine) ou parfaitement intégrés au programme de la seule façade (Saint-Hilaire) nous devons admettre que l'emploi des contreforts obliques commencent avec des églises romanes, d'autant plus que ces contreforts sont plus propres à compenser des terrains mal stabilisés (tertre, croupes, ou autres bordures propres à des glissements) que des contreforts droits qui sont souvent des lésènes épaissies - ou en variations de fasceaux de colonnes et colonnettes propres à envelopper les angles - avec des traitements particuliers des bases et des réintégrations sommitales dans les murs, voire des supports d'arcades de renforcement des parties hautes de murs recevant des voûtes intérieures.
Voire aussi une réflexion que j'ai menée à Rioux-Martin et Curac (deux églises de deux localités du bassin de la Tude en Charente sur l'ancien diocèse de Saintes) par mes relevés archéologiques sur le rôle de ces angles et contreforts d'angles en impacts sur les proportions des travées intérieures de la nef, principalement. Sur ce blog :
Rioux-Martin - L'église romane - L'implantation de l'abbaye de Fontevraud à la Haute-Lande - Les interventions d'Edouard Warin et de Paul Abadie au XIX° s. - Une approche des escaliers romans dans le bassin de la Tude.
https://coureur2.blogspot.com/2022/06/rioux-martin-leglise-romane.html
Par précaution, pour évaluer des vecteurs de diffusions de ce type de contrefort à la période romane ou chevauchant le XIII° siècle avec des conservations de manières romanes sur la zone géographique que je me propose d'investir avec ce nouvel article, regardons du côté de l'étude de Sylvie Ternet sur l'Angoumois qui est la troisième entité diocésaine qui coiffe le bassin de la Tude par le Nord.
Sylvie Ternet, Les églises romanes d'Angoumois - Tome premier - Bâtisseurs et mode de construction en Angoumois roman - Tome second - 75 églises de l'Angoumois roman. Ouvrage publié grâce au soutien du Conseil Général de la Charente. Paris 2006.
Avec cette publication l'auteur inventorie les types de plans par des figures noires, empruntées à différents auteurs, publiés par J.George en 1933. Bien que la publication soit consacrée aux églises romanes on peut supposer que tous les plans ne sont pas entièrement romans.
Ils sont publiés aux page 119, 124, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136.
L'essentiel des contreforts sont très majoritairement des types 2, 6 et 8.
Les contreforts obliques en façade se rencontrent une fois seulement sur l'angle Sud-Ouest de Malleyrand (p.119) pour lequel il faut toutefois remarquer un plan de la famille de Sérignac en trois travées voûtées en berceaux sur doubleaux et chevet plat éclairé de trois lancettes. Ce qui évidemment créé un lien avec Cressac, mais avec des appréciations différentes sur la datation du contrefort d'angle
Plus une seule fois en double en façade à Rivières à nef charpentée pour un chevet plat épaulé par le type représenté en figure 1 des planches de Viollet-le-Duc (p. 129). Hélas nous rencontrons la même différence d'appréciation sur les chantiers qu'à Malleyrand et vu ces écarts je ne peux pas l'inclure dans cette recherche en statistique fiable.
Les contreforts obliques se trouvent maintenant employés en chevets plats une seule fois sur l'angle Sud-Est de Brie voûté en berceau (p.126), en contreforts de chapelles latérales Nord et voutée en voûte sexpartite à Châteauneuf (p.131) et à Montbron (p.134)
En synthèse de ces explorations qu'il faudrait certainement affiner, nous pouvons avancer que les influences périgourdines et angoumoises sont plus improbables sur le secteur de La Genétouze que celles venues de La Saintonge.
Sur ce secteur du bassin de La Tude il nous faudra pourtant basculer sur le diocèse de Périgueux, avec Chenaud et Pillac pour trouver une suite architecturale à l'étude de ces bâtiments de la commune de La Genétouze.
En tout état de cause les contreforts obliques en façades plates ou chevets plats entrent bel et bien dans les caractères qui peuvent appartenir autant à l'art roman qu'à l'art gothique même s'ils sont plus fréquents dans l'art gothique.
En manière de chapitre de synthèse sur cette église de Cressac
On peut admettre que l'ensemble des marqueurs de l'architecture de Cressac sont romans avec toutefois un risque cependant minime avec des contreforts obliques qui de toute façon appartiennent à l'art roman d'Ouest (Connoué - diocèse de Saintes) car la réunion des tracés des contreforts ne constituent pas une reprise dans la même maçonnerie oblique de contreforts plats et droits en lésènes agrandies ou plus épaisses avec ou sans ressaut de l'angle du bâtiment bien que des remaniements de contreforts d'angles ou d'adaption romane des contreforts d'angle au profil du tertre étroit bordé de ravins sur toutes ses faces restent possibles.

Une voûte sur nervures couvrait la partie occidentale de la chapelle. Les ogives appartiennent autant à l'art angevin du XII° siècle qu'à la période romane du Nord. Nous avons également vu que les hauteurs des contreforts en façade Ouest sont parfaitement adaptés aux points de rencontre des nervures sur des culots (bien que disparus) en angles intérieurs Sud-Ouest et Nord-Ouest.
A ces observations il faut inclure la verrière unique au chevet. Le détail de cette baie qui fut par la suite bouchée par ses 2/3 inférieurs ne modifie en rien ou confirme l'appartenance architecturale de cette chapelle à la transition roman/gothique, avançant vers une chapelle selon toute vraisemblance conçue à l'origine de sa construction comme une chapelle de route ouverte par un porche en façade sur un tertre en carrefour de routes, puis fermée et progressivement réaffectée en église paroissiale lorsque Cressac devint paroisse et siège d'une juridiction relevant en appel de Chalais [David, 1909, op.cit, p. 72] puis une des trois églises de la paroisse de La Genétouze qui devint une commune unique en 1790 avec la réunion de la chapelle ou église de Haut-Mont aux deux autres. En 1809 des réparations furent faites à Cressac avec des matériaux prélevés sur l'église de Haut-Mont déjà tombée en ruine. Compte tenu des dotations faites en plus pour l'achat d'objets sacrés on peut entrevoir une même datation pour le beau tableau qui enrichit l'autel. L'instituteur David écrit p.64 "...et les hormaux qui sont sur le cimetière de Cressac pour le produit être employé tant aux réparations urgentes et nécessaires à l'église de Cressac qu'en achats d'ornements et vazes sacrés nécessaires à l'exercice du culte catholique aux offres que font les habitants des communes de Cressac et le haut Mont de fournir lexedent pour faire faire les dites réparations, achats d'ornements et vazes sacrés" (sic). Ce texte nous invite à comprendre que la chapelle était vide, ce qui va dans le sens d'une chapelle anciennement ouverte qui fut toutefois utilisée pour la célébration des cultes comme le précise encore un complément du texte recueilli par David.
Nouvelle icône pour un essai de restitution de la chapelle d'origine sans le clocher signalé par monsieur Body. Pour une restitution d'un clocher tel que Monsieur Body m'en a donné l'emplacement, il faut diviser par deux l'élévation Ouest et ne garder que la partie Est en fermant le mur manquant à l'ouest par un dispositif en abat-sons ou par un mur en pan-de-bois, léger, au droit de la clé de voûte du porche en œuvre, sur toute sa largeur, tel le dispositif qui est en place en l'église Saint-Martial sur le commune de Rouffiac.
Essayer de comprendre les caractères de ces bâtiments à l'origine de leurs constructions pourrait faciliter les recherches de la chapelle ou de l'église disparue de Haut-Mont, qui dépendait aussi de l'archiprêtré de Chalais, dont il ne reste apparemment aucune trace, sauf peut-être un cimetière (David op.cit., p 76).
L'étude de ces monuments tout au sud du bassin de la Tude situe également le prieuré de la Haute-Lande actuellement sur la commune de Rioux-Martin au Nord de la Genétouze (Voir Rioux-Martin - département de la Charente - sur ce blog) , prieuré de Fontevraud, sur le Diocèse de Saintes en dépendance de la juridiction de Chalais encore plus au Nord, au cœur du Bassin de La Tude alors que la commune de La Genétouze avec ses trois localités se trouve actuellement sur le département de la Charente-Maritime. Mais l'approche spécifique du secteur de La Genétouze va nous apporter d'autres éléments de la gestion de ces territoires dans l'histoire jusqu'à ne plus confondre le secteur de Cressac de celui de La Genétouze.
 |
Les premières impulsions données à l'exceptionnelle densité des constructions religieuses romanes (XII° siècle),
sur ces territoires principalement regroupés dans les limites du département de la Charente
et bordures,
sont d'ordinaire des historiens attribuées à Monseigneur Girard, Evêque d'Angoulême,
Légat du Saint-Siège, vers 1060-1136.
En 1202 Philippe Auguste confisque toutes les possessions continentales du roi d'Angleterre, déstabilisation des pouvoirs qui sont suivis en 1206 d'une attaque du roi de Castille contre Bordeaux.
|
Nous sommes bien ici avec cette nouvelle recherche dans la continuité de l'incontournable et précieuse étude de l'instituteur David, en rectification historique de la cohérence des territoires et des dépendances juridiques et religieuses du bassin de la Tude.
Nous ne quitterons pas Cressac, ce minuscule très joli conservatoire de l'architecture de tradition (vernaculaire) remontée depuis la nuit des temps, sans avoir signalé deux autres architectures remarquables présentes sur le site.
Autour de l'antique chapelle blanche du voyageur, gardienne des légendes,
église du paroissien dans un écrin de verdures :
1. B La Genétouze
Eglise Saint-Antoine
Quelques repères historiques et d'implantation.
"La Saintonge était partagée entre les généralités de Limoges et de Bordeaux lorsque par un édit du mois d'avril 1694, une généralité distinct fut créée à La Rochelle. Elle s'étendait de Marans à Coutras, donc la Genétouze en dépendait. A ce moment le représentant du pouvoir central dans chaque généralité était l'intendant de justice, police et finance. Au XVIII° siècle, elle est de l'élection de Barbezieux." La gestion administrative de La Genétouze nous éloigne de celle de Cressac " La gendarmerie fait partie de la brigade des gendarmes de Saint-Aigulin, du 18° corps d'armée dont le siège est à Bordeaux, du recrutement de Saintes. Les différentes contestations et contraventions sont jugées au tribunal du juge de paix à Montguyon et les affaires civiles plus graves et délits à Jonzac, au tribunal de Première instance. La commune avec tout le département dépend de l'Académie de Poitiers et de la 35° division militaire, police et finance. Elle est desservie par le bureau de poste de Saint-Aigulin" (deux extraits de David, p.38)
L'église Saint-Antoine - anciennement Sainte-Marie ou Notre-Dame - est construite sur une fin de croupe bordée d'un ravin dont une route épouse la courbe. L'ancien cimetière s'étendait en façade Ouest de l'église, à partir de cette route qui contourne actuellement la façade Ouest de l'église, dévalant le ravin qui s'enfonce beaucoup plus profondément sur toute la face Ouest pour remonter en ligne de crête site d'une autre route qui vient directement de Rioux-Martin jusqu'à Saint-Aigulin, laissant le secteur de la Haute-Lande à l'Est qui n'est plus en lien direct avec la Genétouze. De cette route sur l'autre ligne de crête on voit l'église Saint-Antoine ainsi que les bâtiments de l'ancien presbytère qui ne semblait pas très ancien à l'instituteur David lorsqu'il le décrivait avec ses difficultés de réinvestissement par le prêtre suite à la Loi de Séparation de l'Eglise et de l'Etat "D'après le Concordat de 1801,, signé entre Bonaparte et le pape Pie VII, les curés avaient droit à un logement dans les communes, mais la loi de séparation de 1905 leur a enlevé cet avantage" (David, 1909, op.cit., p. 35) " Ainsi cette petite église de la Genétouze, ou de la plaine des genêts, que ne distingue pas une architecture brillante que le touriste dédaigne sans nul doute...avant d'arriver à la Sainte table, à droite et à gauche , se montraient jadis des armoiries représentant avec une couronne de comte un léopard ou une levrette; elles étaient à-peine visible il y a quelque vingt ans et leurs restes sont recouverts par la chaux; si c'est un léopard, c'est une armoirie anglaise; si c'est une levrette, c'est une armoirie française" (David p. 22 et 23).
Le polygone développé en face de l'église sur le cadastre de 1841 correspond donc à l'ancien site du cimetière récupéré pour la construction de fermes lorsque le cimetière est déplacé à l'écart du chevet de l'église, soit à l'Est.
L'état actuel de la documentation publiée ainsi que celui des archives ne nous permet donc pas de remonter aux sources de l'implantation de la plus importante église de ce secteur, et peut-être la seule si Cressac et Haut-Mont ne furent que des chapelles de routes récupérées en lieux paroissiaux du culte catholique. Ce bâtiment apparaît bien avoir été, sur ces territoires assez étendus, et à la fois restreints, l'unique église émergeante de ce paysage de genêts, de landes, de forêts de pins et de bruyères avec cependant un cimetière qui signe bien la présence d'âmes et de foyers à moins que ce ne fût l'église d'une communauté religieuse dont on aurait perdu la trace mais que nous ne pouvons pas confondre avec l'implantation de Fontevraud à La Haute-Lande bien que s'inscrivant dans le périmètre assez réduit des églises construites à et autour de la Haute-Lande.
Les architectures de ces églises qui appartiennent à une même période romane témoignent de réflexions architecturales autonomes mais qui doivent cependant être intégrées dans la réflexion globale d'une implantation religieuse conséquente à partir de la seconde moitié du XII° siècle.
Pour amener une première conclusion à cette étude sur le périmètre de la Haute-Lande, qui sera déjà bien avancée avec l'étude du secteur de La Génetouze en suite de Rioux-Martin, il faudrait consacrer un article à la seule église de Médillac en lien avec son environnement géographique et de gestion d'économie agricole très particulier; mais aussi, à partir de là, en y incluant d'autres églises du bassin de La Tude, ouvrant une nouvelle sous-famille architecturale redistribuée dans la panorama des églises en accès hauts des clochers par des escaliers architecturés que le visiteur ne voit jamais.
Il n'y a bien sûr que l'archéologie du bâti qui permet de telles approches et comptes-rendus.
Ainsi, pour retrouver tout l'intérêt de cette implantation, de cette église de La Genétouze, il ne nous reste plus que le secours de l'archéologie du bâti et nous allons voir que ça en vaut la peine vu le contraste qu'il y a entre cette zone géographique toujours présentée comme très pauvre, ingrate, et la richesse ou la surprenante réflexion qu'il a fallu développer au XII° siècle pour inscrire ce monument dans les principales expériences le l'art roman local, voire participer à leurs éclosions serait encore plus juste.
Entre l'église de Rioux-Martin et celle de La Genétouze, en l'absence de textes fondateurs il nous faudra discourir : est-ce à dire que là où une avance l'autre recule et inversement. Ce n'est pas si simple mais c'est absolument passionnant tellement c'est surprenant, vertigineux sur un plan historico-archéologique pour deux monuments aussi proches de part et d'autre du tout petit secteur géographie de la Haute-Lande, en évaluations contemporaines.
Et ensuite les réponses et les voies de recherches à Chenaud et à Pillac : une phrase sans verbe.
Etude de l'Eglise en archéologie du bâti.
Moyens et relevés manuels
Cette église de La Genétouze, tout comme les autres églises jusqu'alors sélectionnées sur le bassin de La Tude et exposées sur ce blog, est encore un laboratoire de recherches que complètent bien sûr la très sophistiquée chapelle de route romane de Cressac, l'élaboration très subtile de l'église de Chenaud et celle très surprenante de Pillac. Donc des canons d'architectures qui, rassemblés sur ce petit territoire délaissé par les chercheurs, offre une gamme tout à fait exceptionnelle d'observations dans la construction de l'architecture romane vers sa réception très délicate et finalement tardive des courants gothiques dont témoigne le superbe exemple de Cressac.
Les points forts sur lesquels vont porter les recherches en archéologie du bâti sur cette église se répartissent en cinq axes articulés et pourtant bien distincts, qui constituent le plan de l'étude :
1 - A partir d'un plan actuel tout compte fait assez banal d'une église à nef unique et chœur précédé d'une travée droite, la mise à jour d'un parti original qui nous amène vers la construction d'une nef à travée d'avant chœur sans constitution d'un avant-chœur architecturalement composé mais porteur des éléments qui en seront un temps caractéristiques sur le bassin de la Tude dont l'entrée haute d'un passage menant à un escalier en vis logé derrière l'avant dernière pile Est de la nef, sans traitement particulier,
2 - Un escalier en vis introduit par une travée droite et plate intra muros, qui conduit à un comble dont la base dans la nef n'est pas constituée en articulation ou en support d'une tour de cloche,
3 - Un accès par cet escalier en vis à volée droite, intra-muros, de lien à l'extrados de la voûte par une volée droite directement articulée sur la vis et très réduite.
4 - Un accès au comble dont on ne pourra pas déterminer si la partie aujourd'hui en élévation de la dernière travée avant le chœur fut celle d'un clocher, ce qui confirme bien le choix de vocabulaire de Jean-Marie Pérouse de Montclos d'appeler cette travée "avant-chœur" puisqu'elle précède et s'articule directement avec une réduction de l'espace construit en travée droite devant une abside circulaire : le chœur.
5 - Un comble de clocher dont on ne pourra effectivement pas décider fermement si l'extrados du berceau de la nef - une fois celle-ci reconstituée à partir de la travée originale encore en place - était partiellement sur la travée d'avant-chœur ou totalement constituée d'un seul et unique comble sur quatre travées voûtées en berceau sur doubleaux, à l'origine du projet à quatre travées et même de la construction qui fut limitée à trois travées dont deux seront remplacées par des travées plus basses de réparations, voûtées sur nervures après effondrement des deux tiers du berceau.
Ces cinq points seront regroupé en trois chapitres 1a, 1b et 1c.
Nous pourrons ajouter une petite rédaction en fin d'étude pour les vitraux de Lanza del Vasto tout à fait originaux dans leur conception et contribution à l'art contemporain.
Ces cinq chapitres d'observations - après le préambule de Cressac qui confirme l'expérience romane de Bors-de-Montmoreau et introduit modestement des détails pour les études à venir - vont nous amener à nous interroger sur la validité exclusive des théories admises pour la constitution d'un panorama d'architectures religieuses romanes dans le Sud-Ouest de la France.
Les autres églises présentées sur ce blog, seront appelées en outils de réflexions et de tentatives d'approches des idées qui pourraient éventuellement être à l'origine de ce choix architectural de l'église de La Genétouze qui semble, dans l'état actuel des exposés disponibles, rare et pourtant décisif.
Nous allons commencer par la présentation d'un synoptique de reconstitution du parti architectural initialement prévu et réalisé, les deux états sur une même planche élaborée à partir de la planche synoptique de l'état actuel déjà présentée.
Et ensuite nous utiliserons cet outil étape par étape plus un autre outil, celui de la présentation du relevé archéologique de l'escalier en vis intra-muros jusqu'à son débordement sur l'extrados de la voûte appareillée en claveaux.
1 - Une nef plus grande en longueur et en hauteur.
1a : La longueur de la nef
En fait, comme le démontre la construction ci-dessus, la nef était prévue plus longue d'une travée. Elle aurait pu s'allonger indéfiniment comme un bâtiment moderne conçu par modules. Ici chaque module est une travée rectangulaire couverte en berceau qui s'articule à la précédente et ainsi de suite. Ce système très moderne ne varie qu'en ses travées les plus externes pour s'articuler par un jeu de ressauts avec soit la façade, soit l'entrée dans le chœur suivant le modèle en place à l'est des travées de nef. Les prises d'audace et de maîtrises des bâtisseurs vont nous entraîner vers des remises en questions des renforcements de réparations extérieures des cages d'escaliers comme nous en voyons une à La Genétouze. En effet cette question va se retrouve à Chenaud et nous serons donc amenés à revenir sur cette première famille de trois églises à escaliers en oeuvre pour un passage hors oeuvre.
Voici les alternatives dans lesquelles nous pouvons situer le cas particulier de Chenaud qui s'ajoute sans appartenir à aucun des exemples de Parcoul à Poullignac et ceci est certainement en conséquence de la nature des terrains sur lesquels sont construits ces monuments ainsi que les périodes
sur lesquelles ces arcades sont ajoutées, de toute façon ne signant pas nécessairement des chantiers contemporains.
Si nous ne regardons que l'aspect stylistique des chevets nous pouvons amener dans la réflexion celui de La Genétouze qui est construit avec des contreforts plats, quasi lésènes, mais sans arcade ni grande ni petites (bandes lombardes).
Ce mouvement des lits de poses à Parcoul se retrouvent à l'intérieur du chevet sur toute sa partie Nord, avec des niveaux qui commencent à 1,80 m et qui vont en oblique jusqu'à 1,56 m sous la fenêtre centrale du chevet.
Les arcatures intérieures sont d'un autre chantier - tout comme les arcs extérieurs - et ils s'ajustent mal aux ébrasement des fenêtres
Comme en témoignent les traces de décors peints, le chœur était entièrement décoré de peintures murales peintes à même la pierre comme on en trouve ailleurs sur la région, notamment au portail de Challignac, tel que le signale Michelle Gaborit, op.cit. 2022, p.40 .
Les répertoires sculptés sont de la même veine que ceux extérieurs, soit de la famille de ceux de Rioux-Martin et de la Haute-Lande.
Cette analyse des appareillages du chœur permet de ne plus voir un chœur entièrement construit et consacré en 1100 comme l'indique Jean Secret, mais un chœur qui appartient, en deux temps, à une période romane plus avancée vers 1200, jusqu'à rejoindre les courants ornementaux et les réflexions architecturales venues du secteur de la Haute-Lande autour de 1200.
L'église de Chenaud par les chantiers du chœur jusqu'à ses piles aux chapiteaux "à collerettes" et ses bases en interprétations pittoresques du canonique tore-scotie-tore sur plinthe rejoint la famille des monuments romans édifiés autour du secteur Sud du bassin de La Tude.
L'analyse de son escalier et de son rapport à l'avant-chœur va conforter cette rencontre avec ces monuments construits ou achevés à la rencontre de 1200, plus ou moins, mais aussi l'émanciper par des remaniements postérieurs entre XV° et XVI° siècles avant les adaptations de fortunes des XVII° et XIX° siècles.
En reprenant tous ces éléments nous devons comprendre que cette liaison entre la fin de l'escalier en vis et le départ de la volée droite qui traverse le mur jusqu'à sa division de part et d'autre de l'extrados de la coupole est à Chenaud d'origine et d'expression romane. Tout autant qu'en 2° séquence l'élaboration de la montée des volées dès leur départ sur un seul mur d'échiffre par un changement du démarrage de la vis qui devra passer par dessus le passage d'entrée de lien avec la 1° séquence.
Pour cela il faut trouver une autre solution.
La 2° séquence reste articulée à la 1° séquence d'accès en hauteur. Cette 1° séquence varie dans les mêmes proportions que celle de la hauteur de la vis de la 2° séquence entre La Genétouze et Chenaud. Nous pourrions croire à un état stabilisé atteint mais cette impression par les chiffres est fausse puisque nous passons d'un côté à l'autre du noyau pour les départs des deux vis. Ce basculement des entrées dans la vis a une conséquence directe sur l'allègement des structures en réduisant la valeur de l'échiffre du départ de la vis dès la fin du premier enroulement. Et c'est un système de jeu sur les marches et des linteaux d'étais qui est trouvé pour soutenir les degrés qui se trouvent brutalement sur le vide, que le simple enroulement de la vis avec sa superposition des noyaux résoudra automatiquement en montant vers l'accès au clocher. Système qui s'inscrit dans l'esprit de la recherche du lien de la vis à la volée droite de comble.

Ainsi cette cohérence des réflexions qui s'articulent entre La Genétouze et Chenaud, malgré un passage du en œuvre au hors œuvre, témoigne d'une appartenance à une même période historique, soit à l'art roman, et ici très certainement vers la fin du XII° siècle.
En revanche, à Chenaud, le travail sur la fin des séquences - 4° séquence - doit être reconsidéré en conséquence des remaniements de la travée d'avant-chœur entre piles romanes à l'Est et piles gothiques à l'Ouest. Ce remaniement pourrait être contemporain d'un changement ou d'une réparation du couvrement en pointe en pierres taillées appareillées de la cage d'escalier dont on voit les reprises intérieures au-dessus de la volée tournante terminées à l'extérieur par un amortissement - probable support d'une croix puisqu'il n'y a qu'un socle pour deux saints, que ces saints soient Côme et Damien ou Pierre et Paul - rythme des moulures de la famille des chapiteaux des demies colonnes adossées aux piles Ouest de l'avant-chœur.
L'architecture de l'escalier de fond jusqu'au niveau de la repise du couvrement est également identifié comme un chantier roman par Jean Secret. Ces caractères sont aussi en accord avec un héritage immédiat des caractéristiques exposées par l'article d'Eliane Vergnolle , "Passages muraux et escaliers : premières expériences dans l'architecture du XI° siècle". Dans, Cahiers de Civilisation Médiévale. Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation médiévale, Poitiers, Année 1989 - 32-125, p 43 à 60.
Compte tenu de ces derniers éléments associés à ceux de l'évolution des marches et des volées, exposée un peu plus haut, nous avons une base solide d'un chantier roman intérieurement modifié à la fin de la période gothique, mais aussi en reconstruction de son couvrement comme nous le voyons avec l'icônes ci dessous et les conséquences pour l'exposé d'étude qu'entrainement ces observations.
Nous renouons avec le plan du monument pour une première élaboration d'un synoptique qui va pouvoir nous permettre d'avancer sur les parties blanches du plan de Jean Secret.
Mais auparavant il nous faut proposer une nouvelle analyse par les photos car nous avons là tous les éléments nécessaires avant de proposer un premier synoptique analytique de résumé en plan, coupes et élévations.
Il est évident que cette dernière icône s'articule avec un chevet repris en maçonnerie ou consolidé compte tenu de la datation possible de l'ordre roman dans la seconde moitié du XII° siècle pour un chapiteau et base entrant dans les répertoires proposés plus haut pour la chapelle de Cressac mais que je redonne ici pour la souplesse de la lecture d'une rédaction sur blog Le décor qui oriente vers un chœur de la fin du XII° siècle ne s'accorde pas avec une consécration du monument en 1100 mais avec un remaniement du mur d'origine par des arcades extérieures sculptées, dont les lits de poses sont horizontaux pour ceux du gros œuvre plein qui tombent en oblique, et une nef également aux murs extérieurs épaulés par des arcades mais qui présente une autre originalité. Avec correspondance intérieure.
En conséquence nous allons être amenés à coder le chœur avec deux systèmes de hachures ainsi que l'avant-chœur, mais avec des écritures différents, au sein d'un premier dispositif roman qui avait amené un premier clocher accessible par un escalier hors œuvre en hauteur du mur Nord de l'avant-chœur, face à un mur Sud d'avant-chœur trop fin au travers duquel on accédait toutefois au départ d'un escalier rejeté dans une tour hors œuvre qui est à la place de ce qui aurait déjà été en contrepoint d'une pile articulée intérieure. Mais ce mur était il si fin qu'on puisse l'imaginer après les remaniements gothiques ?
Les questions posées par l'église de Chenaud sont nombreuses et au cœur des réflexions de l'architecture romane et de ses mutations, nous voyons également que les murs très épais ne sont pas de règle en architecture romane et que leur manque de masse de réserve - contrairement à la Genétouze et peut-être pouvant justifier l'originalité de Pillac ou vers Pillac - ne sont pas des obstacles à la construction d'escaliers en vis qu'ont sait précocement renvoyer dans des tours et en articuler les volées tournantes à celles droites en inventant déjà des solutions riches d'avenir, comme la dernière étude de cette page avec son épilogue par l'église Saint-Laurent à Saint-Laurent-des-Combes le repositionnera.
Quoiqu'il en soit le renforcement de la pile articulée à l'Ouest de la dernière travée de la nef avant le chœur, semble avoir été avec l'escalier, un chemin privilégié pour l'évolution de la réflexion des bâtisseurs romans, puis gothiques comme la première planche d'étude nous en donne une orientation qui va nous permettre d'en proposer une seconde rectificative, avant publication du synoptique.
Cette première planche serait l'aspect théorique de la réflexion sur plan qui a toute sa valeur sauf qu'elle se heurte à la réflexion en élévation. Cette réflexion en plan doit être d'abord posée, et ensuite requestionnée.
Avant de donner une suite à cette planche regardons d'abord les icônes photographiées


A part un traitement différencié des profils des arcs doubleaux - qui ne fait pas véritablement sens sinon une très probable réalisation contemporaine des deux piles du XII°s., ce qui serait logique en arc de transition avec le chœur voûté - nous ne voyons pas de réajustement comme c'est généralement le cas lorsqu'on veut adapter une coupole à des structures majoritairement antérieures. Nous voyons clairement que les murs Sud et Nord sont une nouvelle fois élargis par chacun un arc support de la corniche de la coupole. En revanche, en accompagnement des arcs de transition Chœur-Avant-chœur et avant-chœur -nef nous avons un système qui est celui normal d'un arc au doubleau diminué de l'arc. . Ce qui va encore dans le sens d'un chantier de la coupole contemporain de celui des piles gothiques, de fond en comble, comme en témoignent les répertoires des bases (seule celle au nord est d'origine, elle a été refaite à l'imitation au Sud) et des chapiteaux. En revanche une coupole du XV° siècle sans oculus zénithal peut surprendre.

Il faut donc lire une coupole adaptée aux niveaux du service de l'escalier roman.
Avant ces remaniements gothiques c
et escalier servait t-il déjà un niveau de clocher roman sur voûte et quel type de voûte aurait t-on mis en place sur des murs "fins" qui ne furent peut-être pas tant que ça ?
En reprenant le profil du mur remanié nous voyons qu'il y a deux élévations sur arcs et non pas une seule. Ce qui a pour conséquence d'épaissir deux fois les murs Sud et Nord en ramenant le plan de la coupole vers un plan rond quasi régulier.
Et si on pousse l'analyse plus loin, celle qui devient totalement cohérente avec l'icône d'étude ci dessous, nous remarquons que la base du départ du ressaut de la pile Est en bordure de l'arc du mur Sud, n'occupe à peu près que la moitié de la profondeur totale de l'arc d'élévation. Ce qui signifie que ce mur a été élevé deux fois sur (le même ?) arc.
En prolongeant par le dessin le niveau du premier mur sur arc nous arrivons, mais pas tout à fait, au niveau de la dernière marche la plus ancienne de la volée droite qui franchit le mur d'élévation jusqu'à l'entrée dans le comble (icône ci-dessus). Il manquerait en fait un peu plus de 5 cm, soit la valeur du formeret d'une voûte sur nervure.
Mais avant de monter dans le clocher ces valeurs se répercutent ailleurs et notamment en seuil et ébrasement du passage qui conduit de l'avant-chœur à la base de l'escalier en vis pour une largeur de 20 cm ainsi qu'en nouvel habillage ou entourage de l'ébrasement de la fenêtre romane pour une épaisseur de 15 cm avec une très nette différence des appareillages.
(Les dimensions peuvent toutefois être assujetties à réajustement sur des maçonneries tantôt régulières et tantôt irrégulières malgré une belle perception de l'ensemble très soigné. Toutefois, dans l'esprit, nous sommes là au plus près de l'histoire archéologique de ce monument).
C'est l'objet de cette nouvelle planche d'étude en coupes-élévations de l'escalier/organes de supports intérieurs jusqu'aux escaliers par-dessus la coupole, en deux vues affrontées, repositionnées dans l'exact déroulement des volées et passage, sur la même planche dessinée. Planche qui reprécise l'ensemble des chantiers superposés en passage des chantiers romans à ceux de la fin de la période gothique, ainsi que la première planche en plan (méthodologie). La zone du clocher en grisé vertical est la zone en réserve pour une précision de compensation des épaisseurs sur une seconde publication de la même vue qui amènera l'épaisseur du mur Sud du clocher à sa réelle épaisseur augmentée des 15 cm du renforcement gothique, depuis les mesures du mur prises dans le passage d'accès à l'escalier, lors de l'étude du clocher : nous passerons ainsi des 80 cm actuellement reportés aux 95 cm réels de la totalité de l'épaisseur du mur Sud du clocher (voir les détails des mesures au paragraphe du clocher).
1 - Les conclusions d'étude du secteur chœur-avant-chœur par la lecture de l'icône ci-dessus.
Nous voyons que l'escalier est pris dans un conflit d'articulations de murs plus ou moins épais et que seul un ressorti hors œuvre d'une masse murale supplémentaire permet de loger un escalier en vis dans une cage d'escalier qui n'a pas elle-même les mêmes épaisseurs de murs sur son périmètre à base "carrée" élargie par un plan intérieur qui passe du rond au rectangle. dans sa dernière demie volée.
Il y a là une étude à reprendre en complément des observations sur les premières recherches des paliers à deux noyaux pour trois marches. En fait il y a comme une autre marche qui est insérée de biais dans le mur d'élévation Nord qui va accompagner l'appui de la flèche de couvrement contre l'angle Sud-Ouest du mur du clocher. Il y a pu avoir là un complément de réflexion qui nous aurait amené à quatre marches pour deux noyaux. Mais la réflexion n'a pas été conduite jusqu'au bout et cette marche, qui ne fait pas toutefois toute la largeur du pan de mur qu'elle supporte, sert simplement au décrochement du mur d'élévation intérieur de la flèche de couvrement.
1a : Le passage du plan circulaire au plan carré entraîne une diminution d'épaisseur du mur Ouest de l'escalier; ce qui en ramène l'épaisseur à la même valeur moyenne que les murs Sud et Est de la cage d'escalier. Ceci aurait pu avoir pour conséquence de comprendre que le couvrement en pointe aurait été déjà réalisée avec trois pans égaux appareillés sur la construction romane. Donc que ce couvrement gothique serait une reconstruction - plus ou moins identique mais dans le même esprit - du toit roman en demi-pavillon adossé avec un nouvel ornement en amortissement. En fait d'autres éléments s'opposent à cette conclusion et notamment des traces de support de pièces de bois autour de l'entrée dans la volée droite et autres décrochements des murs.
 |
| Icône pour les deux sous paragraphes 1a et 1b. |
Donc deux hypothèses :
a) une avec un passage au plan carré qui se justifierait par un premier couvrement pyramidal en pierres appareillées,
b) Une sans couvrement pyramidal en pierre appareillée au bénéfice d'un toit charpenté dont certains supports auraient laissé des traces dans le haut de la cage d'escalier autour de l'accès à la volée droite. Dans ce cas le décrochement du mur aurait pu également supporter une pièce de charpente mais d'autres aspects se comprennent mal et en premier chef ce soucis de murs d'égales épaisseurs. La construction de la pyramide gothique étant adaptée au support roman déjà en place.
1b : le passage du plan circulaire au plan carré abandonne une pierre concave taillée en triangle qui épouse parfaitement l'arrondi du premier plan de la cage d'escalier avant un décrochement vers le mur de plan carré. On ne peut pas voir là une marche abandonnée ou réemployée. En revanche on peut questionner un écart entre la pointe de cette pierre et le plat du mur : écart garni par une petite maçonnerie en arrondi qui pourrait évoquer le support d'un noyau.
Ce dispositif pose certaines questions mais ne permet pas, toutefois, d'avancer plus avant vers une possible tentative de réflexion vers une petite vis relais.
Avec Montignac-le-Coq nous verrons un escalier à service double mais l'organisation en est très différente. A Magnac-Lavalette (secteur Nord-Est du bassin de La Tude) l'escalier en vis qui démarre de fond dans la travée d'avant-choeur, monte au clocher mais il faut sortir de cet escalier et passer dans le comble pour rejoindre à peu de distance l'accès à la petite vis relais des ou du niveau supérieur (église pas encore étudiée en archéologie du bâti).
1c : l'incidence du doublement gothique des murs Sud et Nord de l'avant-chœur.
Un nouveau couvrement pour l'avant-chœur
En figure 2 de l'icône de synthèse autour de l'escalier, nous voyons parfaitement que la fenêtre de l'avant-choeur a été enrichie d'un nouvel ébrasement intérieur, correspondant à l'élargissement des murs Sud et Nord de cette structure déjà prévue dans la construction romane, sans que nous puissions fermement affirmer un couvrement plutôt qu'un autre à l'exclusion toutefois d'un plafond planchéié comme peut en témoigner le relais de la fin de la vis par un volée droite intra-muros d'origine romane.
L'alignement en coupe de ce doublement du mur nous conduit aux première marches qui sortent de la travée intra-muros romane. Cet alignement montre parfaitement que la coupole en place, sans oculus zénithal, date totalement de la période gothique de constructions des piles Ouest de l'avant-chœur.
Cette dernière question s'articule directement avec l'analyse qui suit et qui va reprendre la question de l'élévation originale du clocher à celle modifiée par les épaisseurs.
1d : la question de l'élévation du clocher.
Il est important de cibler ces réflexions à Chenaud puisqu'elles vont revenir dans le débat des réflexions des fins d'escaliers romans avec les exemples de Montignac-le-Coq et de Saint-Laurent-de-Combes qui terminent cette première étude. A Pillac - prochaine église sur cette page - l'escalier détruit à sa liaison avec le passage à degrés dans le comble ne permet pas cette recherche, mais il en permet d'autres complémentaires; c'est un ensemble depuis la chapelle de Cressac sur la commune de La Genétouze. Ainsi pour ce sujet spécifique de lien entre Chenaud et Montignac-le-Coq est en quelque sorte direct et remonte vers Magnac-Lavalette, mais l'église de Saint-Laurent-des-Combes va considérablement modifier cette trajectoire en la façonnant en base géographique triangulaire le cadre de ces premières études (dans l'état actuel de la connaissance archéologique des inventaires des églises du bassin de La Tude et lisières, dont les exposés sur cette page de blog sont les toutes premières investigations en relevés spécialisés).
Comme tout est extrêmement imbriqué reprenons l'étude dans le passage d'accès à la base de la vis.
Grimpons dans le comble et examinons les parements intérieurs du clocher. Nous pouvons proposer une seconde icône de l'escalier qui précise les premières conclusions. Sans le dessiner nous pouvons comprendre que l'élévation du clocher reprend les supports romans et gothiques qui composent les nouveaux murs Sud et Nord de l'avant-chœur. Le niveau d'élévation au-dessus des fenêtres du clocher pouvant être uniquement gothiques ou combiner une association des maçonneries romanes et gothiques.
Toutefois ce n'est encore qu'une étape avant l'étude de la nef et les hypothèses qui pourront une fois de plus modifier ce codage.
Dans cette attente nous nous trouvons confrontés à un autre problème, après des traitements d'articulations d'escalier de trois marches pour deux noyaux, a une technique d'élévation intérieure du mur pr l'intermédiaire d'une assise différentes de blocs réguliers qui forme une ceinture sous le niveau des appuis de fenêtres : en alignement sans retrait avec le reste de l'élévation du mur à Chenaud, et à retrait à Saint-Laurent-des-Combes.
L'analyse des parements intérieurs du clocher nous donne donc des compléments d'information importants.
En effet, l'ensemble de l'intérieur du clocher est paré en grand appareil quasi régulier, bien dressé. Ce soin porté à l'élévation intérieure se divise en deux étapes séparées par cette ceinture d'assises régulières, qui fait tout le tour du clocher, sur un seul rang.
Il faudrait donc attendre l'étude de Saint-Laurent-des-Combes avant de pouvoir avancer sur les hypothèses d'élévations du clocher qui pourraient être descendues vers 1150 puisqu'à Saint-Laurent-des-combes, comme nous allons le voir, la datation des chapiteaux sculptés renvoie au premier projet de l'église de Bors-de-Montmoreau avant qu'elle ne soit récupérée et transformée en chapelle de route,, soit dans la première moitié du XII° siècle [Le plus récent compte-rendu, avant mon étude sur cette page de blog, rédigé sur le net sur l'église de Saint-Laurent-des-Combes, autour des restaurations de 2015 par une association est curieuse sauf sur la question du transept et du financement. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas retenue en bibliographie. Cependant la datation des chapiteaux est quand à elle beaucoup plus fiable car faite par Jean-René Gaborit, ancien conservateur du département des sculptures du musée du Louvre, qui donne ce groupe sculpté de Saint-Laurent-des-Combes à une veine présente en angoumois dans la première moitié du XII° siècle, en évaluation cohérente avec d'autres avis d'auteurs sur d'autres exemples de la région, tous aussi éminents] En revanche les chapiteaux de Chenaud ne concordent pas avec ces datations car tous postérieurs.
Dans l'attente de l'étude de l'église Saint-Laurent à Saint-Laurent-des Combes (à la fin de cette page) nous pouvons retenir des techniques, des procédés, des styles et des usages qui appartiennent à une même famille romane du XII° siècle [sauf pour ceux de la période gothique bien évidemment].
Le rapport de cette icône d'analyse intérieure à une seconde icône d'analyse extérieure, nous apporte d'autres éléments.
Les éléments qui précèdent ne sont pas encore suffisants pour avancer vers la compréhension du dispositif original du couvrement de l'avant-choeur, de son élaboration progressive, support ou structure basse de la tour de cloche dont la conception globale actuelle se termine par l'établissement de la coupole ressortie en dôme sous comble charpenté, sur deux supports d'ordres différénts (roman et gothique) à au moins deux à trois siècles d'interval.
Pour cela il faut que je renvoie le lecteur à des études antérieures (terminées et sur des églises d'autres pages de ce blog)) et postérieures encore en cours de réflexion et d'élaboration.
Je veux parler de la travée qui associe la fin de l'escalier en vis à a volée "droite" qui monte sur la voûte et sur la coupole, car leurs dispositifs changent selon un cas ou l'autre et Pillac présentant encore sa voie de reflexion.
Je propose donc ici, ci dessous, un jeu d'icônes qui tiennent compte de ces études antérieures et de celles en devenir sur cette page , du début à la fin, si on veut.
ICÔNE
1d - La question de la circulation entre la nef et la chaire.
Bien que la question de la nef sera le prochain paragraphe d'étude de cette église j'ai déjà amené le relevé de sa porte gothique Sud-Est dans l'iconographie globale du périmètre de l'escalier.
Ce qui est certain c'est que cette porte était aménagée bien avant - et peut-être déjà bouchée - que l'on construise une rampe droite d'accès extérieur à la base de l'escalier en vis.
Ces deux fonctions de circulations n'ont rien à voir l'une avec l'autre et n'ont jamais fonctionnées en semble.
Ce qui change tout c'est uniquement l'apport de la chaire qui n'était pas comme nous la voyons actuellement, certainement pas suspendue sans accès depuis la nef.
Il faut d'abord comprendre que la réalisation de cette chaire - si elle se situe entre XVI° et début du XVII° siècle suivant les auteurs - est aménagée dans l'esprit de la Réforme-Contre-Réforme avec un rappel en devise que la parole du prêtre en chaire est celle qui transmet celle du Christ " Iésus Christus In nomine".
Les armoiries qui accompagnent la devise surprennent les auteurs. Peuvent-elles autant nous surprendre après ces lignes " Ainsi, dans la tourmente des guerres civiles, prenait légalement forme un culte nobiliaire et seigneurial. Jamais, dans la France des Temps modernes, pareille dépendance n'avait été aussi affirmée. Les Hauts-Justiciers devenaient responsables d'une cellule religieuse définie par ses fidèles, son lieu de culte et le rythme de ses cérémonies [...] Comment les seigneurs restés catholiques n'auraient-ils pas eu eux aussi le souci de protéger leur Eglise et leur religion avec tout l'intérêt que leur conférait pareille vocation ? La Ligue leur en fournira l'occasion dès 1576." [Cf. Anne-Marie Cocula-Vaillieres " L'église et le château en Périgord et dans les régions voisines XV°-XVIII° siècles" Dans, L'église et le château X°-XVIII° siècle - Sud Ouest - Les cahiers de Commarque. Sous la direction d'André Chastel. Bordeaux, 1988, p. 51 (article p. 45 à 57)]
C'est la période historique post-trentienne pendant laquelle les chaires commencent à remplacer les jubés.
Le cadastre napoléonien, hélas non daté, mais qui a toutes les chances d'avoir été réalisé comme les autres avant 1893 - 1893 étant la date des dernières restaurations de l'église de Chenaud au XIX° siècle - représente bien la sacristie détruite dont il reste le percement de la porte dans le chœur, Ces sacristies bourgeonnantes aux chevets ne sont pas très anciennes dans la région. Elles datent tout au plus du XVIII° siècle et le plus fréquemment du XIX° siècle. Cette sacristie ne peut donc pas être un autre vecteur de circulation par l'extérieur pour un accès à l'escalier, contemporain de la réalisation de la chaire plus ancienne d'au moins un à deux siècles. L'autre décrochement de la façade Sud du plan napoléonien c'est le petit carré de la tour d'escalier qui n'est absorbé par aucune autre construction, dont normalement le plan de l'escalier d'accès extérieur à cette tour carrée, ce qui donnerait en rendu de plan un ressaut rectangulaire et non pas un carré isolé puisque cette rampe droite est ajustée à la face extérieure de la tour d'escalier.
Il faut alors comprendre que la rampe droite, grossière et enduite en ciment moucheté tant sur son mur d'échiffre que sur le parement du mur roman accompagnant la montée extérieure, avec ses marches aux arêtes vives, c'est-à-dire qui ont très peu servies, ne s'accorde guère avec le raffinement des répertoires de la chaire, est beaucoup plus récente et qu'elle n'a été construite que lorsqu'on a projeté ou construit l'escalier intérieur de 1893 et qu'on a créé deux accès séparés à la chaire et à l'escalier en vis du clocher, qui fut un temps confondus à partir de l'intérieur par un escalier qui fut remplacé en 1893 par un monumental escalier en pierre à balustres.
En fait, si toute cette mécanique d'un accès intérieur par un circuit passant par l'extérieur flatte
les esprits rêveurs shakespeariens d'une Juliette apparaissant sur son balcon au clair de lune, en plus à partir d'un circuit passant par une porte gothique très soignée, percée sur le mur gouttereau Sud, mais déjà anciennement murée vue l'usure des appareils érodés par les intempéries de plusieurs siècles, au moment de la construction de cette chaire qui continue le luxe des jubés, il faut comprendre que les prêtres qui utilisaient cette chaire renouaient également avec la solennité du cérémonial de la messe de Saint Grégoire et abandonnaient la représentation de la foi dans les nefs des églises par le vecteur du théâtre des Mystères.
Il faut encore noter que le sol de la chaire est 38 cm au dessous du palier d'accès dans le passage vers le départ de la vis qui est déjà à 63 cm du sol du passage, et, en conséquence, que ce décrochement ne semble pas avoir été pensé comme un emmarchement d'usage courant qui fait plus "tomber" le prêtre dans la chaire qu'il ne l'y accompagne graduellement pour la solennité d'un sermon. Si des marches en bois ont pu faire le lien entre le passage et le départ de la vis, cette question est exclue d'office pour une liaison facilitée entre le sol de la chaire et celui du passage vu l'exiguïté des espaces.
Enfin une dernière question qui n'a pas été encore soulevée mais qui se pose pour une approche plus fine de la datation de la chaire : le garde corps à panneaux rectangulaires qui porte les armoiries et sa devise, plus dans l'esprit classique avant que ses angles soient amortis de quarts de ronds à la période baroque, s'accorde t-il avec le culot de plan polygonal à répertoires très denses de baquettes et profils de petites doucines et petits talons enchaînés, plus dans l'esprit gothique flamboyant que les chapiteaux gothiques plus sages mais aussi sur plan polygonal de la pile contre laquelle la chaire est construite ? [ces deux manières gothiques coexistent du XV° au XVI° s. [On peut consulter à ce sujet Jan Bialostocki, L'art du XV° siècle des Parler à Dürer. Turin 1989, Paris 1993 - le compte rendu des Actes de quatrième Rencontre d'architecture européenne - Paris 12-16 juin 2007 - Le Gothique de la Renaissance - Etudes réunies par Monique Chatenet, Krista de Jonge, Ethan Matt Kavaler, Norbert Nubraun - Collection De Architectura dirigée par Jean Guillaume - Centre André Chastel. Paris, 2007.]
En un mot, avant la réalisation de l'escalier de 1893, cette chaire est-elle déjà la conséquence d'une réalisation en un seul jet ou déjà de remaniements, voire de compositions ?
Les conséquences d'une reprise ou d'une réalisation complète de l'avant-chœur à la fin de la période gothique (XV° s.), dans la configuration qui est actuellement la sienne, nous incite à envisager une incidence sur le choix de l'organisation et du couvrement de la nef,
ainsi que de son étude de manière générale car l'aspect que nous en avons actuellement est intérieurement celui de deux murs construits en petits appareils dissolus qui s'opposent assez violemment avec les beaux grands appareils réguliers (opus quadratum) tant du chœur que de l'avant-chœur.
En revanche le rapport à l'édification extérieure est différent.
Pour amorcer une réflexion qui me semble importante pour avancer sur le cheminement de l'avancée de conception finale de cette église je propose dors et déjà cette nouvelle réflexion par les icônes de ce blog
Cette seconde avancée sur cette page, pour un essai d'approche de la constitution fusionnelle de l'avant-choeur/tour de cloche/escalier, ne doit pas nous faire perdre de vue que d'autres ramifications peuvent se greffer sur l'ébauche de ce tronc commun à plusieurs volets.
En effet d'autres tours de cloches récupérées sont sans articulations directes avec les deux pôles Est et Ouest de l'église, bien qu'elles occupent une position théorique d'avant-choeur comme à Blanzac
[je conserve autant ce peut le cadre géographique de mon étude de base, soit le bassin de La Tude et lisières]
L'ouverture à l'étude sur ce blog des chapelles de routes de la transition XII°/XIII° siècles fait archéologiquement apparaître des possibilités de clochers porches de Bors-de-Montmoreau à Cressac sur la commune de La Genétouze. Si nous passons à des architectures un peu plus ambitieuses et à fonctions paroissiales nous rencontrons la seule église à clocher porche en Sud-Charente à Peudry.
La dimension des églises n'est pas un facteur de choix de ces organisations. La petite église de Saint-Avit ( au coeur du bassin de la Tude) n'a qu'une seule travée de nef et un choeur circulaire, séparés par une tour de cloche sans escalier.
D'autres sources architecturales existent :
-avec les escaliers doubles ou simples en oeuvre en façades occidentales,
- avec les escaliers de fond en comble dont le départ est logé dans les piles articulées des églises à nefs uniques et transepts.
- avec des escaliers qui démarrent par dessus les passages intra-muros entre les bras du transept sur les églises à nef unique.
Si nous nous cantonnons ici aux églises à nef unique sans transept nous devons nous préparer à admettre d'autres organisations transitoires avant la mise en place - qui ne sera finalement définitive qu'au XIX° siècle comme le montre l'église de Curac ou de Gurat que je n'ai aps encore abordée sur ce blog et qui fait pourtant le lien avec certaines organisations de l'architecture carolingienne ciblées à Poullignac - d'autres ressources, ce qui est l'objet de cette page qui va d'abord nous conduire vers l'étude du synoptique de Chenaud, ensuite à Pillac, puis à Montignac-le-Coq, puis à Saint-Laurent-des-combes.
En conséquence, pour une relecture de l'église de Chenaud, compt-tenu des analyses préparatoires ici faites, nous pouvons commencer par proposer ce codage du synoptique jusqu'à l'entrée dans la nef.
Compte tenu de la configuration particulière des étapes de constructions identifiables et de l'importance que leurs observations peuvent avoir sur la compréhension du bâti roman de la région, j'ai préféré étudier plus longuement chaque détail et anticiper ceux de la nef.
Aussi je vos propose un synoptique global de l'état actuel plus bas dans la page après d'autres études.
Chaque église ayant son caractère propre je m'y conforme
c'est là tout l'intérêt de la recherche.
Les phases de réflexion et de recherche m'entraînent dans un synoptique pour lequel une première étape d'analyse des outils de démarrages d'études et de compositions des documents photographiés et dessinés en ont composé une part de l'élaboration, en ouverture. Ce qui est un peu différent de mes méthodes habituelles ou peu à peu élaborées. Disons qu'avec ce nouvel article depuis Cressac jusqu'à Saint-Laurent-des-Combes, j'ai encore recherché des ruptures qui permettent d'avancer, d'aller plus loin tout en restant très prudent. Un chercheur qui met en place ses propres outils et ses répertoires, ne doit pas se renfermer dans ses certitudes, mais, pour être digne de ce nom, évoluer vers la quête de l'inconnu (un peu une reformulation de la pensée de Gaston Bachelard, en préambule de cette page d'étude).
Pierre Courtaud me répétait souvent " Claude, il faut creuser le vide" . et comme il avait raison !
Nous allons utiliser cette méthode et je rends ici hommage à mon défunt ami de recherches, de littérature et de poésie Pierre Courtaud qui a su m'enseigner bien des audaces de méthodes.
Pour ce qui est du vocabulaire de l'architecture je m'en réfère principalement et presqu'exclusivement à celui élaboré par Jean-Marie Pérouse de Montclos pour le Ministère de la Culture : ma pioche, mon mètre et mon compas.
Que je complète pour d'autres approches parallèles à l'architecture en deux documents de référence :
- le Dictionnaire de l'Archéologie de Larousse.
- Les grilles d'analyses des escaliers par la publication du C.E.S.R. de Tours - collection De Architectura.
la nef
Puisque je viens de terminer l'étude des deux premières phases architecturales de l'église - chœur et avant-chœur - par des réajustements de vocabulaires, je veux commencer cette troisième étape par un autre débat de vocabulaire que nous offre l'excellent ouvrage de Jean Secret sur les églises du Ribéracois (Périgueux 1958). A la page 139 cet éminent auteur commence son exposé par une courte présentation de la nef associée à celle de la façade occidentale, écrivant : " La nef. Elle a été probablement voûtée en berceau qui s'est effondré (au XVII° siècle, la nef est dite lambrissée). Les goutterots (sic) élégis extérieurement par des arcs d'applique plein cintre, reliant les contreforts plats (trois de ces arcs subsistent). En 1897 on restaura largement la nef, qu'on couvrit d'un berceau brisé, avec deux doubleaux retombant sur des colonnes engagées à dosserets. Toute la façade occidentale fut alors refaite dans le style saintongeais...(sans qu'on sache si on a recopié l'économie de l'ancienne façade - Architecte Pierre Texier)". Ce terme "élégis" renverrait dans son acceptation du dictionnaire à un mur allégé par une contre-construction d'arcades sur contreforts. Ce qui est exactement le schéma inverse de Poullignac (mais qui semble être celui de Parcoul de la localité voisine) où les arcs sur "contreforts" servent à élargir le plan de l'avant-chœur pour l'édification d'un clocher avec comme conséquence l'élargissement et le renforcement sur plan de la nef pour la voûter d'ogives sur culots. Nous voyons là que pour deux constructions absolument similaires et contemporaines que les appréciations de chantiers sont diamétralement opposées, en tous cas très différentes.
Si nous reconstituons ces arcades extérieures nous voyons qu'effectivement elles suivent mal le plan actuel de la nef et on peut revenir sur la question d'un apport postérieur à la construction du mur plus qu'à un apport contemporain d'allégement des structures.
L'autre aspect qui surprend est celui d'une voûte intérieure sur une largeur de nef somme toute conséquente sans plus d'étais de compensations des poussées, sans que le moindre dévers d'effondrement soit observable; contrairement au chœur les terrains de fondations semblent ici bien stables comme si on avait construit sur le haut du rocher de ce qui servira à une extension en plate forme remblayée et donc instable à l'Est. Il faudrait donc renverser la progression des chantiers avec comme conséquences regarder un chevet réétayé dès les affaissements des lits de pose du gros œuvre par des contreforts extérieurs et intérieurs sous forme d'arcades d'accompagnement construites avec un souci ornemental compensatoire. Ce système nous renvoie, en comparaison, au voûtement baroque de la nef gothique de l'église de Puget-Théniers (église de construction cistercienne sur la période gothique) dans la vallée du Var. La largeur de la nef primitive est telle qu'une absence de contreforts extérieurs interdit toute tentative de voûte appareillée ou en blocage. La solution qui fut trouvée à la période baroque fut la création (sur le modèle directeur Jésuite envoyé de Rome à Nice) de chapelles intérieures dont les murs de séparations jouent le rôle de contreforts intérieurs à l'imitation du gothique méridional (ex basilique Sainte-Cécile à Albi ).
 |
Pour un support bibliographique à cette question des voûtes en berceau,
voire l'introduction à la nef de Montignac-le-Coq, chapitre de cette page
à la suite du prochain chapitre d'analyse de l'église de Pillac. |
Enfin le dernier aspect technique auquel nous aurons à répondre, ou plus exactement à signaler, c'est une très nette différence d'appareillage intérieur des murs gouttereaux associé à un élargissement maximal de l'église sur la nef.
Les archives municipales nous renseignent sur plusieurs points :
- La nef était sous charpente puisqu'en 1688 à l'occasion de la visite canonique du diocèse on lit sur le compte-rendu "nef sans lambris, ny vitres, mal pavée" (sic). En 1888 cette "voûte en lambris tombe de vétusté" [Registre de délibération du Conseil archives de la commune].
- En 1888 la baronne Desgraviers fait un leg testamentaire de 2000 Francs pour faire des réparations à l'église. L'architecte Texier dépose un projet de reconstruction de la façade de l'église, de la construction d'un plafond pour la nef , d'enduits des murs, de remaniement conséquent de la couverture et pour plusieurs autres travaux de construction et de réparations, "tant à l'intérieur qu'à l'extérieur". Les travaux sont effectués à partir de 1893 pour un devis estimatif de 4200 Francs.
Lors de ces travaux des sondages sont effectués sous le contrôle d'un archéologue qui évalue une reconstruction du mur Sud de la nef sur des fondations romanes. Ce qui ne modifierait en rien la largeur de la nef, soit par l'extérieur soit par l'intérieur.
- Un document de 1688, exploité, est estimé en confusion d'un autre monument. Ces informations ne sont donc pas totalement fiables. Reste la lecture archéologique en place.
Pour ce qui est des autres informations données par le document des Archives Municipales de Chenaud nous avons vu l'importance de la relecture archéologique qui nous permet d'avancer sur des voies nouvelles, sauf une précision et qui est d'importance : le mur Nord sous arcade de l'avant-Chœur a été reconstruit par Mr Ribière. A cette occasion une niche avait été découverte sous le plâtre. Cette niche étant encore en place on peut estimer que cette "reconstruction" n'affecte pas la largeur originale de l'avant-chœur sous arcade qui est actuellement de 6,10 m et qu'une réduction bilatérale par deux premiers arcs (avant la construction de l'arc gothique) amènera sensiblement à la même largeur que la travée droite du chœur. En ce sens nous pouvons entrevoir que les murs sous arcades construits en grand appareil régulier sont anciens, voire très anciens. Cette largeur de 6,10 m est celle que nous retrouverons exactement à Montignac le Coq mais pour une largeur de la nef qui est elle-même, à l'origine et par delà les importants remaniements postérieurs à son édification, construite en petit appareil dissolu sur ses deux faces. Cette technique de construction serait pour Jean George un repère d'édification avant l'an 1000, ou pour le moins un repère qu'il avance pour d'autres églises de son étude sur la Charente, comme il le publie pour l'église de Mouthiers : "Ce qui est certain, c'est que presque toutes les travées de la nef présentent, sur leurs deux faces, du petit appareil, permettant de croire à une église antérieure à l'an 1000..." [ Cf. Jean George, 1933, op.cit., p.176]. Dans leurs publication commune de 1928 Jean Georges et Alexis Guérin-Boutaud écrivent p. 117 : " Une autre remarque à faire , c'est que l'appareil soigné se trouve plutôt sur les nefs avec voûtes ; et l'appareil simple, sur les édifices pauvres et non voûtés". Mais là encore cette question va revenir sur la table des questions archéologiques par la dernière église sélectionnée de ce groupe d'étude, soit avec l'église Saint-Hilaire à Montignac le Coq.
A Chenaud il faut ajouter une nef aveugle, sans autre éclairage probable que celui d'une ouverture sur la façade. Mais comme nous ne savons rien de la façade ce ne peut être qu'une hypothèse.
Nous voici arrivés sur la seconde rupture de méthode à titre d'essai.
Cet essai consiste à reprendre la chronologie à l'envers. C'est-à-dire en considérant que ce n'est pas le chœur la partie la plus ancienne de l'église mais que c'est la nef et pour cela j'ai un argument de poids avec une publication de la Société archéologique et historique de La Charente.
Spontanément le plan nous fait penser à celui de Chenaud, mais il faut le relire avec les analyses de Pierre Dubourg-Noves. Déjà l'escalier en vis est une invention du dessinateur car cet escalier n'existe pas (sic) " Cette nef mesure 6,76 m de large sur 9,80 m de long dans œuvre [à Chenaud la nef intérieurement mesure 6,71 m de large pour une longueur qui sera rectifiée en cours d'étude pour 8,20 m actuellement]...les murs sont minces [à Chenaud les murs fond 0, 85 m ce qui est "mince" pour des murs romans]...Deux ressauts, à l'Est de cette nef couverte d'une charpente maintenant comme à l'origine, déterminent un chœur plus étroit sensiblement carré en plan, également bâti en moellon...Ces dispositions, comme il en existe encore de semblables dans la partie rectiligne du chœur de Jarnac, grand monument du premier art roman,, ceux de bougneau et de Saint-Thomas de Conac, précédaient sans doute une simple abside." (p.23).
Ces dimensions à Chenaud vont nous permettre de nous orienter vers des remarques utiles, en plus d'une absence de dévers des murs gouttereaux qui restent parfaitement droits pour des arcs de contreforts largement disparus ou jamais construits (?) [Rque. Jean George publie des plans d'église à nefs voûtées sur arcs doubleaux, sans contreforts extérieurs pour des murs relativement fins et des organes de supports intérieurs qui compensent assez peu la faiblesses des murs (?)] .
Nous allons maintenant reprendre l'ensemble de ces informations avec les relevés du premier synoptique que je propose pour cette église de Chenaud.
Vous l'avez donc compris, nous allons maintenant redémarrer à partir de la nef comme un ancrage partiel de départ sur quelques observations déjà citées, puisées dans l'article de Pierre Dubourg-Noves. Pour continuer une articulations quasi naturelle à ce départ par la nef je serai amené à faire encore quelques analyses que seules quelques figures du synoptiques permettent.
Les arguments se succèdent et s'accumulent pour donner à la nef et à un choeur carré le premier état architectural de l'église consacrée en 1100, sans pour autant exclure des investissements du culte païen antérieur vers lesquels nous orientent des éléments déjà exposés et qui rencontreront de nouveaux arguments sur d'autres sites de la région. Toujours est-il que l'église offre déjà une orientation cardinale déjà très proche de celle des églises médiévales soit une façade d'accès au monument à l'ouest et un chevet/choeur à l'est (tourné vers le tombeau du Christ) ce qui donne des murs gouttereaux et des bras de transepts (lorsqu'ils existent) au Nord et au Sud. Curieusement on rencontre cette même tendance sur un site de culte païen, sur la région.
La lecture du synoptique nous montre une façade totalement refaite et des arcs fracturés sur les murs gouttereaux Sud et Nord. La Fracture de ces arcs n'entraine pas de modification notable des murs principaux récepteurs. C'est un peu comme à Parcoul (église voisine). Mais c'est aussi ce que nous avons déjà observé à Poullignac. Sauf qu'à Poullignac il existait une structure de chapelles intérieures (l'héritage des arcades des péristyles des atriums) dont les divisions pouvaient déjà constituer des contreforts intérieurs pour des installations de voûtes. Ce dispositif n'existe pas à Chenaud.
En revanche l'arc Sud-Ouest extérieur n'est pas complet puisque l'arc n'a pas d'imposte de réception à l'Ouest. C'est que cet arc était plus ample et avec le pilastre de réception donne une autre configuration à la façade tant vue de face que de profil. Si ces arcs sont plaqués et non pas construits en même temps que les murs c'est qu'ils n'étaient pas prévus dans le projet original et que l'organisation architecturale de la façade ne prévoyait pas leur intégration, d'où une nouvelle façade au XIX° siècle qui absorbe ces arcs débordants au sacrifice de leur ampleur puisque ces arc ne servent plus à rien sans des voûtes autres que celles actuelles en plâtre.
Les murs gouttereaux font tout de même un mètre d'épaisseur, et un peu plus (conversion des mesures anciennes en système décimal des instruments de relevés). Ces murs relativement épais, comme dans les châteaux, ne signifient pas la présence de voûtes ni de chemins de rondes, mais peuvent se justifier par le système des charpentes à arbalétriers faisant chevrons - avant l'apparition des charpentes à pannes - majoritairement employés sur les grands monuments. Ces charpentes sont très lourdes et elles ont besoin d'une certaine épaisseur de murs pour les supports des larges sablières.
ICÔNE
Ainsi, la réponse à la question d'une nef voûtée semble difficile sans apports intérieurs complémentaires. Ce qui pose aussi la question de la lecture intérieure des nefs voûtées en termes de travées car l'habitude prise par de les archéologues et les historiens d'art de donner des comptes rendus par les travées, ce qui semble tomber sous le sens, est un abus.
C'est encore une question et une observation qui devra être analysée par le constat archéologique tout au long de cette recherche qui s'émancipe une fois de plus à partir de Chenaud. En effet nous rencontrerons à Saint-Laurent-des-Combes une nef voûtée sans pile articulée ni colonne, et qui est en plus une nef à deux étages (mais laissons le cas architectural extrêmement riche et transitoire de Saint-Laurent-des Combes, qui viendra naturellement à partir de Pillac et de Montignac-le-Coq et qui repartira à son tour dans une autre direction). En revenant à Chenaud et à cette question des voûtes nous remarquons la faible épaisseur des murs du choeur plat ( voir plan du synoptique) et donc la question ne se pose plus mais inverse le schéma habituel d'une nef charpentée ou planchéiée pour un choeur voûté.
La réflexion finale la plus raisonnable - la raison n'appartenant pas qu'au XVII° siècle - serait d'envisager un premier petit bâtiment charpenté tant sur sa nef que sur le choeur.
Les gens du village signalent tous une nef plus longue. Les arcs interrompus à l'Ouest semblent confirmer cette observation, sauf si ces arcs sont postérieurs à la construction de la façade et que cette façade par la contrainte du débordement de ces arcs n'intègre plus le principe d'une "belle façade".
D'où la nécessité ressentie lors des réfections de la fin du XIX° siècle - alors que la France était encore très riche - d'inventer une nouvelle façade qui prenne en compte tous les avatars des siècles antérieurs; celle que nous voyons de nos jours qui, une fois nettoyée, devrait réapparaître dans toute l'élégance de ses conception, comme on pouvait la concevoir au début de la recherche et de la connaissance de l'art roman dans les mouvements romantiques et symboliques.
nous poursuivons sur le premier choeur
Le lecteur aura remarqué qu'il n'y a aucun éclairage latéral de la nef. Cet éclairage intérieur de l'église ne peut provenir que de la façade occidentale et du choeur. La réduction du volume du choeur - qui a tout l'apparence d'une travée droite de chevet plat - est éclairée par deux fenêtres latérales qui seront regarnies au fur et à muse qu'on épaissira ses murs latéraux, comme nous l'avons déjà analysé avec les arcades successives. Le mur Est étant disparu nous ne pouvons rien en dire. Les dimensions des largeurs ayant été déjà données ont voit la parfaite cohérence architecturale en réduction de la nef.
Toute la construction de la première église est en petit appareil dissolu sauf le choeur qui reçoit un traitement de parements plus soignés en opus quadratum quasi régulier.
A ce stade les dimensions de cette petite églises sont les suivantes :
 |
| Les modifications finales par l'apport successif de deux arcades - une à la période romane (fin XII° siècle) et l'autres à la période gothiques (XV° siècle) vont réduire successivement la largeur du choeur 5, 19 m, jusqu'à rejoindre le plan quasi carré ( 5,10 x 5,19) sur lequel sera monté la coupole entre une pile articulée romane et une pile articulée gothique. |
Nous poursuivons sur le second choeur.
En apportant deux arcs de 0,25 cm de chaque côté du choeur les bâtisseurs créent la condition favorable à la modification du premier choeur par un second choeur. C'est-à-dire une condition plus favorable à la réception d'une voûte en berceau à partir de murs élargis, donc plus puissants, pour un espace intérieur moins large à couvrir sur une longueur qui n'excède pas la profondeur du premier choeur.
Tout se met en place pour une transformation du choeur en avant-choeur si on créé un nouvel espace en arrière du premier choeur. Ce nouvel espace qui allonge l'église est couvert d'une voûte en cul de four dont la hauteur en extrados répond à une articulation avec l'arrivée de la petite volée droite intra-muros (avant modification gothique par l'apport d'une nouvelle épaisseur de ce mur issu du choeur - voir les analyses déjà présentées des arcades de l'avant-choeur dans son état actuel).)
Cette voûte de l'agrandissement par le nouveau choeur est articulée à ce qui devient une travée d'avant-choeur séparée du choeur par un ordre roman déjà présenté et analysé. Ce qui constitue finalement une unique voûte en berceau qui se prolonge dans un même alignement sous le nouvel espace voûté du premier choeur modifié, en deux travées d'inégales longueurs soutenues par un arc sur ordre roman qu'on rencontre fréquemment dans la région à partir de la seconde moitié du XII° siècle. Et on remarquera que si l'escalier est construit dans le ressaut extérieur du passage de la nef au choeur du XI° siècle, que la volée monte directement sur la voûte et contre le mur Ouest du clocher, comme à La Genétouze, ce qui nous oriente vers un premier clocher d'origine avant les remaniements gothiques. D'où un codage sur synoptique qui associe pour les murs du clocher une période romane et une période gothique au minimum plaquées l'une sur l'autre. Comment cette voûte en berceau s'articule avec le passage en nef est une question à débattre mais on ne peut absolument pas la faire continuer sur la nef trop large vu qu'on a déjà rétrécit la largeur du premier choeur pour l'installer. La seule chose que l'on peut dire c'est qu'il y a eu là une solution qui sera reprise en ordre gothique, après une seconde réduction de la largeur du premier choeur, ramenant le plan vers le carré pour l'installation de la coupole à la fin de la période gothique.
Il est fort probable que c'est à partir de cette période de remaniement et d'agrandissement assez luxueux de la partie Est de l'église, avec un programme sculpté de la veine de celui de Rioux-Martin et de la Haute-Lande, plus un décor peint intérieure principalement en faux marbre (colonnes du choeur) qu'on a cherché à faire suivre ces modifications sur la nef sans y parvenir, en risquant une solution sur péristyle comparables à celle qui entoure le choeur d'arcades intérieures et extérieures mais sans ornements sculptés. Bien sûr cela ne peut être qu'une hypothèse mais tangible lorsqu'on apporte un tel soin à l'agrandissement d'un monument du culte. Comme déjà dit la façade primitive ne prenant pas en compte ces débordements d'arcades ajoutées et la nef n'est pas divisée en travées. Cet axe de recherche semble d'autant plus pertinent que nous abordons maintenant la partie gothique de l'édifice où le choeur primitif est une nouvelle fois réduit de 2 X 25 cm pour obtenir un plan quasi carré de 5,10 x 5,19 m.
Le choeur de la phase 1 déjà avancé vers un avant choeur de la phase 2 de la construction de l'église, se constitue en véritable tour de clocher et avant-choeur, confondus, divisant clairement l'église en ses trois organes architecturaux principaux : nef - avant-choeur - choeur.
La Scolastique arrive bientôt à sa première maturité d'intégration de l'antiquité tardive à la pensée médiévale, peu à peu élaborée dans le sein des évêchés pour former l'esprit scientifique occidental, l'université au siècle suivant, et nous en avons l'écho par le vocabulaire de l'architecture antique qui s'applique aux mouvements de l'art roman à Chenaud qui a fait "table-raze" du monde païen et de ses pratiques qui persistent malgré tout ancrées sur les versants de la terrasse réaménagée, certes, mais conservant son implantation d'origine liée aux sources et quelques peintures en réemplois sans aucune intention de culte; même tellement cachées qu'il aura fallu cette présente recherche pour les remettre à jour, en attente d'une identification finale de laboratoire, demandée.
La période gothique du chœur devenu avant chœur vers la fusion avec la tour du clocher.
Le plan évolue une dernière fois (avant les "restaurations du XIX° siècle) et la partie inconnue de transition entre l'ancien choeur et la nef prend forme par la construction d'une pile gothique par les répertoires, certes, mais qui semble reprendre certains éléments d'un probable ou improbable formeret plus ancien, ayant appartenu à la première ou à la seconde construction intérieure de l'église. Toujours est-il que cet arc de même largeur que l'arc roman mais profilé différemment, est porté par des demi-colonnes sur dosserets qui semblent construits de neuf dans les proportions de la pile articulée romane mais dont seules les bases et les chapiteaux font la plus grande différence de celles romanes de l'entrée dans le nouveau chœur. Quoiqu'il en soit les projections en avant des dosserets tant d'esprit roman que gothique reçoivent une nouvelle épaisseur de mur sur arcade de même épaisseur que la première et constitue en tout un arc de 50 cm de chaque côté diminuant d'un mètre la largeur initiale du premier choeur, soit pour l'obtention d'un carré presque parfait comme déjà dit de 5,10 x 5, 19 m propre à recevoir la substitution du berceau de l'avant-choeur - de la phase 2 de la transformation de l'église - par une coupole quasi régulière sans oculus - phase 3 de la modification de l'église.

Mais ce changement de programme entraîne d'autres bouleversements et notamment au niveau de la configuration de l'escalier du clocher dans son arrivée sur la coupole.
Ainsi obtient t-on le plan final de l'église sauf que la nef s'émancipe de l'incertitude des analyses puisque tout compte fait ces arc extérieurs plaqués contre les murs gouttereaux de la nef peuvent très bien appartenir à un chantier du XV° siècle bien qu'ils n'en n'aient pas d'évidence le caractère. En revanche, ce qui est certain c'est qu'ils n'étaient pas laissés en état de construction ou d'inachèvement - s'ils étaient déjà construits - alors qu'on avait apporté autant de soin à la modification de l'avant-choeur vers l'apport d'une chaire monumentale sculptée d'une multitudes de répertoires qui pourraient appartenir au gothique de la fin du XV° ou du début du XVI° siècle alors que le garde corps de la cuve avec ses tables sculptées en réserve est franchement d'un esprit plus plus tardif.
Avant d'en revenir au plan définitif il faut signaler le percement d'une porte vers les XIII° ou XIV° siècle, en partie orientale du mur Sud de la nef. Mais il faut aussi revenir à la nouvelle organisation des parties hautes et basses de l'escalier.
En parties basses, l'accès en hauteur n'est pas modifié mais il s'articule avec la cuve de la chaire, par laquelle on accède à la phase 1 de l'escalier en vis, soit à son accès par un passage plat et droit. Et, on remarquera que le peu d'intérêt qu'on a eu d'ajuster les sols de la cuve et du passage par une emmarchement d'un hauteur de 45 cm. (question déjà débattue) avec l'apport de la rampe droite au XIX° siècle lorsqu'on a fermé cet accès direct de la chaire à l'escalier par l'intérieur (c'est un peu ce qu'on retrouvera à Pillac mais fort heureusement l'escalier extérieur n'a pas été construit, la défiguration du monument à été plus contrôlée malgré une reconstruction complète de la nef).
Si en partie basse le passage plat d'accès de l'escalier à la chaire a dû être allongé de la valeur des deux arcs d'épaisseur des murs Nord et Sud de l'avant-choeur, il est en de même avec le passage en travée droite de l'escalier assurant la liaison entre la fin de la vis et l'accès au comble de l'avant-coeur déjà constitué en clocher sans encore de structure de tour clairement définie de fond. Sauf que l'épaisseur du mur à franchir est diminuée de moitié puisque cet escalier a été construit pour servir la phase 2 de la modification de l'église et ne concerne pas la phase 3, phase gothique de fin de réajustement de l'ancien choeur en carré pour coupole. En conséquence il faut allonger cette travée droite d'escalier pour franchir la totalité du mur Sud (comme les fenêtres de ces murs qui ont eu leurs ébrasements modifiés) . A la sortie sur la coupole subsiste à l'Ouest l'ancienne montée sur le berceau mais les techniques de constructions évoluant on construit une seconde volée droite qui ne prend plus pour assisse le mur Ouest du clocher mais le mur Sud. Et ce changement de l'arrivée des escaliers de combles sur les coupoles va se généraliser à tel point qu'aucun escalier de coupole - non modifié, relevé dans l'inventaire de cette recherche - ne monte directement sur la coupole mais s'installe dans le creux des reins de la coupole entre un mur Sud ou Nord, c'es-à-dire monté de fond et non pas repris depuis un arc de transition interne. Même à Saint-Laurent des Combes où l'escalier de clocher a tendance à s'émanciper du mur porteur Nord, on voit qu'un aménagement particulier limite l'emprise sur la coupole et le "raccroche" au premier niveau d'élévation Nord du clocher à deux niveaux.
Nous avons donc là un point de repère important pour poursuive cette recherche sur la formation des avant-choeur et les tours de cloches fusionnées, couvertes en coupoles qui succèdent suivant l'ordre de La Génetouze et de Chenaud aux couvrements en berceaux, bien que le couvrement de Saint-Laurent-de-Combes en coupole semble le plus précoce.
On peut avancer avec prudence, certes :
- que le clocher de Chenaud est le résultat des constructions combinées des élévations romanes puis gothiques à partir d'un choeur directement articulé à la nef (phase 1).
- que les différences d'appareils entre le bas et le haut du clocher, qui répond partiellement à celui de l'intérieur de la nef, est un choix propre à accrocher des enduits récepteurs de décors peints déjà présents à l'intérieur dans le choeur.
Et on arrive à la fin du XV° siècle
PILLAC
Eglise Saint-Aignan
Archiprêtré du diocèse de Périgueux - Arrondissement d'Angoulême - Canton d'Aubeterre.
Sud-Charente - Secteur Est du bassin de La Tude
Des dates du XIII° siècle, secteur d'Aubeterre, qui précèdent celle du document d'archives de 1365 [Cf. Georges Thomas, Cartulaire des comtés de la Marche et d'Angoulême - Société Archéologique et Historique de La Charente. Angoulême 1934]
1246 : "P. vicomte de Castillon, fait hommage lige à Hugue le Brun, comte d'Angoulême, du château et de la ville d'Aubeterre et lui donne les pleiges pour cinq cents marcs d'or (n°LVIII)." (p. 13).
1246 et 1254 : texte latin "Littera vicecomitis Castellionis de castro et villa Albe [terre]. (p.566). (p.126). On remarquera l'origine du nom d'Aubeterre : terre blanche.
1254,17 mars Angoulême : " Confirmation de la chartre de 1246 où P. vicomte de Castillon, fait hommage à Hugue le Brun, comte d'Angoulême, du château et de la ville d'Aubeterre (n° LVIII)" (p. 15)
Bibliographie
Abbé J.H. Michon, Statistique Monumentale de la Charente. J.H.Michon Correspondant du Ministère de l'Instruction Publique pour les Travaux Historiques, membre de La Société Française pour la conservation des Monuments Historiques. Angoulême 1844, p. 274. : "Pilhac : Abside voûtée. Portail à ornements géométriques. Nef dont le lambris est peint en décoration dans le genre italien. Ce travail est de 1684 : il est fait avec assez de soin. Le sujet du milieu représente une Assomption" (sic).
Bulletin de la Société Archéologique de Charente, Angoulême 1862, p. 258.
Jean George, Les églises de France - Charente. Paris 1933, p. 191 et 192. Aux relevés archéologiques contemporains pour cette étude, le commentaire de Jean George surprend, bouleversant l'ordre architectural, faisant passer l'avant- chœur (appelé "carré") entre le transept et l'abside du chœur " Les bas-côtés qui ont été prolongés sur les croisillons" ce dispositif si tant est qu'il eut existé se trouverait actuellement, selon ce descriptif, en avant de ce que l'auteur appelle "le carré", donc pas du tout sur une croisée de transept. Je signale cette originalité de rédaction car c'est là le principal intérêt de cette église très singulière mais combien importante pour apporter une premier fin d'étape à l'évolution que nous suivons depuis l'exemple des monuments du bassin de la Tude appelés en renforts des études des non moins importants monuments de La Genétouze, à condition de remettre ses organes d'architecture en leurs places et fonctions. L'Abbé Michon ne s'y aventure pas.
Toujours est-il que nous voyons là combien cette église a surpris les rares auteurs qui s'y sont confrontés.
La surprise est moins grande si on va à la rencontre archéologique d'autres monuments du secteur géographique de cette vaste dépression dans laquelle l'église de Pillac a été édifiée avec un clocher pour un chevalet à 4 cloches et 2 cloches (encore en place) à Montignac-le-Coq. Mais nous verrons que les questions posées entre ces deux églises sont très différentes puisque l'une est l'effet de plusieurs modifications et que l'autre semble avoir été plus projetée en un seul chantier.
La chaîne d'études et de présentations des monuments sur cette page a aussi pour effet de clarifier l'émergence de cette architecture singulière à Pillac qui semble ne pas avoir eu localement de suite dans l'art roman sinon des aspects qui peuvent se retrouver dans le périmètre de Pillac à Montignac-le-Coq et fermer la boucle avec les monuments de La Genétouze par une autre variante de l'emploi du contrefort oblique, dont l'articulation avec l'art gothique de la région semble très improbable dans l'état actuel de l'étude archéologique des inventaires.
Ci dessous : vue de Pillac dans la vaste dépression depuis Montignac-le-Coq en sentinelle sur une crète qui borde l'Auzonne affluent de La Dronne.
Configuration générale actuelle du monument
synoptique
Les premiers éléments mis en place font apparaître, entre le cadastre de 1838 et la publication du texte de l'Abbé Michon en 1844, que la nef avait déjà été agrandie de deux collatéraux et on peut supposer que c'est sur la nef centrale que portait l'essentiel du décor peint signalé par l'abbé Michon. La nef a été une nouvelle fois remaniée pour remplacement du lambris par une voûte sur la travée centrale (fig.9 du synoptique ci dessous). Ce second chantier pourrait être contemporain de celui dont la date figure sur la coupole de l'avant-choeur, soit 1881 [Cette coupole n'a pas été refaite mais uniquement "réparée" ou plus exactement réenduite et redécorée de l'intérieur comme en atteste son épaisseur propre à soutenir le très important et très lourd dispositif du chevalet des 4 carillons du clocher, sans doute à l'origine de ce choix de puissants contreforts d'angles] dont celui très ingénieux faisant office de tour d'escalier en vis hors œuvre, rendant cet escalier invisible depuis l'extérieur hormis par deux petites fenêtres d'éclairage de la cage - voir figures 1, 8 et 11 du synoptique ci dessous - Ce hors œuvre rejoignant un peu l'esprit du en œuvre de Rioux-Martin. Ce qui montre aussi le changement d'attitude de l'architecture française et de la fonction de l'escalier dans le royaume : à la période romane l'escalier est un organe de service sophistiqué qui s'associe peu à peu à l'avant-choeur et lui fait tenir le rôle mixte de tour d'escalier et de tour de cloches dans l'architecture religieuse, alors qu'à partir du quatrième quart du XV° siècle dans l'architecture civile (qui peut aussi être celle des demeures des ecclésiastiques - l'escalier devient en quelque sorte l'orgueil des façades des petits châteaux résidentiels et des recherches de portails d'entrées survalorisés - ]. Lui même contemporain du chantier de la sacristie qui ne figure pas non plus sur le cadastre de 1838 (figs : 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 du synoptique).

Il faut, en conséquence, lire le premier état du synoptique ci dessous en fonction de ces premières observations car à la simple lecture du relevé des incohérences apparaissent dans les piles de la nef et contraignent l'archéologue à un codage différent pour les piles Nord et Sud des ouvertures collatérales de la nef centrale; compte tenu des alignements romans fixés par la façade d'origine au moins dans son rez-de-chaussée rythmé par un niveau d'arcades totalement romanes où on remarque, entre l'extrados des arcs et le soffite de la première corniche, un opus vittatum d'héritage carolingien [Remontée des techniques de constructions romaines Cf. Abbé Gabriel Plat, L'art de bâtir en France, des Romains à l'an 1100, d'après les monuments anciens de l'Anjou et du Vendômois. Paris, 1939].
Synoptique de l'état actuel de l'église avec premières estimations par codage.
Pour que ce synoptique soit un outil d'étude il faut d'abord qu'il soit clairement lisible après en avoir montré le principe par une vue d'ensemble. Je vais maintenant le décomposer suivant les quatre phases codées produites en prédelle qi nécessiter d'autres regroupements de figures.
Phase 1 - le chantier roman codé :
Le parti pris architectural est celui d'édifier une puissante tour capable de soutenir une pièce haute avec la très lourde structure d'un chevalet pour quatre cloches "AB".
On commence donc par concevoir cette structure épaulée de quatre contreforts d'angles dans le même chantier de maçonnerie des faces plates Sud et Nord, percées des ouvertures, comme le montrent les rangs de grands appareils quasi régulier bien alignés du bas en haut de la structure. Cette structure qui forme intérieurement avant-choeur, se termine par une pièce de clocher déjà conçue avec au Nord la grande baie d'entrée des cloches et une structure complémentaire de chevalet en bois parfaitement adaptée à l'entrée et à la manipulation des cloches tant depuis l'extérieur qu'à l'intérieur de la pièce.
On accède à cette pièce haute par un escalier en vis aménagé dans un contrefort d'angle Sud-Ouest élargi, tout comme le mur qui relie les deux contreforts Sud (voir l'étude de l'escalier de conception romane qui est présentée un peu plus bas). Pour obtenir un plan carré de la pièce haute du clocher on construit un très puissant arc à l'Ouest qui reprend les arrivées obliques des contreforts et les amènes sur plan carré par deux portions de murs en "triangles" régulateurs du plan (entre "E" et "A") issu du prolongement du demi-cercle de l'abside romane sans contrefort. Le tout est construit imbriqué dans le même chantier "B" avec un couvrement de l'avant-chœur en coupole sur plan ovale sous un tas de charge composite puissant qui est aussi le plancher du clocher. Les murs Est et Ouest du clocher sont portés à l'Ouest par le gros arc "E" et à l'Est par la multiplication des arcs de transition avant-chœur-chœur "E' " tel que nous en avons dégagé la fonction avec l'étude de La Genétouze.
En plus le gros arc "E", par lequel on fait l'économie d'une pile d'articulation avec la nef, est du type de celui de Saint-Amant de Montmoreau construit pour élargir l'articulation de l'avant-choeur avec une nef charpentée ou planchéiée.
Une petite pile carrée subsiste contre la structure du gros arc en son angle au Sud-Ouest avec la naissance de la courte partie droite qui conduit à la nef élargie, mais il est impossible de l'interpréter sauf en vestige d'un des supports du plancher ou de la charpente de cette courte partie droite avec la nef élargie dont ne subsiste que le souvenir en "F".
Au bout de l'alignement "F" on retrouve le chantier roman par la partie centrale de la façade qui se trouve décalée de l'axe de l'abside et de l'avant-chœur et qu'un alignement "J" rétablira lors de la modification de la nef : premier chantier de la transformation de la nef, appréhendable en méthode archéologique.
Cette façade est d'origine romane jusqu'à la première corniche. Elle est composée de trois arcades et le manque de soins aux appareillages internes vont dans le sens d'un apport d'enduit ornemental à figures, tel que nous pouvons encore en voir un fragment original en façade de l'église de Saint-Hérie à Matha (Charente-Maritime).
Au-dessus de cette rangée d'arcades la maçonnerie est du type opus vittatum. Cette référence à l'héritage antique surprend, tout autant que l'élévation de la façade en gâble au-dessus de la corniche qui a perdu ses modillons (sauf deux aux extrémités). Les probables colonnes d'angles n'existent pas non plus. Il y a alors deux possibilités : - soit la façade était très simple (avec ou sans colonnes ou colonnes disparues avec les archivoltes) avec un ornement peint sur enduit ou sur le mur brut comme Eliane Vergnolle en signale des caractéristiques régionales, voire nationales, et que nous retrouvons en portique de l'église de Challignac (secteur Est du bassin de La Tude - Diocèse de Saintes),
- soit la façade avait un apport en stuc en relief blancs ou colorés. Le blanc étant, d'après Eliane Vergnolle, la couleur la plus fréquente comme vu en début d'article avec la chapelle de route de Cressac.
Cette cohérence de la façade avec l'élévation du clocher est encore un argument pour comprendre que cette élévation sur gros contreforts de l'avant-chœur-tour de cloches avec escalier intégré dans un contrefort est le même et unique chantier roman, en plus des caractéristiques romanes de l'escalier que nous verrons plus bas.. En revanche si nous trouvons des réminiscences de l'art romain avec l'opus du premier niveau de la façade, nous pouvons voir, ce qui est généralement admis par les auteurs, que la présence d'un gâble est de vecteur limousin, voire Périgourdin avec le clocher roman de Brantôme. Ces gâbles ne sont pas fréquents sur le département de la Charente : un de la période romane en élévation de la tour de cloche de Blanzac, un entre XV° et XVI° s. en décor du portail du petit château résidentiel de l'abbaye de Bourné, et un dont l'origine pose question en façade de l'église de Vaux la Valette. En revanche, pour exemples, on les rencontre plus volontiers en chevets des élévations de la transition roman-gothique à Poullignac et du gothique flamboyant à Chevanceaux (Sud-Ouest Charente). Si ce gâble de façade a une origine romane à Pillac, et l'étude de reconstitution d'un premier état de l'église ne s'y opposera pas, le changement d'appareil entre le rez-de-chaussée et l'élévation au-dessus de la corniche pourrait se justifier par le choix d'un site orné d'une grande fresque en frontispice dont l'irrégularité de l'appareil serait un facteur d'accrochage des lourdes préparations de mortiers, ce que nous retrouvons probablement pour deux états des murs des travées droites du chœur de Saint-Amant-de-Montmoreau articulées avec un avant-chœur qui fut entièrement peint mais vraisemblablement au XIV° siècle [l'étude est encore en suspend sur ce blog à la page Saint-Amant-de-Montmoreau]).
Nous pouvons donc commencer à associer pour poursuivre l'analyse
F J
Il faut d'abord poser une première icône pour comprendre la suite du raisonnement pour les codages. L'icône des alignements primitifs entre la façade et l'avant-chœur. Comme c'est très simple c'est facile à comprendre :
T
ous les lits de pose ainsi que la taille des grands appareils réguliers étant parfaitement cohérents, de même nature et régulièrement alignés sur tout le périmètre du bâtiment, tant des contreforts qu'aux murs entre les contreforts, nous avons la certitude, en plus d'un escalier roman dans un contrefort élargi d'origine, que cette tour à quatre contreforts d'angles qui intègre l'avant choeur et un escalier en vis à entrée d'origine intérieure dans l'avant-choeur, est purement une construction intégralement conçue et édifiée à la période romane avec une coupole en avant-choeur. Il n'y a ici point d'autre période de construction que les abus d'aménagements comme cette ouverture extérieure sur le contrefort qui défigure totalement cette très belle unité absolument rare (au moins dans la région). Sans bien sûr parler de la nef entièrement refaite mais qui se justifie peut-être par un accroissement de la population. Il n'y a pas non plus de trace archéologique de transept roman, ni moderne. Donc tant les parties murales qui assurent le relai avec le plan à quatre contreforts d'angles que le plan, que le chevet, sont purement du même chantier roman. Et ce dispositif est parfaitement aligné avec les limites de la façade romane à arcades.En revanche il n'en n'est pas de même pour les divisions intérieures modifiées de la nef.
Etude de l'escalier
Par ces trois icônes nous pouvons exposer une seule et unique réflexion totalement originale à la construction romane, de fond en comble, en plus des liens des appareils extérieurs entre les murs droits et ceux obliques des contreforts qui prouvent à leur tour un seul et unique chantier jamais modifié, sauf par une nouvelle entrée dans l'escalier en vis et condamnation de l'ancienne entrée par l'avant-choeur..
L'arrivée de cet escalier dans le comble du clocher - pièce haute des cloches - est rompu. Elle est remplacée par une échelle en fer. Mais le lien par les travées de l'enrouement des marches sur le mur de la cage d'escalier est parfaitement visible et on voit cet escalier arriver directement dans le passage plat - animé par une seule marche - légèrement oblique vers l'est, qui arrive à la base d'une travée droite d'escalier qui longe le mur Sud du clocher et arrive un peu au dessous de la clé de voûte de l'extrados de la coupole sur lequel repose le chevalet de cloches.
Donc, on remarque que cet escalier logé dans le rein Sud de la coupole prend appui sur le mur plat Sud du clocher qui monte de fond. Vu la position du contrefort qui fait office de tours hors oeuvre de l'escalier en vis, la travée droite qui monte jusqu'au niveau du fait de la coupole aurait très bien pu être construit en longeant le mur Ouest du clocher. Sauf que ce mur Ouest est construit sur l'arc de transition entre l'avant-choeur et la nef. On a donc sélectionné le mur Sud qui monte de fond pour épauler cette travée droite de l'escalier et ainsi reprendre la solution de Chenaud lorsqu'on a remplacé le berceau par une coupole.
Les escaliers romans d'origine - repérés et relevés sur ce blog - suivent donc toujours cette règle d'un passage d'entrée en hauteur depuis l'avant-choeur vers la base d'un escalier en vis qui monte vers un passage à travers le mur d'élévation du gros oeuvre - qu'il soit en oeuvre ou hors oeuvre - et bascule contre le mur Sud ou Nord qui monte de fond (A Rioux-Martin la travée droite amorce cependant un coude qui fait tourner cette travée droite d'escalier sur une courte longueur contre le mur Est du comble du clocher)
Nous avons donc à Pillac une tour romane, complète ou quasi complète, totalement construite de façon autonome. Le chevet à l'Est et la nef à l'Ouest venant se greffer sur cette tour de clocher-avant-choeur-cage d'escalier, et nous comprenons que c'est là que se situent les point de ruptures les plus probables - d'apparitions de lézardes qui peuvent cependant se répercuter sur le haut du clocher, ce qui a été le cas en angle Nord-Ouest mais qui a tenu depuis la période romane alors que le nef a disparue (naturellement ou artificiellement) et que le choeur était en très mauvaise situation il y a peu de temps encore.
Le cas - comme je l'ai fait avec Chenaud et ce paragraphe en est un complément qui montre la richesse du sujet - mérite d'être questionné plus avant sans pour autant voir là une digression puisque ces aspects techniques sont des permanences architecturales quelques soient les destinations des bâtiments, religieux, civil ou "civil" dans l'enceinte religieuse, voire militaire. Ce système d'intégration d'un escalier de clocher dans un contrefort d'angle à Pillac - sans quitter la période romane - nous amène au contrefort d'angle faisant office de tour d'escalier en vis hors œuvre. Par ce simple dispositif de glissement de deux structures architecturales habituellement étrangères l'une à l'autre - contrefort d'angle et escalier - l'escalier est rendu invisible depuis l'extérieur - sauf deux petites fenêtres d'éclairage de la cage d'escalier - voir figures 1, 3, 8 et 11 du synoptique ci dessus. Ce hors œuvre invisible rejoint un esprit d'escalier sophistiqué mais invisible du en œuvre de Rioux-Martin. Ce qui montre, de façon très claire, le changement d'attitude de l'architecture française et de la fonction de l'escalier dans le royaume qui passe de l'organe de structure architecturale de service à une valeur de statut social: à la période romane l'escalier est un organe de service sophistiqué, mais ni permanent ni obligatoire, qui évolue et qui s'associe peu à peu à l'avant-chœur en lui faisant tenir le rôle mixte de tour d'escalier et de tour de cloches dans l'architecture religieuse, alors qu'à partir du quatrième quart du XV° siècle ou du règne de Louis XI, que ce soit dans l'architecture civile ou religieuse on le retrouve en même mode de construction des logis des nobles comme des ecclésiastiques ou des riches bourgeois, à la campagne ou dans les tissus urbains encore serrés. L'escalier devient en quelque sorte un signe d'appartenance sociale et l'orgueil des façades des petits châteaux résidentiels ainsi que des recherches de portails d'entrées survalorisés.
En revanche il n'est pas l'unique forme.
La tour d'escalier en vis ajourée sur balcons, au fond d'un passage ou dans l'angle d'une cour fermée (Châteaudun) ou en pleine façade sur cour fermée (Blois) qu'on rencontre de façon plus modeste tout au fond d'un passage couvert, en variante à volées tournantes à paliers sur balcons sur courette intérieure à valeur de puits de lumière, jusque dans le XVI° siècle dans les régions alpines, comme ci dessous à Guillaumes dans le 06, laisse son beau portail sculpté en bordure d'une façade étroite de magasin sur rue, ne se laissant même pas soupçonner depuis l'espace public extérieur linéaire très réduit. Ces attitudes paradoxales liées aux traditions imposent encore leurs manières en pleine conquête de La Renaissance jusqu'à des incidences de choix dans le baroque construit à Nice (Palais Lascaris).
Cet état d'esprit, et cela ne peut pas surprendre, est celui qu'on rencontre également en descendant dans le XV° siècle avec les petits châteaux de la Creuse jusqu'à l'émergence triomphale de la tour d'escalier en façade - de 1480 à 1500 environ - qui loge son entrée sur une des faces latérales du plan carré ou rond, mais jamais en façade frontale de la tour d'escalier sauf remaniements de la tour, notamment celles sur plan polygonal.
D'après une trace d'archives on prétend que la tour d'escalier de Sarzay [Indre - Vallée Noire] serait de 1450. En fait un plan se superpose à l'autre (?). Quoiqu'il en soit c'est à partir de la fin de la Guerre de Cent Ans que les choses bougent puisqu'on évalue aussi Montaigut-le-Blanc autour de 1470 pour Chamborand 1435-1440 environ, à quelques kilomètres l'un de l'autre.
En revanche avec les tours résidentielles rondes l'escalier en vis peut rester intégré au gros œuvre avec accès par l'étage [avec pont-levis à flèche ou avatar "à pipe"] aux pièces d'habitation ou descendre au rez-de-chaussée sans faire ressortir l'escalier sur le périmètre ( A deux ans d'écart autour de 1480/82 pour les tours construites pour la captivité du prince Zizim à Bois-Lamy puis à Bourganeuf, deux réalisations neuves du dernier tiers du XV° siècle en Haute-Marche actuel département de la Creuse. (Voir sur ce blog Les petits châteaux de La Creuse). Mais aussi la cage d'escalier en vis peut bourgeonner sur le périmètre de la grosse tour résidentielle ronde (Langeron, Nivernais département de la Nièvre)
 |
Tant que le rez-de-chaussée de ces bâtiments conserve une valeur de socle hors sol, aveugle ou
faiblement éclairé, le service de ou des caves est assuré par le même déroulement
de la vis mais seulement à partir du niveau des premières pièces d'habitation à l'étage. Assez fréquemment ce service du bâtiment est doublé
au rez-de-chaussée par une entrée indépendante en façade qui peut se combiner avec le service de la vis ( Malval) ou se compléter sans lien
avec le service indépendant du rez-de-chaussée (Bois-Lamy).
Les entrées au rez-de-chaussée par la tour d'escalier suivront la mutation des
caves du socle en pièces intégrées à l'habitat et ouvertures de fenêtres ,
d'abord une des deux pièces du rez-de-chaussée (répercutées à tous les étages sauf au dernier étage avant 1450) puis les deux pièces avec
les tours d'angles
lorsqu'elles sont présentes, dans le cas des donjons résidentiels rectangulaires à
deux pièces par étage de fond en comble, après 1450 environ.
. Ce mouvement sera également
contemporain d'une diminution des étages de ces gros donjons résidentiels jusqu'à devenir
de petits bâtiments de l'habitat gothique de qualité qui seront chauffés par de belles cheminées
sculptées hors œuvre dans la seconde moitié du XV° siècle pour un démarrage
en œuvre dans la première moitié du même siècle. L'installation de ces cheminées aux conduits en œuvre auront pour effet de fragmenter
les chemins de rondes sur machicoulis qui demeurent en valeurs symboliques traditionnelles et ornementales avec autorisations royales
(François Gébelin - 1957). |
Ce changement d'esprit par l'escalier de service du bâtiment noble et de qualité (appelé château, chastel, hostel, maison, Grand-Maison dans le 37 en dépendance de l'abbaye de Noirmoutier, etc...) dont l'entrée descend au rez-de-chaussée jusqu'à servir les caves enterrées ou semi-enterrées en socle des logements nobles - qui deviendront le site quasi obligé des cuisines de l'âge classique - par une volée droite relais de la vis, soit de fond en comble, devient la caractéristique du petit habitat gothique français de qualité jusqu'à ce que ses propres mutations de structures l'entraîne vers l'intégration de la Renaissance puis la naissance du classicisme français avec l'aile Pierre Lescot au Louvre (1554) ayant assimilé les divisions en cinq corps d'autres formules architecturales traduites en façades gothiques de châteaux plus importants comme à Durtal mans le Maine et Loire. Toutefois dans le plan de Pierre Lescot l'escalier est rejeté derrière un des avant-corps au bout de la façade, et non pas derrière le ressaut de la partie centrale du bâtiment. Il y a là encore un effet trompe l'œil qui s'accorde avec les fausses galeries sous arcades du rez-de-chaussée et qui va évoluer vers une prise d'importance de l'avant-corps central réorganisé depuis Azay-le-Rideau, en logement de l'escalier rampe sur rampe. Ces usages du trompe l'œil dans l'architecture française remontent à la tradition romane, au moins, et concernent autant la structure du gros œuvre que le décor extérieur [Sur les lisières Ouest du bassin de la Tude, sur la route de Chalais à Barbezieux, voire le superbe et très subtile exemple de l'église romane de Passirac - Parties hautes restaurées par Texier au XIX° s.]
On comprend alors combien il est important d'étudier les escaliers des églises romanes, suivant la voie tracée ou inaugurée par Eliane Vergnolle depuis Viollet-le-Duc, jusqu'au colloque du CESR de Tours ( 1979, publié en1985) et leurs rapports intégrés aux autres composantes architecturales des bâtiments (ici des avant- chœurs/tours de cloches), qu'ils soient civils ou religieux, pour pouvoir amener dans le champ scientifique l'analyse de l'évolution de l'architecture française pour laquelle l'escalier va prendre une place prépondérante dans ses organisations. Le lecteur intéressé par ces dynamiques peut rattacher les deux chapitres de ce même article, qui traitent de ces évolutions techniques et de leurs places dans le bâti, au développement que je propose en relais, à la suite de l'étude de l'église de Rioux-Martin, sur ce blog :
Rioux-Martin - L'église romane - L'implantation de l'abbaye de Fontevraud à la Haute-Lande - Les interventions d'Edouard Warin et de Paul Abadie au XIX° s. - Une approche des escaliers romans dans le bassin de la Tude.
https://coureur2.blogspot.com/2022/06/rioux-martin-leglise-romane.html.
En reprenant le fil de l'étude de l'église Saint-Aignan à Pillac, dans sa vaste pénéplaine, dépression des bordures Est du
bassin de la Tude de l'ancien diocèse de Périgueux
Deuxième synoptique
pour un essai d'approche de l'architecture originale de l'église.
Troisième synoptique
pour un résumé d'approche des premières transformations de l'église.

Bibliographie : Abbé Nanglard, t.III, p.261 et t.IV, p.406.
Jean George, Les églises de France - Charente. Paris 1933, p.130 et 131. |
Cette église n'était pas prévue dans ce chapitre car si elle a bien toutes les composantes des autres une fois que l'avant-choeur ait fusionné avec la tour de cloche, elle a en plus un transept. Elle a encore un surcroît de nef, que nous allons retrouver avec les deux autres églises qui suivent mais ayant les mêmes dispositions totalement construites en dur (comme la rénovation la restitue à Juignac) à la période romane, la nef étant voûtée en berceau brisé. Alors que par un autre exemple de la période gothique on modifie l'intérieur de l'église romane de Voulgézac avec, pour servir ce surcroît de nef deux escaliers symétriques hors oeuvre sur la première travée de nef, et une entrée haute (depuis une courtine ?). La pièce haute est une formation à sol plat par dessus les ogives remplaçant le couvrement de la nef romane primitive; dans le secteur de Blanzac de l'autre côté de la Tude en Sud-Charente.
L'exemple le plus spectaculaire en Charente est celui de l'église Saint-Vivien à Charras au
Nord-Est du département, donc loin du bassin de la Tude
La situation géographique de Juignac nous ramène sur le chemin de Compostelle qui contourne le bassin du Voulzot site de l'abbaye de Maumont qui fut primitivement le domaine d'un château dont il reste des vestiges.
Si une étude archéologique documentée de l'église de Juignac attestait de la présence d'une pièce haute d'origine par-dessus un voûtement en berceau brisé nous entrerions en concurrence des deux autres églises qui vont suivre où les marqueurs seraient plus en faveur de surcroîts en pans de bois.
Cette richesse architecturale du bassin de la Tude étonne constamment et nous voyons ici que nous sommes obligés de nous écarter un instant du cadre stricte que je m'étais fixé dès le départ de l'étude, avec une famille d'églises sélectionnées à nef unique sans transept, autour du bassin de la Tude, et ce dans le but scientifique de bien comprendre ces innovations et ces mutations d'un monument à l'autre sur un secteur géographique aussi limité et très pauvre en documents d'archives anciennes - sur trois diocèses et sur des sites très riches en histoire et périodes très différentes, récupérés ou en propre à l'histoire de la chrétienté - mais qui compte beaucoup d'églises romanes ou périphériques à la période, et de chapelles d'origines ou transformées en églises depuis des églises démolies de la période romane qui furent un temps des chapelles de route comme Bors-de-Montmoreau. Ce qui enrichit encore le sujet puisque nous voyons que des types architecturaux viennent au secours d'autres formations architecturales originales ou réemployées, voire influencées, pour assurer une continuité du chemin qui établit les liens entre les lieux de culte sur des cheminements assez précis comme celui des pèlerinages ou des liens entre les prieurés et les abbayes mères, qui se croisent ou se confondent.
Et, en n'ayant seulement amorcé l'étude de ce phénomène architectural sur ce secteur géographique, jusqu'ici exposé en première recherche, tout sera une fois de plus bouleversé, à seulement trois kilomètres à l'Est de Montignac-le-Coq, lorsque sur la prochaine page de ce blog, je démarrerai une nouvelle recherche par une étude archéologique de l'église Saint-Cybard à Palluaud. |
Le chemin, el camino,
pour une clarification résumée du stade où en est la recherche.
En continuant la route au Nord-Ouest, après Montmoreau avec son château, son église romane et sa chapelle avec courte nef directement rattachée par un court passage étroit à un choeur sur plan tréflé), sur le diocèse de Saintes nous allons rencontrer Challignac, Saint-Laurent des Combes (prieuré bénédictin de l'abbaye de Brantôme), Poullignac (de source carolingienne). En basculant à l'Est de la Tude sur le diocèse de Périgueux reprenons la route de Saint-Jacques avec l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau (Site avec de nombreux vestiges de fortifications - première église du secteur étudiée sur ce blog avec à l'intérieur la plus ancienne représentation connue à ce jour de La Véronique de source mérovingienne/carolingienne, en lien avec les sarcophages de l'antiquité tardive), Juignac (avec une étude à reprendre), la première église romane de Bors-de-Montmoreau transformée en chapelle de route, Pillac et son avant-choeur sur quatre contreforts dont un à usage de tour d'escalier en vis. Entre deux, toujours sur le chemin de Saint-Jacques, à l'Est l'église de Montignac-le-Coq sur le site d'un ancien sanctuaire mérovingien, au Sud-Est Chenaud sur un ancien site païen et si on franchit la Tude vers l'Ouest le secteur de la Haute-Lande ( une des dépendances de l'abbaye de Fontevraud) avec trois monuments étudiés sur ce blog sur quatre : La Genétouze, la chapelle de Cressac (chapelle de route), l'église de Rioux-Martin, la chapelle de route de La Ménècle (XVII° s) avec son église romane à chevet plat bâtie en terrasse sur un secteur aux nombreux vestiges gallo-romains), et en remontant un peu plus au Nord sur la même rive les églises de Sérignac (à nef unique chevet plat et chevet à triplet articulé) et de Curac dont l'importance pour la naissance des tours de cloches fusionnées avec un avant-choeur est un des principaux témoins par documents d'archives de cette dynamique, mais encore difficile à appréhender - pour ne citer que les églises jusque là étudiées ou présentées sur ce blog autour de la Tude affluent de la Dronne elle-même sous affluent de l'Isle affluent de la Dordogne, alors que La Charente est un fleuve (se jette directement dans la mer, au nord du bassin de la Tude).Cette église de Juignac a également une particularité : son escalier logé dans un contrefort oblique (comme à Pillac) mais tout au bout du transept Sud voûté en berceau; ce détail qui répond à la question posée au début de cette recherche, soit l'usage non obligatoire des contreforts extérieurs obliques pour des voûtes intérieures en ogives puisqu'ici la voûte du croisillon épaulé est en berceau et en plus auquel est associée la cage d'escalier en vis : ce qui donne du crédit à l'originalité de la façade de La Genétouze. L'accès à l'escalier de l'église de Juignac est en hauteur au fond du croisillon du transept Sud sur le mur Ouest.
Les plus gros contreforts du clocher sont sur la face Ouest, intégrés à la transition nef-avant-choeur, partiellement masqués sur l'intérieur par de grosses piles rectangulaires sur les faces desquelles sont partiellement engagées de grosses colonnes rondes, ce qui pourrait être un argument à la proto-organisation des piles de l'avant-choeur de Saint-Laurent-des-Combes, où les colonnes sont en délit sur de très gros dosserets rectangulaires indépendants qui constituent l'essentiel de chaque pile (étude de cette église sur cette page de blog après Montignac-le-Coq)
MONTIGNAC-LE-COQ
Eglise de l'Exaltation-de-la-Sainte-Croix qu'on trouve aussi
sous le patronage de Saint-Hilaire
Montignac le Coq, par delà une reconstruction de la nef qui court sous l'avant-choeur actuel et une partie du choeur, va nous ramener vers cette dialectique chœur-avant-chœur-escalier, vers ces techniques de constructions qui se diversifient, voire qui se perfectionnent et changent peu à peu, au fur et à mesure que les enjeux et que les choix architecturaux varient ainsi qu'à un autre rapport de l'escalier en vis au gros œuvre du bâtiment où les nefs passent à deux niveaux fonctionnels que j'appellerai "Nef à surcroîts" afin d'évacuer toutes les polémiques sur les prétendues "églises fortifiées", ou toute autre interprétations de nefs surélevées parce qu'on a changé les charpentes ou les voûtes et qu'il a fallu surélever les murs gouttereaux pour ménager un étroit passage de circulation - pas toujours continu, bien loin de là -.entre ce mur et les voûtes bombées dans les combles, voire les leurres architecturaux en fausses latrines et fausses bretèches qu'on retrouve même inaccessibles sur des portails de la Première Renaissance Française comme en façade de l'église Saint-Jacques à Nanteuil Auriac de Bourzac..
L'église de Montignac le Coq sera le monument qui articulera les monuments jusqu'alors étudies à ceux qui vont suivere sur d'autres aspects de la présence de l'escalier roman dans ses rapports à l'architecture des églises.
Sud-Charente - Extrême Est des lisières du bassin de la Tude en limites de la Dordogne et du Limousin.
Arrondissement d'Angoulême - Canton d'Aubeterre
Bibliographie
, "Abside voûtée. Coupole à demi abattue, arceaux légèrement ogivés. Nef moderne avec lambris". Cf. Abbé Michon, Statistique monumentale de La Charente. Angoulême, 1844, p.274.
Bulletin de la Société archéologique des Charente. 1892, p. 258.
Abbé Nanglard, Pouillé historique du diocèse d'Angoulême. Angoulême 1894, T.III p.125 et T.IV p.361.
" Eglise Saint-Hilaire , - Cédée vers le milieu du X° siècle à l'abbaye Saint-Cybard d'Angoulême par le comte d'Angoulême, elle dépendait du diocèse de Périgueux.
La nef sans contreforts, a reçu en 1858, en place de son lambris, une voûte d'arêtes en briques sur consoles, à trois travées, ayant une baie de chaque côté. La coupole de son faux carré (sic), en partie abattue, a été réparée..." Cf. Jean George Les églises de France - Charente. Paris 1933, p. 168 et 169.
Bibliographie complémentaire :
Jean George et Alexis Guérin-Boutaud, Les églises romanes de l'ancien diocèse d'Angoulême. Paris, 1928.
Eliane Vergnolle, L'art roman en France. Paris, 1994, 2003.
Malgré quelques différences entre les reports sur le plan d'ensemble et sur la feuille de parcelle on ne peut que remarquer le plan massé de la petite agglomération, au milieu de vastes parcelles vides.
L'église et son périmètre occupent la pointe d'un mamelon sur une ligne de crête. Autour de l'église, le village occupe une position quasi stratégique ou militaire, voire à vocation cultuelle, qui domine ou contrôle un vaste panorama circulaire ondoyant.

L'enquête locale ne fait état d'aucune mémoire de château mais d'une plausible villa. La prise de contrôle du site à la période médiévale pourrait être uniquement religieuse ou en pouvoirs confondus religieux/seigneuriaux. La tradition orale évoque des sépultures mérovingiennes creusées dans la roche en place, sur le périmètre de l'église qui fut celui de l'ancien cimetière mais uniquement sur la face Nord, tel que nous le voyons sur le cadastre napoléonien ci dessous. Ces tombes aux cuves creusées, beaucoup plus anciennes, données pour une période couvrant les V° et VIII° siècles après J.C., en vestiges plus dispersés et enfouis, auraient été de la famille de celles retrouvées dans la périphérie d'Angoulême près de Soyaux, au cimetière mérovingien de Pétureau.
Si nous nous nous risquons à une approche de la création de la paroisse de Montignac-le-Coq, sur la base hypothétique d'une villa relayée par un cimetière mérovingien et une église au vocable affirmé de la Sainte-Croix avec un titre interchangé en Saint-Hilaire, nous trouvons plusieurs avis.
1 - Le premier est celui ci : "Les plus anciens titres d'églises évoquent les mystères de la religion, la Trinité, le Sauveur, et souvent d'ailleurs, ces personnages ont été interchangés...[...]...Les églises anciennes titrées des vocables que l'on vient d'énumérer ne sont pas toutes des édifices paroissiaux, c'est-à-dire des sanctuaires où le baptême était conféré aux deux fêtes de Pâques et de la Pentecôte : de nombreux oratoires privés y sont inclus. Pour identifier une église paroissiale antique il faudrait pouvoir retrouver le baptistère ancien grâce au vocable de Saint-Jean-Baptiste auquel ils étaient tous consacrés." D'où le relevé détaillé que j'ai fait des très beaux fonts baptismaux qui ne sont pas antérieurs au XVIII° siècle mais qui peuvent avoir remplacé une autre cuve plus ancienne comme on en voit sur plans polygonaux dans le bassin de la Tude, et tout près en arcades enrichies à Salles-Lavalette, ou plus près de La Tude à Brossac et à Saint-Martin, ornées d'un périmètre en périptère, qui reprend la valorisation des personnages nobles dans un péristyle d'atrium basculé en périptère [en répertoire iconographie de décor voir la mosaïque de la villa du IV° s. de Conimbriga au Portugal. Voir sur ce blog l'étude de l'église de Poullignac].[Cf. Michel Aubrun, La paroisse en France des origines au XV° siècle. Paris, 2008, p. 18 et 19]

|
A titre d'exemple de baptistère roman sur plan polygonal orné d'arcades
en périptère. Dans l'atrium (cour intérieure romaine) c'est le péristyle
qui est bordé d'un passage périphérique sur arcades (en portique continu). C'est ce
schéma qui est en frise périphérique aux entrelacs de la mosaïque de Conimbriga, ruine
d'une ville antique auprès de Coïmbra au Portugal où est cette villa (IV° s. Après J.C.).
L'Empereur carolingien pouvait être représenté dans ces arcades, tout comme les galeries de rois,
de saints ou d'apôtres sur les façades romanes ( Exemple de Ruffec - Eglise Saint-André XII°s. - Charente,
à Notre-Dame de Paris - 2° quart du XIII° s.)

C.Claude Peynaud 2010 - Voir sur ce blog mois d'avril 2021 (vers bas de page) :
Iconologie - Un couvercle de sarcophage mérovingien - une corniche de l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau (Charente) - Archéologie médiévale. https://coureur2.blogspot.com/2021/04/iconologie-un-couvercle-de-sarcophage.html Ce système ornemental est repris en pseudo périptère d'un chapiteau de la grande tour pyramidale ajourée de l'abbatiale de Brantôme La permanence des répertoires architecturaux antiques passé dans le vocabulaire ornemental. Ces recours à ces répertoires changent au XVIII° siècle De l'héritage carolingien à la fin de la période baroque nous passons pour le mobilier du Baptême qui accompagne toute la symbolique d'entrée dans la vie chrétienne, de la référence à l'atrium des cours impériales et célestes des enluminures et mosaïques murales carolingiennes, avec le Phénix en référence centrale - Pascal 1° - au calice de la transsubstantiation de l'Eucharistie. |
2 - Voici le second " La paroisse...Cette division territoriale ecclésiastique devint rapidement indispensable à la vie du pays. C'était le centre de la vie collective, toute l'existence quotidienne (travail ou fête) s'organisait dans son cadre. La paroisse du Moyen-Âge avait le plus souvent pour origine une exploitation agricole remontant à la civilisation gallo-romaine. C'était le cas de bon nombre de lieux dont le nom se termine par la finale en "ac", qui vient de la désinence latine "actum". Les vestiges romains, quand ils existent, viennent confirmer cette hypothèse". [ Cf. Marie Marie, "L'occupation du sol dans la vallée de la Charente". Dans, Annales du G.R.E.H. - Groupe de recherches et d'Etudes Historiques de la Charente Saintongeaise N° 17 - 1996. C. les auteurs du G.R.EG.H. 1997, p. 67, article p.35 à 134.] Montignac le Coq est sur le diocèse de Périgueux mais dans ce secteur de la Charente les noms en "ac" y sont aussi fréquents qu'en Angoumois comme nous venons de le voir avec Pillac..

L'église se situe sur la route de Saint-Jacques de Compostelle qui vient d'Angoulême, qui passe par Montmoreau puis Bors-de Montmoreau et sa chapelle de route
avant l'étape de Montignac-le-Coq vers Aubeterre.
Si j'en reviens aux remarques d'auteurs reportées en introduction à l'étude de la nef de l'église de Chenaud (sur cette page, avant l'étude de l'église de Pillac) je dois considérer que la nef a des chances d'être du XI° siècle tant par la nature de la construction de ses murs que par son plan. Bien sûr ces murs ont été très modifiés jusqu'à la période moderne, mais ce sont eux que nous voyons majoritairement en élévations, et leurs faces intérieures conservent des traces de colonnes ou de demi-colonnes adossées signant, malgré une absence de traces extérieures de contreforts, un probable voûtement primitif de division de la nef en deux travées régulières. Ce qui donne en proportions, et le mieux c'est de produire le brouillon coté du relevé du plan sur le siteMaintenant que les relevés de l'escalier et du clocher ont pu être terminés (25 janvier 2025)
nous allons revenir aux phases primordiales des schémas d'étude avec l'escalier pis le synopsis en principales icônes d'approches du monument
Le document ci dessous va donc disparaître dans sa forme incomplète de brouillon.
Etude de l'escalier et du clocher

La nef fait 6,60 m de large (pour 6,70 à Chenaud et 6,76 m à Saint-Trojan), pour une longueur de 13,20 m [avec cet aspect technique je me réfère aux traités géométriques de l'architecture qui se développèrent et qui diffusèrent du XI° au XII° s. La pensée chrétienne se trouvant enrichie et revivifiée par un début d'appels aux auteurs antiques pendant la Renaissance Carolingienne - résolution du conflit entre la foi et la raison - Vitruve va y trouver une place de choix. Ce sont là les ferments de l'éclosion de la Scolastique autour de l'Abbé Suger à Saint-Denis, de Chartres et de Soisson dans la première moitié du XII° jusqu'à l'arrivée à une première maturité autour de 1200 pour un classicisme éclos à partir de la mort de Saint-Louis ou de Saint Bonaventure (1270), dont Erwin Panofsky nous livrera son exposé et sa réflexion dans une publication traduite en français en 1967 avec une nouvelle publication en 1986 Architecture et pensée scolastique. Cette publication s'articule avec celle en langue anglaise du même E. Panofsky, Abbot Suger on t he abbaye chruch of St-Demis and its arts treasures - Edited, translated, and anotated by Erwin Panofsky. Princeton University Press 1946, 1948, 1973, 1979. Second édition by Gerda Panofsky-Soergel // Pour d'autres approches de la pensée médiévale, de la scolastique, à la période romane et transitions : Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge; Paris, 1957, 1985. / Philippe Wolff, L'éveil intellectuel de l'Europe du XI° au XII° siècle. Paris, 1971]. La nef est coupée en deux parties égales par les vestiges d'un support, comme dit plus haut. On obtient ainsi deux travées carrées, régulières de 6,60 m de côtés (repère A).
Si cette nef a des parentés évidentes avec les nefs du XI° siècle (petit appareil dissolu sur les deux parements extérieurs et intérieurs, et mêmes largeurs) un voûtement en berceau sans contrefort pour des murs épais de seulement 90 cm sur une hauteur que nous pourrons estimer proche de celle du clocher (même si cette hauteur est atteinte par un potentiel surcroît en charpente), semble curieux alors que le mur n'accuse aucun dévers. Ces contreforts peuvent toutefois avoir disparus dans des remaniements. En revanche si on admet deux travées couvertes en voûtes d'arrêtes à quatre voutains nous sommes davantage dans des résolutions avec un plus fort pourcentage de probabilités, sans en exclure d'autres.
A partir de la liaison de la nef et de l'avant-choeur les repères archéologiques changent et l'articulation semble partiellement artificielle. Ce qui projetterait la partie orientale de l'église dans le XII° siècle.
En revenant sur l'hypothèse d'une nef du XI° siècle,
Eliane Vergnolle [E.V. 1994/2003, op.cit., p. 96] nous donne des repères intéressants : voûtes en berceau "Un tel choix ne posait d'ailleurs pas de problèmes techniques majeurs dans les nefs de dimensions réduites, comme celle de l'église de Fuilla (Roussillon), consacrée en 1031, dont le vaisseau central, haut de 9,70 m, n'excède par 4,50 de large. Mais lorsque l'espace voûté était de plus grande ampleur , le succès était plus aléatoire. Certaines expériences furent néanmoins réussies... l'église haute de la Galilée de Saint-Philibert de Tournus (environ 6,25m de large et 12,50m de haut) appartient à celle-ci, probablement grâce au contrebutement efficace des voûtes en demi-berceau des bas-côtés venant s'appuyer sur les fenêtres hautes."
A Montignac le Coq nous avons une nef unique. Un vestige du mur gouttereau Nord, sur sa partie Est, que nous pouvons évaluer comme celui de la partie inférieure d'un ébrasement de fenêtre, nous renseigne sur un niveau bas de la baie pour une élévation du vaisseau sous comble fonctionnel à une hauteur proche de celle du clocher, comme nous le verrons avec l'étude de l'avant-choeur.
S'il y eut une voûte il faut donc exclure, une fois de plus, la voûte en berceau. Il faudrait se rabattre sur une voûte composée de deux travées de voûtes d'arrêtes à quatre voûtains (en briques ?). Mais l'autre aspect important de cette question c'est que nous sommes ici en rupture avec les nefs, soit planchéiées, ou voûtées en berceau, à combles perdus, soit directement sous charpente traditionnelle dans les secteurs Ouest du Sud-Charente [Par charpente traditionnelle il faut peut-être plus se diriger vers des charpentes à arbalétriers faisant chevrons plus que vers des charpentes à pannes qui semblent se généraliser seulement à partir du XVI° siècle : la différence de poids entre ces deux systèmes, comme vu à Chenaud, peut-être conséquent pour des épaisseurs de murs et étayages]. Cette rupture, au sein de permanences, ne sera pas la seule.
Cette originalité de la nef de Montignac-le-Coq est donc le premier caractère à prendre en compte pour avancer vers l'organisation de son avant choeur d'une construction postérieure.
La voûte de la nef elle-même est-elle après ou avant 1100 ?
Le premier repère que nous ayons sur les successions de chantiers nous est donné par la nature des appareils qui se superposent dans les élévations extérieures.
A savoir : les petits appareils dissolus de la nef se poursuivent sur les parties basses de la face Nord de l'avant-choeur et aussi sur la partie nord de l'exèdre du choeur. Nous avons là deux indications : un premier chantier construit en petits appareils dissolus dans le prolongement de celui de la nef initiale, et un choeur allongé, plus étroit, qui se termine en mur arrondi mais uniquement en partie Nord. Toute la face sud du choeur est en grand appareil régulier, sauf les parties les plus hautes reconstruites.
Ainsi nous partons sur les bases solides de deux chantiers qui se superposent et se conjuguent avec des modes de constructions différents pour des plans voisins mais l'un à contrefort et l'autre sans. Donc, à priori, un bâtiments charpenté ou planchéié et un bâtiment voûté dans le choeur quasi totalement reconstruit jusqu'à son articulation avec la nef qui elle a simplement été remaniée plusieurs fois sans remise en cause du gros oeuvre ni du plan, sauf en façade occidentale.
Synoptique
icône
Etude de l'escalier et son incidence sur l'organisation primitive de l'église
En manière d'épilogue
L'église Saint-Laurent
à Saint-Laurent-des-Combes
Sud Charente, secteur Ouest du bassin de La Tude
ancien diocèse de Saintes
Arrondissement de Cognac, canton de Brossac
Dépendance de l'abbaye de Brantôme
Voici ce qu'en écrit l'Abbé Nanglard, repris par Jean George dans les Eglises de France [J.George, 1933; op.cit, p141]
Eglise Saint-Laurent : "L'église de l'ancien diocèse de Saintes et commune à la paroisse et au prieuré du lieu, dépendait de l'abbaye de Brantôme. Elle est signalée dès le XI° siècle. Elle a eu beaucoup à souffrir des Anglais, aussi dut elle être reconstruite en grande partie au XVI° siècle. Elle a reçu quelques restaurations en 1840. Elle forme un long rectangle sans grand intérêt".
Cet unique signalement est celui repris par la publication moderne de Jean-Paul Condamine et Anne Marie Treny, Petite histoire du Brossacais (1900-1990). Rioux-Martin 2019, p.33 et 34, qui étoffe un peu plus le descriptif, modifiant le XVI° siècle en XV° siècle, mais surtout qui a le mérite de dresser un bel inventaire du patrimoine bâti du Brossacais.
Charles Connoué est plus loquace et s'il décrit un monument très délabré, il l'enrichit d'un transept disparu "Une coupole sur pendentifs recouvre le faux carré. Elle repose sur de massifs arcs en plein cintre. L'église avait jadis des croisillons. On voit encore les colonnes qui soutenaient les arcs d'entrée avec quelques tracés de leurs chapiteaux" [Charles Connoué, Les églises de Saintonge - Cognac et Barbezieux - Préface par Germain Gaborit. Saintes 1952/55, p. 134]
Rque : des traces désormais visibles d'un arc bas dans le mur sud de l'avant-chœur, pouvant être un arc de décharge ou de niche comme dans le mur Nord du même avant- chœur, ferme la lecture émancipatrice de Charles Connoué mais je ne l'exclue pas avant étude archéologique que je démarre comme celle d'une église à nef unique sans transept.
 |
On remarquera que le bourg et son église avec son cimetière et son presbytère sont construits
en bordure Sud d'un axe de circulation qui borde au Nord des terrains marécageux qui sont
actuellement en cours de remblayages. Ces investissements ne sont pas récents comme le montre le tableau d'assemblage dont je propose plus bas un extrait en seconde documentation des sources puisées au plan cadastral de 1837.
L'église elle même est construite sur une terrasse en défaut de terrain compensé
par ses fondations au chevet. Quelle raison pour ces importants travaux de terrassements
pour implanter cette église à cet endroit précis ? Avait on prévu une crypte pour une
église qui occupe la partie médiane d'un chemin qui fait la liaison entre deux carrefours de
quatre routes ?
Cette implantation sur terrassement qui ne s'étend pas aux fondations du presbytère
pourtant construit près du chevet, en face d'un marécage artificiellement contenu par
une route (chemin sur digue), qui a pu être le site d'un étang donc d'une ressource
piscicole,
pose de premières questions alors que cette église est très isolée au milieu d'un vaste
paysage de combes aux villages généralement discrètement perchés sur les hauteurs, blottis
dans les taillis.
La question de la stabilité des terrains terrassés du lotissement au sein d'un domaine agricole
de fond de vallée marécageuse apparaît avant tout investissement archéologique du bâti.
 Comme écrit plus haut un extrait du tableau d'assemblage nous donne d'autres informations. Nous voyons que le début d'investissement de la zone marécageuse se situe avant le second quart du XIX° siècle. Ces bâtiments ne présentent actuellement aucun caractère très ancien et ne repositionnent pas la présence d'un étang aux origines de l'implantation de l'église et de l'aménagement de son environnement. L'abandon de cet étang ou sa réduction, serait ancienne jusqu'à la disparition de sa pelle qui fut convertie en passage à gué. Nous avons en plus deux informations : celle du Petit Moulin, suivant son appellation actuelle, qui est nommé "Moulin du Bourg" et qui pourrait être très ancien puisque de son bief il n'en reste apparemment que des pointillés sur le cadastre de 1837. Le cours d'eau étant toujours le Reteuil. il suit le tracé de la route goudronnée.
L'économie des moulins qui émerge de façon importante au XII° siècle est responsable d'un nouvel enrichissement, d'un nouvel essor économique. D'après son propriétaire il ne reste qu'une seule meule témoin de cette activité, et le nom du site avec des zones partiellement inondables. Ce qui montre bien que c'était toute la vallée aux approches de l'église qui était investie d'une économie liée à la gestion de l'eau. Jacques Le Goff insiste sur ce point [La civilisation de l'Occident Médiéval - Chapitre VII - La vie matérielle - X°-XIII° siècle. Paris, 1988, p. 224 à 289] : "Des "inventions médiévales", les deux plus spectaculaires et révolutionnaires dataient de l'antiquité, mais pour l'historien leur date de naissance qui est celle de la diffusion, non de la découverte, est bien le Moyen Âge. Le moulin à eau est connu en Illyrie dès le II° siècle avant Jésus-Christ, en Asie Mineure dès le 1° siècle...Vitruve décrit, et sa description montre que les romains avaient apporté aux premiers moulins à eau un perfectionnement notable en remplaçant les roues horizontales primitives par des roues verticales qui reliaient..." Dans le Sud-Charente il y a au moins un vestige de bief avec chute d'eau (creusé dans le roc et aujourd'hui à sec mais qui conserve des traces de pierres assemblées par des mortiers). Les moulins à eau et roue verticale, à la période romane, étaient donc connus sur cette zone géographique. L'économie de l'eau est également une règle de savoir vivre qui entre en complément des autarcies monastiques (La vie cénobitique est une des conséquences des vies ermites et des anachorètes). Toujours en explorant le travail de Jacques le Goff (p.240-241) "Ajoutons que d'autres facteurs que nous retrouvons ajoutent à la faible productivité de la terre médiévale. C'est par exemple la tendance des domaines médiévaux à l'autarcie...Avoir recours à l'extérieur, ne pas produire tout ce dont on a besoin n'est pas seulement une faiblesse, c'est un déshonneur. Dans le cas des propriétés monastiques, éviter tout contact avec l'extérieur découle directement de l'idéal spirituel de solitude, l'isolement économique étant la condition de la pureté spirituelle". Citant Saint Benoît " le monastère, s'il est possible, soit organisé de manière à produire tout le nécessaire : eau, moulin, jardin et divers métiers, de façon à ce que les moines ne soient pas obligés d'aller à l'extérieur, ce qui est désastreux pour leurs âmes". La citation exacte suivant la traduction de Soeur Marie- Pascal Dickson [La règne de saint Benoit - Chapitre soixante huitième - Des portiers du monastère. Paris 2014, p. 191 - 6, 7, 8] est la suivante : " 6/ Dans la mesure du possible, que le monastère soit organisé de telle sorte que tous les services nécessaires puissent y être exercés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on y trouve l'eau, un moulin, un jardin et des ateliers divers./7/ Ainsi n'est-il pas besoin pour les moines de sortir au dehors, car cela ne leur est d'aucun profit./8/ Nous voulons que cette règle soit lue assez souvent en communauté, afin qu'aucun des frères ne puisse s'excuser sous prétexte d'ignorance". Cette règle a t-elle, d'une manière ou d'une autre, influencé la construction de l'église, en avoir orienté l'architecture, peu ou prou, car c'est une question qui pourra se poser de façon très pertinente à Saint-Laurent-des-Combes, comme elle s'est déjà posée à Montignac-le-Coq. Cette solitude liée à la vie monastique, une fois le cadre de vie installé, n'exclue pas les apports extérieurs, et l'église de Saint-Laurent-des-Combes isolée dans ses vastes paysages en témoigne, comme nous allons le constater par les liens architecturaux qu'elle présente avec les autres églises du groupe de cette page pour laquelle je la présente en épilogue, et ses caractères qui lui sont propres. La commune possède un autre vestige de moulin: le moulin du Portail qui ne figure pas sur le tableau d'assemblage du cadastre napoléonien de 1837 mais que j'y ai ajouté de façon approximative. C'est un moulin à vent à deux étages, de faible diamètre, construit tout en haut d'un mamelon . Un écrit signale la direction au visiteur et la présence du moulin en 1870. Sa construction hérite des modes romains avec un nucléus contenu entre deux parements.
|
Cette église m'intéresse car elle présente ou précise, ou reprend l'essentiel des thèmes que nous avons vu se construire et se modifier, depuis la chapelle de Cressac et les églises de La Genétouze, Chenaud, Pillac et Montignac-le-Coq autour de la fusion architecturale du clocher et de l'avant-choeur, de l'évolution de la place de l'escalier dans l'avant-choeur jusqu'au comble, en fait par les trois principaux organes qui vont caractériser le développement - entre la façade et le chœur - de l'architecture romane de l'église à une seule nef sans transept, car si l'église de Saint-Laurent-des-Combes ne fut pas reconstruite, sauf sa façade, elle fut sauvegardée par ré étayages et surtout par l'un de ses arcs de l'avant- chœur/tour de clocher, et abandon de la voûte en berceau effondrée de la nef, malgré des contreforts extérieurs et des arcs saillants intérieurs qui reprennent le souvenir des arcs en péristyles des atriums que nous avons déjà ciblé à Poullignac en relais des modes architecturaux carolingiens/romans ou préromans car l'église, ou une implantation religieuse, est signalée au XI° siècle (élément de l'abbé Nanglard et Jean George non repris par Ch.Connoué). La place de son escalier de clocher apportera de nouveaux éléments ou confirmera ceux de Montignac-le-Coq.
En revanche les sculptures des chapiteaux, cohérentes entre extérieur et intérieur, la richesse même de son programme sculpté tel que nous pouvons encore l'évaluer entre fragments et tailles neuves de restaurations, qui peut nous ramener à d'autres vestiges d'églises du secteur entre les diocèses d'Angoulême, de Périgueux et de Saintes, nous feraient redescendre avant l'apparition théorique des chapiteaux "à collerettes" majoritairement rencontrés dans les églises étudiées sur ce blog entre dernier quart du XII° siècle et probables débordements sur le début du XIII° siècle.
Tous ces aspects et d'autres très surprenants qui apparaîtront en cours d'étude, si cette église pouvait être évaluée comme une construction romane de la première moitié du XII° siècle, bouleverseraient une suite logique de prise de place par les escaliers dans les programmes architecturaux des bâtis. Toutefois nous ne pourrons pas conclure à une progression historique linéaire tant que tous les types d'escaliers de ce secteur n'auront pas été relevés et analysés en fonctions des programmes architecturaux, par la rareté même des documents écrits et de la possibilité de les mettre nettement en relation avec les étapes de constructions, voire de fondations et d'origine même des fondations qui se pose à nouveau avec cette nouvelle église étudiée.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'étude en archéologie du bâti et histoire de l'art, je signale que cette église a été restaurée récemment à l'extérieur avec de nombreuses pierres neuves qui reprennent les tailles anciennes.
A l'intérieur comme à l'extérieur il y a eu des remaniements plus anciens dont la reconstruction de la façade (début XVI° s.) dont on voit clairement les limites en comble de la nef.
Des pierres blanches qui apparaissent étonnement neuves sont employées surtout dans les parties les plus délicates du clocher et de son escalier et pour les marches qui paraissent très peu usées [vu la position de l'escalier du clocher et les comptes-rendus d'auteurs qui n'y sont jamais montés je doute que cet escalier ait connu une abondante fréquentation malgré un service double en surcroît de la nef et en comble du clocher].Personnellement j'ai d'abord adhéré, non sans hésitations il est vrai, à cette théorie admise de "murs reconstruits", et puis en examinant un peu plus l'ensemble des combinaisons, voire des pierres d'appoints pour caler certains éléments disparus, et chapiteaux réalisés dans cette pierre blanche, je mets cette question en réserve. N'étant pas géologue je ne peux pas y répondre fermement. Mais je doute, au moins pour une bonne part de cette ressource. Toutefois j'ai beaucoup prospecté dans les bâtiments de la Loire ligérienne et auvergnate, et on ne peut pas dire que le château de Chambord, ni celui de Villandry, ni ceux exposés aux aléas d'une rivière comme Chenonceau enjambant le Cher, ni tout autre château ait été reconstruit. A l'abri des intempéries ou exposés certains calcaires dont le Tuffeau ont cette particularité de rester blanc ou de conserver les couleurs des calcaires d'origine. A Saint-Laurent-des-Combes, ces pierres étant fréquemment employées dans les constructions les plus soignées, alternées avec d'autres pierres grises, je pense qu'il est temps de poser la question, vu que ces pierres ont circulé par gabares qui étaient les bateaux de transports traditionnels des réseaux des rivières périphériques à la Loire dont la Dordogne pour laquelle la Dronne et la Tude sont des affluents et des sous affluents. Et nous avons vu l'importance de la gestion des ressources aquatiques pour les Bénédictins de Saint-Laurent-des-combes.
En fait nous en arrivons à ce point de recherche de la vie des formes évoluées au XII° siècle vers l'art gothique tel qu'Erwin Panofsky le formule [Architecture gothique et pensée scolastique. Traduction et postface de Pierre Bourdieu. Paris 1986, p. 104] : "Cette homologie fait apercevoir ce qui correspond à la hiérarchie des "niveaux logiques" dans un traité scolastique bien organisé. Si, selon la tradition de l'époque, on divise l'ensemble en trois parties principales, la nef, le transept et le chevet (qui comprend encore l'avant-choeur et le choeur proprement dit et si l'on distingue..." (L'auteur développe ensuite sa pensée vers des églises plus complexes à collatéraux, transept et chapelles "en couronnes" (sic), tout en restant dans sa logique qu'il soutient en fil conducteur, c'est à-dire dans celle qu'il dégage en pensée scolastique).
La recherche ici entreprise est sur ce point totalement cohérente à travers l'étude de ce groupe de petites églises (et chapelles) du bassin de la Tude. Le prochain article, toujours à partir d'exemples d'églises du bassin de La Tude, étudiera d'autres vies des formes vers un nouveau pas qui s'avancera progressivement plus clairement vers l'art gothique avec des propositions et des proportions de monuments dégagées et élaborées depuis l'art roman et des organisations plus audacieuses qui se fixeront néanmoins sur celles ici étudiées.
[Il n'y a pas de cathédrale gothique dans le bassin de la Tude]
"Architecture gothique et pensée scolastique est sans nul doute un des plus beaux défis qui ait jamais été lancé au positivisme. Prétendre que la somme et la cathédrale peuvent être comparées, au titre d'ensembles intelligibles composés selon des méthodes identiques, avec, en autres traits, la séparation rigoureuse que s'y établit entre les parties. la clarté expresse et explicite des hiérarchies formelles et la conciliation harmonieuse des contraires, c'est en effet s'exposer à recevoir, dans le meilleur des cas, l'hommage respectueux et prudent que mérite "une très belle vue de l'esprit"
. L'idée que, entre les différents aspects d'une totalité historique il existe, pour parler comme Max Weber, une parenté de choix, ou comme disent les linguistes une affinité structurelle n'est pas nouvelle. Mais la recherche du lieu géométrique de toutes les formes d'expression symbolique propres à une société et à une époque est partie plus souvent d'une inspiration métaphysique ou mystique que d'une intention proprement scientifique." [ E.Panofsky, 1986, op.cit., p. 135].
L'église de Saint-Laurent-des-Combes est construite en talweg, au bord d'un petit ruisseau, le Reteuil, d'où le complément à sa dédicace "combes". "Combe" signifiant le fond en versants concaves, voire convexes, du vallon. Ainsi se combinent des mouvements puissants du paysage, qui s'enchaînent sans transitions.
Voici pour l'essentiel. Ces paysages ondulants, très animés, partagés entre les bois, les prairies, les vergers et les cultures de maïs et de tournesols, principalement, sont spectaculaires et magnifiques. L'habitat s'y égrène en grosses fermes dont les ressources architecturales traditionnelles restent à étudier dans le champ scientifique des richesses de cette région très pittoresque et très isolée.
Cette église en est l'épicentre, l'âme et l'histoire, d'où la recherche des premières structures d'implantations à laquelle je me suis hasardée.
l'Abbaye de Brantôme au bord de la Dronne dans le Périgord
Département de La Dordogne.
Jean Secret, Brantôme en Périgord. Préface de L. Grillon, avec les participations de Jacques, Pierre Bourdeilles, Petit. Imprimerie de la Vézère, Emmanuel Leymarie, Montignac, Les éditions du Périgord Noir, 1962.)
L'abbaye de Brantôme est fondée autour des deux premières décennies de l'an 800. Le pape Léon III la consacre en 804. Charlemagne dépose les reliques d'un enfant saint Sicaire qui sera la dédicace de l'église associées à celle de Saint-Pierre. Par les textes nous retrouvons cette église dans la dépendance de La Chaise Dieu en Auvergne (département de la Haute-Loire) de 1157 à 1178, qui pourrait être un des créneaux de datations (moins que plus) retenues pour la construction de l'église de Saint-Laurent-des-Combes. L'autre fondation de Brantôme en Charente (l'une sur le diocèse de Saintes et l'autre sur celui d'Angoulème pour Brantôme sur le diocèse de Périgueux avec un clocher limousin monté sur gâbles et plan romboïdal originaire du Quercy nous précise Viollet-le-Duc, ), soit Saint-Amant-de-Boixe cousine avec les dates de constructions de Saint-Laurent-des-Combes puisque les auteurs et les notices les donnent entre XI° et XII° siècles. Saint-Amant-de-Boixe donné pour un roman angoumois a eu son chevet reconstruit au XVI° siècle. Apparemment ces deux églises romanes n'ont pas grand chose en commun d'un point de vue esthétique, si ce n'est qu'elles on été principalement construites sur la période romane avec des réparations entre XV° et XV° siècles, voire XIX° siècle par Abadie à Brantôme.
Compte tenu de ces informations imprimées, je vais conduire mon étude par les strictes données archéologiques relevées sur les sites, comme pour les autres monuments étudiés sur ce blog. En effet le document fourni par l'abbaye de Brantôme sera ici celui de référence. Il s'intitule :
"Brantôme
A.H.
O.B;
O.B. recueil de la fondation et suite de l'histoire
de l'abbaye de Brantôme.
Bibl. du Roi, résidu de Saint-Germain, cart.179
Lettre adressée à Dom Robert Quatremaire
religieux bénédictin de St Germain des Prés, par Gerard Frinet
Le folio 182 r° nous donne l'information suivante... [...]...Les revenus du monastère doivent
avoir été assez amples, comme on peut le colliger de la grande quantité de bénéfices qui en dépendent, car outre les offices de prieur claustral, d'aumonier et sacristain, il y a quatre prevostés qui en dépendent, la prevosté de Perduceys, la prévosté de Puychambaud, celle de Pruniere et celle de la chapelle Montmoreau. Il y a des prieurés qui en dépendent dans divers diocèses..[...]...
Dans le diocèse de Xaintes, le prieuré de Saint-Laurent-des-Combes, de Saint-Georges-de- Périgni proche de La Rochelle."
Les autres diocèses cités par le document sont ceux de Périgueux, de Bourdeaux, de Limoges, de Sarlat et de Rhodès. Suivent les noms des supérieurs depuis la Réforme de Chesal Benoist, D. Joannes des Busson, en l'an 1541, D. Gervasieus Perier en 1543.
Le premier lien auquel on pense entre Brantôme et Saint-Laurent-des-Combes c'est celui de la voie fluviale par la Dronne qui a son confluent avec la Tude au Sud-Charente à la jonction entre les diocèses de Saintes et de Périgueux. Mais une voie terrestre plus courte passe par Montignac-le-Coq qui est aussi une route de pèlerinage à Saint-Jacques, comme nous l'avons vu avec cette église précédemment ici étudiée.
Ces deux églises de Montignac-le-Coq et de Saint-Laurent-des-combes, ont, comme nous allons le découvrir, des architectures romanes très différentes sauf une organisation en nef unique sans transept-avant-chœur/clocher et chœur, et surtout leurs escaliers en vis - accessibles au bout d'une très courte travée droite dont le départ se situé à 6 m au dessus du sol de la nef à Saint-Laurent-de-Combes - qui se divisent pour servir le clocher et un espace sur nef mais ces espaces sur nefs sont tous les deux disparus; reste l'accès et une ouverture d'ébrasement murée pour l'une et fermée par un abat-son (moderne) pour l'autre. Ces escaliers en vis démarrent aussi très haut dans la nef et non pas dans l'avant-chœur. Ces deux églises auraient eu à l'époque de leurs constructions soit une nef prévue voûtée soit voûtée, mais dans les deux cas les voûtes sont détruites.
L'Escalier
Cette première réflexion sur les liens en recherches architecturales communes à ce groupe d'églises ici sélectionnées sur cette page, s'enrichit et rétablit un lien avec l'exemple de deux noyaux pour trois marches déjà exposé à Chenaud, et ses conséquences sur l'évolution des escaliers en vis de l'architecture civile de la fin du XV° siècle. L'escalier de Saint-Laurent-des-Combes s'enrichit d'un véritable palier [qui est l'accès à une pièce contrairement au repos , deux termes précis du vocabulaire de l'architecture que les architectes modernes emploient indifféremment, tant et si bien que parfois on ne sait plus de quoi ils parlent et par voie de conséquences ce qu'ils vont vous bâtir. Voir les grilles du vocabulaire de l'architecture du CESR de Tours ou tous les vocabulaires de l'architecture sérieux dont celui de J.M. Pérouse de Montclos mais encore le dictionnaire d'archéologie Larousse], et perfectionne la solution au même problème de l'escalier de Montignac-le-Coq au service d'un espace intermédiaire entre la fin de la vis et son articulation à une travée droite
En fait, les solutions seraient les mêmes si en lieu et place nous avions en fin de vis à Chenaud un accès direct à une pièce et un départ de volée droite en angle droit. Toutefois l'émancipation du système à Saint-Laurent-des-Combes fait appel à deux noyaux distincts de part et d'autre de l'arrivée de la volée tournante de la vis, et décalés de 30 cm en profondeur pour faire redémarrer une volée droite à partir de trois degrés tournants. Encore un témoignage que l'art roman, pour des solutions techniques très voisines, peut inventer et s'adapter sans trahir sa famille architecturale.
Tout comme à Montignac-le-Coq le clocher est ici architecturalement conçu comme une tour à deux niveaux de distributions, mais a accès en entrée encore plus haute dans l'élévation du mur porteur que dans les exemples précédents des églises du bassin de la Tude, étudiées sur ce blog.
Dès lors nous voyons que lorsque la tour de clocher se structure et se confond avec une architecture composée à partir d'une mutation de la dernière travée de la nef en avant-choeur, ou reprend partiellement la structure d'héritage carolingien vue à Poullignac, que l'art roman approche sa première constitution achevée suivant les principes de la Scholastique analysés par E. Panofsky. Composée mais aussi isolée du chœur et de la nef en avant-chœur en souche [en thème évolué de La Genétouze] et décomposée en séquences principales d'un escalier en vis relayé par une volée droite qui achève la montée dans le comble par-dessus une voûte en berceau [La Genétouze, et "phase deux" de Chenaud] ou la coupole, avec une cage d'escalier invisible et parfois néanmoins spectaculaire comme à Rioux-Martin où la tour de cloche/avant-choeur est récupérée pour moitié comme tour ou cage d'escalier, ou visible mais intégrée dans des contreforts d'angles comme à Pillac, ou ressortis en tour d'escalier hors-oeuvre comme à Chenaud. A Saint-Laurent-des-Combes, tout comme à Montignac-le-Coq, nous franchissons une étape d'un clocher avec son escalier conçu pour deux niveaux d'accès à des espaces en combles et alternés (le surcroît de la nef et le comble du clocher). Nous avançons vers les cages en oeuvre puis tours d'escaliers hors oeuvre de l'architecture civile du XV° siècle qui distribueront en façade et de fond en comble deux pièces décalées par étages avant que l'aboutissement de la réflexion des volées divisées par des paliers totalement plats rétablisse des niveaux équivalents de part et d'autre de la vis (sur ce blog voir Les petits châteaux de la Creuse - septembre 2011).
La réapparition des escaliers rampe sur rampe à la Renaissance en France (1495) apportera des solutions différentes. Ces escaliers réintroduits dans l'architecture française ne fermeront toutefois pas la réflexion à cette dynamique sur l'équilibre des niveaux à partir d'un déroulement régulier de vis, engagée depuis l'art roman, puisque c'est en jouant sur les paliers alternés ou pas avec les repos des escaliers rampe sur rampe que les pièces d'étage en étage offriront un nouvel espace intérieur à la demeure, au bâti de façon plus générale (voir sur ce blog : château de Varaignes, mars 2020, Périgord Nord-Est Charente), dont les distributions en enfilades de salons que nous avons cependant vu apparaître au château de Curac (bassin de La Tude, sur ce blog octobre 2019) avec une enfilade de pièces d'apparats et de justice et logements également chauffés dans au moins une tour, en architecture gothique, et indépendantes des escaliers que je n'ai pas pu retrouver - excepté la rampe d'accès extérieure à la première aula - dans l'étude archéologique du bâti des vestiges de ce château des comtes d'Angoulême.

Maintenant que nous avons la réflexion en plan et la filiation entre Chenaud, Montignac-le-Coq et Saint-Laurent-des-Combes, nous allons carrément abandonner Chenaud.
Nous allons ainsi glisser vers l'originalité de Montignac-le-Coq dont l'architecture est en fait aboutie à Saint-Laurent-des-Combes par un bâtiment cette fois-ci globalement pensé et totalement construit ex nihilo, contrairement à Montignac-le-Coq. C'est cette performance de son escalier pour l'époque, sur un aussi petit bâtiment mais très soigné et original, perdu dans les marécages aux creux de mouvements de terrains puissants et de pénétrations chaotiques, invisible tant de l'extérieur que
de l'intérieur, que nous allons rendre visible. Réalisation du bassin de la Tude en ses bordures entre Angoumois et Saintonge, vraisemblablement postérieure pour le projet de seulement une génération à l'église Saint-Cybard à Porcheresse qui est, suivant les auteurs, la première souche en tour d'avant-choeur continuée en tour de clocher, donc ayant fusionnées, mais sans escalier de service. Même si le territoire que j'explore est relativement réduit on constate, si les influences peuvent se côtoyer, comme avec les exemples de Pillac et de Montignac-le-Coq, qu'elle ne s'installent pas forcément par proximités géographiques mais par d'autres vecteurs, et en ce sens ce qui s'est construit vers la fin du XII° siècle autour de la Haute-Lande en est une convaincante illustration, après investigations en archéologie du bâti (reste l'église de Médillac à étudier mais avec un environnement qui ne peut lui être dissocié et qui s'inscrit cependant dans le secteur de la Haute-Lande).

Cette triple figure nous apporte seulement des compléments d'informations importants sur la conception de l'insertion des escaliers en vis dans les organes de liaison entre le mur gouttereau et une des piles de l'avant-choeur lorsque ce dernier est constitué en tour de clocher de fond. Mais elle ouvre aussi vers la recherche des valeurs murales ressources, dans le bâti. Et cette recherche sera aussi celle de la rencontre des murs de refend et de façade au XV° siècle.
(Remarque sur l'icône : le mur épais de 1,35 m ne monte pas en mur plein jusqu'au 2° niveau du Comble, contrairement à ce que ma coupe pourrait laisser croire. Sur son premier niveau ce mur d'élévation du clocher est allégé par des jeux d'arcades dont les colonnes des arcs reprennent cependant l'essentiel de l'épaisseur du mur de fond. Cet autre aspect du clocher, pour des questions de méthodes d'étude sera traité à part et donnera lieu à d'autres icônes complémentaires qui préciseront celle-ci, dont celle de la place exacte de l'escalier dans l'élévation globale de l'église qui sera également précisée).
Déjà, nous comprenons l'épaisseur plus importante du mur gouttereau au Nord qu'au Sud (voir le synoptique - 1m au Sud et 1,35m au Nord) puisque c'est ici que l'escalier est inséré. Mais à Saint-Laurent-des-Combes l'escalier en vis n'a pas de marche portant noyau avant celles du couvrement de la volée tournante. Donc la solidité et la cohérence de l'empilement tournant des marches ne provient pas du noyau mais de la cage d'escalier, le noyau n'étant pour les degrés de la montée que le guide interne pour la verticalité de l'ensemble. C'est donc la raison principale pour laquelle nous pouvons voir - comme à La Genétouze où cependant les marches portent les noyaux - que le mur qui recevra l'escalier en vis sera plus épais même si l'évolution va vers des prises de conscience que c'est l'empilement des marches portant noyaux qui est la structure de l'escalier et que la cage peut progressivement se réduire à une simple enveloppe de 15 à 20 cm de large à partir du XV° siècle, comme déjà exposé avec l'église de Chenaud sur cette même page. Les habitudes de métiers ne changent pas si facilement et La Genétouze en apporte son témoignage par un escalier de clocher, en vis et droit terminé par une courte volée droite d'accès à l'extrados de la voûte en berceau, à l'entrée plus basse dans le mur Nord mais toujours après un court passage plat: toutefois à La Genétouze la travée sous clocher en avant du chœur ne constitue pas une tour de clocher-avant-chœur de fond, structurellement constituée.
Toujours dans le cadre d'un paragraphe en épilogue d'étude par la présentation de l'église de Saint-Laurent-des-Combes, si nous faisons un retour sur la question posée à Pillac et à Montignac-le-Coq nous nous rendons compte que ce sont bien les solutions apportées à ce problème qui font l'originalité de l'un et de l'autre des choix architecturaux, et finalement donnent une réponse aux statistiques posées en début d'article sur les potentialités des contreforts obliques en angles des églises romanes, de la région et d'ailleurs.
On peut donc dire que Saint-Laurent-des-Combes est bien l'outil qui nous manquait sur cette page, pour achever de comprendre le passage en oeuvre au hors oeuvre des escaliers en vis à la période romane. Au XV° siècle, en architecture civile, ce sera un gain d'espace dans les vis - dont les marches portant noyau qui passeront de 0,48 m jusqu'aux alentours de 2 m et plus à La Rochefoucauld, avec des délardements très poussés jusqu'à l'obtention de plafonds plats d'escaliers; ce qui fera que le site de la cage d'escalier sera agrandi par un ressorti hors oeuvre en tour à la jonction du mur de refend et de la façade, site de l'escalier en vis de fond en comble.
A Saint-Laurent-des-Combes, tout comme à Saint-Amant-de-Montmoreau, sans que la volée inférieure soit continuée par une seconde volée montante de recouvrement, les contre-marches de couvrements ne sont pas délardées, tant en couvrement de volées tournantes que de volées droites.
La grande invention ce serait donc de tailler dans le même bloc la marche gironnée et le noyau, vers l'allègement complet des valeurs murales des cages qui pourront se percher sans crainte en encorbellement, en angle entrant ou saillant [voir cette question traitée sur ce blog : Allemans en Périgord - Manoir du Lau , septembre 2018, également La tour, un mode architectural français pour la guerre et pour la paix, décembre 2020] pour peu que le noyau ait une assise solide dans le gros oeuvre et qu'un quart ( en principe) de la rotation soit maintenue par un engagement en oeuvre, en fait comme pour les colonnes adossées. Et chose curieuse à Saint-Laurent-des-Combes les grosses colonnes de supports des arcs de la nef sont en délits, peu ou prou projetées en avant de massifs dosserets carrés, non articulés. Et, sans être soutenue par un engagement sur le dosseret, ça tient. Sauf pour l'arc qui soutient une part de l'escalier dans le pendentif Nord-Ouest de la coupole, qui a dû être doublé d'un arc plus épais de restauration, comme à Saint-amant-de-Montmoreau (bassin de la Tude, sur ce blog publié en Juillet 2021); ce qui est absolument le parti contraire de Montignac-le-Coq avec ses piles massivement articulées de colonnes solidaires aux trois quarts, créant un plan très dense trilobé et même quadrilobé, pour une solution voisine de son escalier de clocher.
Nous voyons ici que ces aspects techniques ne sont pas sans importance et qu'ils concernent même la question du transept posée par les auteurs qui n'avaient pas les clés pour comprendre ces mécanismes. Et surtout pas cette dernière remarque sur le premier noyau qui n'est pas un organe de support structurel de l'escalier mais un simple outil d'alignement vertical des marches comme le précise la coupe extraite de la planche des coupes et qui sera également reprise sur la planche du synoptiques (deux planches plus bas dans le texte), par laquelle nous voyons que le noyau ne prend appui sur aucun mur mais seulement sur la verticale de la colonne de l'angle Nord-Ouest de l'avant-chœur. En revanche ce noyau est maçonné avec la partie murale qui repose sur le départ du dosseret de transition avec le mur gouttereau Nord. Les équilibres sont toutefois maintenus.

Cette colonne construite en délit accuse des affaissements que traduisent des ondulations de la verticalité de son fût. Ces affaissements sont simplement le résultat du surpoids qu'elle porte une charge complémentaire - des arcs et du pendentif supports de la coupole - qui est celle du noyau de la vis qui ressort à la verticale du centre du premier niveau de la cage d'escalier. Une part de la rotation de la vis étant elle-même construite dans la demi cage d'escalier sur pendentif.
Mais dès que nous avons franchi la volée tournante en vis le système des marches portant noyau reprend sa place, entièrement ou partiellement, dans l'édification de l'escalier. C'est bien qu'il y a là une raison à cette succession des manières de construire.
Peut-on essayer de la comprendre ?
Ce gros noyau prend appui sur la verticale de la colonne de l'angle Nord-Ouest de l'avant-choeur : un accès à l'escalier par travée droite suivi d'un accès direct à la première marche de l'enroulement de la vis - juchée sur une marche du passage droit - projette l'escalier dans l'épaisseur de la pile d'articulation de la nef et de l'avant-choeur. Un tiers (le plan de la volée tournante n'occupe que trois quarts du plan total) de la montée tournante de l'escalier se trouve en grande partie construite dans l'épaisseur du pendentif de la coupole de l'avant-chœur.
Ce système pourrait avoir une parenté - sinon identique - avec la construction en encorbellement en angles rentrants des tours en surcroît et en encorbellement des tours d'escaliers en vis des constructions civiles du XV° siècle, comme ci dessous analysées pour le manoir du Lau à Allemans-en-Périgord (Sur ce blog mois de septembre 2018)
 |
Nous voyons que le principe est bien le même d'un logement dans l'angle rentrant de deux murs adjacents. Sauf qu'au manoir du Lau le noyau de la vis prend appui sur la bordure du mur montant de la tour d'escalier de la grande vis, alors qu'en l'église de Saint-Laurent-des-Combes le noyau se trouve déporté à la verticale de la colonne de l'angle rentrant de l'avant- chœur, comme le montrent les icônes ci-dessous. A moins qu'un culot intermédiaire fasse console entre le chapiteau de la tour et la rotation de l'escalier débordante dans le pendentif (voir plus bas le relevé de la maison-tour d'Yviers). Sur un système d'angle sortant, comme à la maison tour de La Chaise ou à celle de Varaignes, le noyau prend appui sur l'angle saillant des deux murs de la tour et la cage d'escalier n'ayant que très peu de fonction porteuse s'élève simplement sur un culot d'encorbellement. L'épaisseur du mur peut donc se réduire comme en la tour d'escalier romane de Chenaud. Ces expériences romanes sont celles, une fois de plus, qui vont servir l'architecture civile du XV° siècle. C'est ce système qui se met progressivement en place dans le pendentif de Saint-Laurent-des-Combes et qui justifie la recherche de puissance articulée des piles de Montignac-le-Coq. |
Puisque le noyau n'a pas de fonction porteuse, il est allégé d'autant du poids des marches bien que sa section soit plus importante que celle des autres noyaux portant des marches , et nous comprenons donc pourquoi le poids des marches est ramené dans l'appareillage stéréotomique régulier de la cage d'escalier jusqu'à un couvrement plat d'une marche très élargie mais qui ne sera pas encore utilisée en marche palier comme le montre le montage de trois marches pour deux noyaux retrouvé en modèle à Chenaud. En revanche je dois ici introduire dans le débat l'exemple de l'église de Rioux-Martin où une marche plate élargie fait repos ( et non pas en palier) entre la fin de l'escalier en vis et le départ décalé de la volée droite d'accès au comble du clocher.
Donc, l'a montée de l'escalier ne repart pas sur cette couverture plate mais sur un plan décalé en sens inverse entre un mur relais de la bordure de la cage d'escalier et une autre maçonnerie dans l'élévation de la pile d'articulation de la nef et de l'avant-coeur jusqu'à former le mur d'un premier niveau du clocher : à ce stade le plan médian intérieur du clocher ne varie par d'Est-en Ouest ( 5,25 m en comble pour 5,54 en avant-choeur avec une valeur ajoutée de 0,29 m de différence entre l'arc et l'arc doubleau qui supporte la totalité de l'élévation en comble) alors qu'il en est tout autrement du Nord au Sud. (7,31 m en avant-choeur pour 5,73 en premier niveau du comble - voire icône d'étude plus bas dans la page). Je précise "plan médian" car nous allons découvrir, avec l'étude du clocher, un plan très particulier qui est très vraisemblablement la conséquence de cette combinaison d'un escalier haut perché dans l'angle de deux murs qui n'ont pas comme fonction de loger et d'articuler un pendentif et l'insertion par dessus, ou plus exactement en bordure et au dessus d'une unique colonne d'angle en étais. Une recherche chez Viollet-le-Duc pourra également permettre d'apporter un autre regard pas plus décisif, toutefois complémentaire et précieux.

La volée droite de passage du niveau du comble de la nef à celui du clocher, n'ayant à peu près qu'un peu plus de la moitié de la hauteur de l'échappée de la volée en vis, les bâtisseurs, également soucieux de continuer d'alléger le poids des marches de la vis sur son noyau, ont détourné la rotation sur la partie murale de montée au mur du clocher. En fait il y a là également la conservation des séquences de constructions des escaliers romans du bassin de la Tude depuis que j'en expose les principes sur ce blog : un accès en hauteur et une entrée par une travée droite, plate (à Saint-Laurent-des-Combes cette base plate de la travée est toutefois articulée par une marche), un escalier en vis ne dépassant pas deux rotations ( A St-Laurent-des-Combes. un trois quart de rotation) et en fin de séquence une volée droite d'accès au clocher comme à La Genétouze, à Chenaud et à Montignac-le-Coq, mais qui peut toutefois comporter une courbe dans sa trajectoire : au départ de la volée droite comme à Saint-Laurent-des-Combes, au milieu de la volée droite comme à Pillac, ou en fin de volée droite comme à Rioux-Martin, ou rampe sur rampe comme à Saint-Amant-de-Montmoreau.

INSERTION
de l'Escalier dans le bâti
(schéma)
Cette construction entièrement appareillée est beaucoup plus élaborée qu'à Montignac le Coq mais il est délicat d'en avancer une quelconque raison (lorsque l'accès pour relevés d'études sera possible à Montignac-le-Coq nous aurons sans doute d'autres résultats).
Ce qui est certain c'est que le programme architectural extérieur de l'élévation du clocher de Saint-Laurent-des-Combes est beaucoup plus travaillé qu'à Montignac-le-Coq qui demeure toutefois très important pour la recherche sur la progression de la réflexion médiévale en matière d'architecture puisque nous constatons une fois de plus que c'est l'architecture religieuse qui est le moteur et le laboratoire des recherches qui se répercuteront ensuite dans l'architecture civile et militaire des siècles suivants.
Alors qu'à La Chaise l'escalier en vis est en encorbellement hors oeuvre avec accès par un passage qui établit lui aussi le lien entre l'intérieur et l'extérieur, toujours avec accès dans un passage plat : A Montignac-le-Coq tout comme à Saint-Laurent-des-Combes, le passage ne sert qu'un seul accès au premier niveau d'entrée dans la cage d'escalier.
 |
| Sur ce blog : décembre 2020 |
En restant et en revenant sur les églises du bassin de la Tude et lisières : certes des escaliers en vis seront logés dans les piles d'articulation du chœur et du transept (en hauteur à Bellon, de fond à Conzac, à Nonac) - voire avec des accès hauts ou au-dessus des passages intra-muros entre le bras du transept et le départ du chœur (Pérignac), voire avec des accès très haut perchés par-dessus la corniche d'un départ de transept voûté (Saint-Quentin) ou par-dessus la corniche de la voûte en berceau continu de la nef unique (Médillac) - mais aucun n'auront de pile carrée articulée en angle droit avec un support de noyau sur une colonne en délit dans l'angle (pour le moins aucun autre exemple n'a encore été identifié et personnellement je n'en suis qu'au début de ma recherche. Mais parenté avec des solutions de l'église du XIII° siècle à Brantôme peuvent être étudiées, pour le moins approchées ). A moins bien sûr que l'exemple de Saint-Laurent-des-Combes fasse partie d'une famille en proto-organisation des futures piles articulées avec colonnes ou demi-colonnes, voire quart de colonnes, engagées dans le dosseret comme nous le voyons par le premier projet architectural de Bors-de-Montmoreau, avant sa transformation en chapelle de route (sur ce blog octobre 2022), sur lequel nous reviendrons pour ses chapiteaux de la famille de ceux de Saint-Laurent-des-Combes, sur la route qui conduit par Montmoreau à Montignac-le-Coq et Brantôme, à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Pour cette dernière question d'un transept prévu, construit, détruit, nous avons un argument supplémentaire qui conforte celui des colonnes en délit en avant des dosserets.
Ce sont les valeurs ornementales des murs Nord et Sud de l'avant-choeur qui nous disent encore "stop", non jamais de projet ni de construction de transept. Et cet aspect architectural est encore une voie qui nous ramène vers l'indépendance architecturale des églises bénédictines en comparaison des églises à larges transepts débordants et absorbant les chevets qui sera pour une bonne part celle de l'évolution de l'architecture cistercienne, au cœur des défrichements et de la constitution de nouveaux domaines (agricoles) à la même époque.
Les valeurs ornementales
Détails photographiés des peintures
Le mur Sud en vis-à-vis du mur Nord de l'Avant-Choeur.

La Vierge au Rosaire est une ronde-bosse sur console, en vis-à-vis mais plus grande et plus élancée que le Jésus du Sacré-Coeur qui lui regarde les fidèles contrairement à la Vierge qui regarde le ciel.
Quand on voit la place laissée pour un transept, soit 3 , 50 m entre les piles carrées qui devront nécessairement faire ressaut dans l'espace de l'entrée du transept- sans même évoquer les maçonneries du bas du mur - il ne semble pas très opportun d'en dire plus : il n'y a jamais eu de transept.Nous sommes donc bien dans le cadre d'une église à nef unique sans transept.
Les murs sud et nord ont été peints très tôt. Les vestiges que j'ai dessinés sont ceux qui apparaissent actuellement sous les enduits qui commencent à se dégrader, dont la couche de peinture bleue ajoutée très tardivement sur tous les murs intérieurs de l'église (XIX° s. ?).
En collaboration de la photographie et des dessins de relevés j'ai replacé les quelques figures qui sont actuellement identifiables. Compte tenu de la lecture que nous pouvons en faire peut-on s'orienter vers une évocation de l'Epiphanie ?
Icône
Les coloris majoritairement ocrés pourraient faire penser à une iconographie du XV° siècle. Toutefois l'emploi des petites figures aux tracés élégants qui semblent avoir été composées en accumulations rythmés par des courbes, n'est pas sans évoquer les fragments de la peinture murale en couche superficielle - hélas également fort détruite mais ayant gardé des couleurs - du mur Sud de l'avant- choeur de Saint-Amant-de- Montmoreau

Travailler sur des peintures dans cet état lacunaire de conservation ou de dégagement, comporte de nombreux risques. Toutefois nous comprenons que nous nous éloignons des grandes figures et des rigueurs de l'art roman pour entrer dans un monde de la courbe et de l'élégance qui vient se confondre avec les organisations des tableaux. Aussi nous pouvons voir des accumulations de petits personnages qui sont, suivant certains auteurs, caractéristiques du XIII° siècle. Pour rester prudent je donne tout de même cet extrait qui me semble tout juste pertinent et articulable avec les développements qui seront donnés de la peinture gothique française par les auteurs, dès ses premières mutations vers ses influences internationales "Dès que l'école des miniaturistes parisiens se consolide autour de la royauté resplendissante de Saint-Louis (1214-1270), cette esthétique tournée vers la vie donne des fruits merveilleux, Le Psautier de Saint-Louis vers 1256, ou la Somme du Roi montrent un style nouveau et complet...Le dessin ne vise pas la seule beauté calligraphique par l'agrément et la cadence de son parcours; mais souple aigu, il précise la forme dans ce qu'elle a d'essentiel, ne l'alourdit ni ne la complique jamais. Ce trait choisi qui coule sans effort et s'arrête au point juste, sera l'apanage de la peinture française".[Cf. Charles Sterling, La peinture française- Les Primitifs. Paris 1938, p.14]. La référence au programme sculpté de Saint-Laurent-des-Combes peut nuancer ces sources directes aux enluminures disponibles au XIII°s.
Pour la sculpture l'influence des manuscrits ne semble pas réellement en décalage, et même plus précoce depuis la première moitié du XII° siècle au moins, puisque c'est à ces entrelacs et arabesques que certains auteurs comme Philippe Wolf font références [Paris, 1971, op.cit., p.46] : " La célèbre bible offerte à Charles le Chauve reste un des plus beaux exemples de l'art du livre tel qu'on sut le pratiquer à Tours au IX° siècle. Mais on connaît encore une trentaine de bibles sorties de cet atelier.[...] Déjà se manifeste ici, autour du Dieu révélé, la ferveur qui animera les constructeurs d'églises , tandis que les miniatures constituent comme une anthologie dans laquelle puisera l'inspiration des sculpteurs de tympans et de chapiteaux".
Ce sont ces deux tendances de la peinture et de la sculpture, plus orientées sur les arabesques et les volutes en compositions des figures que sur les entrelacs, que nous retrouvons à Saint-Laurent-des-Combes dès la première moitié du XII° siècle pour la sculpture - tout comme à Bors-de-Montmoreau, du diocèse de Saintes à celui de Périgueux - qu'au XIII° siècle en hypothèse pour la peinture. Bien que les repères en sources et styles soient relativement proches.
SUITE DE L'ETUDE DES VALEURS ORNEMENTALES :
LE PROGRAMME SCULPTE DE SAINT-LAURENT-DES-COMBES
La sculpture romane dans les églises du Sud Charente échappe souvent à l'intérêt des rédacteurs sauf pour les façades de Montmoreau, de Chalais et d'Aubeterre.
La frise ornementale romane y est pourtant bien représentée dans des versions très différentes pour des églises pourtant parfois proches comme autour de la Haute-Lande, de Rioux-Martin à Médillac, et répertoires très abondants à Brantôme. Les autres églises sont plus avares en programmes sculptés; la pierre locale s'y prête mal. Cependant...
Avec Saint-Laurent-des-Combes le changement est radical même si nous pouvons regretter la disparition d'une très grande partie de son programme sculpté. Ce serait cependant une grave erreur d'en abandonner l'étude rien qu'à l'examen des deux groupes qui encadrent l'extérieur du portail Ouest. Ils sont là en réemplois qui nous conservent - sous notre nez si je puis m'exprimer ainsi - une des plus belles prouesses des sculpteurs romans en Charente.
Certes Bors-de-Montmoreau nous avait alerté sur la qualité de cette production et personne n'ôse trop s'aventurer sur le programme de Montmoreau après les interventions d'Abadie au XIX° siècle.
A Saint-Laurent-des-Combes nous avons encore quelques modèles de vocabulaires in situ, mais décisifs. Et c'est une grande surprise de regarder un art roman monumental qui a autant fouillé la pierre dans de petits formats sur trois, voire probablement quatre, niveaux de profondeurs où, dans cet espace sculpté ainsi crée, se superposent lianes, s'agitent figures entières et membres superposés d'animaux et d'humains, figures souvent de fantaisie à vocation certainement plus ornementale que théologique (ce qui différencie principalement le programme de Bors-de-Montmoreau de celui de Saint-Laurent des combes, au moins pour les chapiteaux) en tout cas des programmes très décoratifs et pittoresques tant dans les thèmes que dans les expressions avec des volutes et des méandres qui réclament leurs sources aux entrelacs qui se sont assouplis et qui donneront plus tard ces putti en balançoires dans les guirlandes de fleurs et de fruits de la Renaissance. Cette prouesse de la sculpture en mouvement de surfaces et de profondeurs, sortie et mise en relief des rinceaux des enluminures des manuscrits, n'est que rarement dépassée ( A Bors-de-Montmoreau la sculpture est plus nerveuse mais les niveaux de fouille de la pierre sont moins profonds pour des appels à des répertoires de même registre et les tailloirs sont également lisses profilés en cavets) et le Jubé de la basilique Sainte-Cécile à Albi fait, au XVI° siècle, exemple d'exception avec quatre niveaux de profondeurs.
La règle de saint Benoit imposait aux moines deux heures de lecture quotidienne. Et que lisait t-on dans les bibliothèques des monastères : des manuscrits enluminés aux catalogues historiques archivés par les mêmes centres producteurs de la peinture médiévale en France.
Qu'y a t-il alors d'étonnant à ce que le programme peint à Saint-Laurent des Combes rejoigne celui de son programme sculpté.
Ce programme sculpté de l'église Saint-Laurent, de la première moitié du XII° siècle, ce qui en reste et qui parvient jusqu'à nous, mérite donc toute notre attention.
Bien sûr les oeuvres sculptées des copistes et des restaurateurs nous aurons conservées les grandes lignes des constructions et des figures mais d'autres sont encore intactes et les uns complétant les autres nous pouvons avoir actuellement une belle galerie à "dépercher des colonnes et des corniches" pour la mettre à la portée de nos regards curieux sinon émerveillés.
LECTURES DES PROGRAMMES SCULPTES
1 - les sculptures romanes en réemplois de part et d'autre du portail occidental
1a : le groupe Nord.
1 b : le groupe Sud
Ici il faut ouvrir la recherche au-delà de Bors de Montmoreau sur un axe de circulation qio appartient toujours à l'ancien diocèse de Périgueux, avec le programme sculpté de l'église romane Saint-Cybard à Blanzaguet, magnifique église, très haute pour une petite église, dans la quasi totale conservation de son architecture d'origine toutefois restaurée me précise madame la Maire, Madame Nathalie Selin, que je remercie pour son accueil.Le portail Ouest par les chapiteaux des colonnes de son ébrasement est un véritable témoin de plusieurs tendances majeures des sculptures de la région comme le montre l'icône ci-dessous qui rejoint Saint-Laurent des Combes par son chapiteau 2 et une bonne part des répertoires de Bors-de-Montmoreau mais aussi de Poullignac, Rioux Martin et autres églises du bassin de la Tude et périphéries, par ses deux autres chapiteaux
Le chapiteau N°2, vous l'avez compris, retient sout de suite notre attention par la très grande parenté de sa sculpture très fouillée sur plusieurs niveaux de profondeurs, ses grandes ailes qui sont ici celles d'oiseaux aux longs cous, des deux sculptures que j'ai dessinées in situ pour plus de netteté sur l'icône présentant, associé, le portail de Saint-Laurent des Combes.
En face Sud on lit clairement deux grands volatiles échassiers qui sont plastiquement mis en relation par leurs cous et leurs becs qui viennent se confondre, voire piqueter, le plumage de l'aile de l'autre. Dans cette limite de l'iconogoraphie ce chapiteau peut faire penser à une corbeille sculptée de l'abbaye de Maillesais en Vendée. La sculpture du Poitou et de la Vendée sont riches en thèmes de l'ornithologie. Leurs longues pattes de la sculpture de Blanzaguet s'accrochent par leurs ergots à une sorte de proie "déjà tuée" que les deux oiseaux de la même famille "pourraient se disputer", si l'enjeu de cette iconographique était celle d'un combat pour la récupération de la même proie. La sculpture de Blanzaguet est en bon état; soit qu'elle a bénéficié de conditions d'abris particuliers soit qu'elle a été très bien restaurée; elle nous conserve une valeur documentaire iconographique que nous ne pouvons pas mettre en doute.
Le plus intéressant pour une identification ou une attribution à un atelier ou a un artiste c'est ce jeu des réseaux entremêlés avec ces longs coups qui structurent la composition et en achèvent le caractère "issus" des entrelacs - pourrait-on prétendre - où l'animal sous les oiseaux, sorte de lézard ou de reptile, qui se défend de l'agression des oiseaux. Ce long reptile semble encore bien vivant par sa représentation dynamique.
Nous ne serions ici pas très loin d'une parabole des êtres inférieurs et supérieurs, mais pas par le combat des espèces car cela n'est guère possible bien que dans l'iconographie chrétienne les oiseaux appartiennent à un des genres inférieurs des créatures de Dieu. C'est pour le moins ce que nous laisse entendre la parabole de Saint-François prêchant aux oiseaux par la peinture de Giotto à Assise. Mais c'est bien plus un message de l'amour universel de Dieu qui y est délivré plus qu'une scène carnassière dominée par les oiseaux... Cette iconographie est plus simple dans son exécution mais plus complexe pour une interprétation symbolique, que le monde sauvage des onagres, des serpents et d'Adam et Eve à Saint-Laurent-des-Combes.
Le vocabulaire auquel nous pouvons faire appel pour décrire ces scènes est cependant tellement proche de celui utilisé pour la description des deux scènes romanes qui flanquent - en réemploi - le portail gothique de Saint-Laurent des Combes, que nous devons admettre que nous retrouvons ici les traces qui enrichissent la production d'un artiste ou d'un atelier dirigé par le même artiste ou des artistes de même formation, ce qui pose évidemment la question de la datation de ces sculptures qui renverraient le programme vers la première moitié du XII° siècle (ou à des relents d'héritages de métiers) alors que le chapiteau N°1 tirerait vers ou autour de 1200. La référence au corinthien en avatar déjà bien usé ne pouvant pas à lui seul trancher cette question
Suite du programme sculpté
Le reste du programme sculpté se réparti sur les chapiteaux intérieurs et extérieurs.
Ceux de l'intérieur ont été intentionnellement bûchés - sauf pour le chœur qui sera étudié à part - alors que ceux extérieurs ont été usés par les intempéries. Des chapiteaux extérieurs ont été retaillés suivant la commande des restaurations qui semblent ne s'être intéressées qu'à l'aspect ornemental. Mais à la décharge de ces restaurateurs nous allons voir que les programmes iconographiques sont essentiellement répétitifs et n'offrent pas, dans l'état où il peuvent être appréhendés, la même richesse de composition que les deux groupes de sculptures que nous venons d'analyser, quand bien même des figures y seraient empruntées.
Tout d'abord quelques remarques sur la structure de ces chapiteaux.
Nous venons d'évoquer le corinthien avec les chapiteau de Blanzaguet associés à ceux de Saint-Laurent-des-Combes et de Bors-de-Montmoreau.
De façon majoritaire c'est le modèle corinthien auquel il est fait appel, même aux sources du chapiteau dit "à collerettes". Cette "tradition" n'est pas une exclusivité romane mais remonte localement de l'antiquité tardive comme nous le voyons dans le bassin de La Tude avec la plus ancienne représentation connue à ce jour de La Véronique, par une corniche de sarcophage réemployée en ornement d'imposte dans l'église de Saint-Amant-de-Montmoreau (sur ce blog voir l'étude au mois d'avril 2021, précédée d'une étude de couvercle de sarcophage mérovingien);
[Pour un regard plus général sur l'évolution des figures humaines, animales et végétales dans les rinceaux, volutes et corbeilles depuis l'antiquité vers le monde roman dans le royaume de France et marches, qui peuvent compléter une réflexion sur les chapiteaux de Saint-Laurent-des-Combes et de Bors-de-Montmoreau, en plus de la bibliographie publiée sur la page de Bors-de-Montmoreau, on peut encore consulter : Pierre-Yves Le Pisé, Images de pierre - Le langage des sculpteurs romans - Essai d'un voyage dans l'invisible. Cahors 2010, p. 151, 152, 158 et ]
Ce qui nous intéresse avec ce calque c'est la récupération en frise symbolique à la tête d'un sarcophage de la guirlande qui est une recomposition linéaire, en liane, des réseaux ornementaux du chapiteau corinthien, détournés vers une représentation végétale unique de la vigne.L'art carolingien exploitera ces mêmes structures pour des entrelacs et l'art roman pour organiser les corbeilles entières des chapiteaux en variations humaines, animalières et (ou) végétales, composites ainsi que pour représenter des scènes de la Bible ou des textes apocryphes.
Les chapiteaux de Saint-Laurent-des-Combes s'inscrivent dans cette permanence et ces évolutions de l'emploi de ces références au chapiteau corinthien.
A ceci il faut ajouter que des figures fortes des deux compositions sont employées plusieurs fois en ornements de structures des chapiteaux, comme les onagres qui devaient avoir un sens très fort dans ces contrées isolées et sauvages, récemment défrichées et aménagées pour la création d'un établissement religieux de moines, monastère ou abbaye, antenne de Brantôme.
Les parties hautes de Saint-Laurent
Derrière les parapets en pierre - machicoulis - des donjons résidentiels et maisons-tours du XV° siècle, les étages en combles sont des constructions en pans de bois, à un ou deux, voire plus de niveaux
comme au dessus des deux étages de galeries du XVII° siècle, superposées à celle gothique du rez-de-chaussée, du château de Chalais (bassin de La Tude).
L'architecture/élévation intérieure du clocher
Bien que je commence mon étude de ce clocher par l'intérieur, en suite logique de l'escalier intra muros qui y conduit, je dois préciser que nous ne sommes pas loin de Blanzac qui a un clocher élevé en gables extérieurs qui est le schéma d'élévation du spectaculaire clocher de Brantôme.
En revenant sur la présentation de Brantôme par la publication de Jean Secret en 1962, nous trouvons bien sûr la référence à Viollet le Duc [Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonné de l'Architecture française du XI au XVI° siècle - Tome troisième - Illustré de354 gravures sur bois. Publie de 1854 à 1868. Nouvelle édition de 1997. Volume 1, p. 293 et suivantes.] : "Il existe, sur le flanc de l'abbatiale de Brantôme (Dordogne), non loin de Périgueux, un gros clocher bâti sur le roc qui longe cette église et sans communication avec elle. C'est une tour isolée... Le plan de ce clocher n'est pas un carré parfait, mais un parallélogramme, afin de laisser le mouvement libre aux cloches. Suivant un usage fort ancien qui appartient au Quercy, et que nous voyons encore adopté aujourd'hui tout entier construit en pierre de taille d'appareil...Postérieurement à la construction du clocher de Saint-Léonard on élève à Uzerches (Corrèze) un clocher porche qui conserve encore les caractères principaux du clocher de Brantôme...Préoccupés de l'idée de superposer, dans la constructions des clochers, des étages en retrait les uns des autres, les architectes limousins...Le clocher central normand, celui qui est posé à l'intersection des bras de croix, n'est pas seulement une tour s'élevant au-dessus des voûtes de l'église et portant sur les quatre piliers principaux ; ils contribuent également encore à l'effet intérieur du monument en laissant au dessus de la croisée une vaste lanterne". J'interromps ici ma lecture pour cibler le probable mécanisme que nous avons pu analyser à la chapelle de Cressac et son clocher-porche (en quelque sorte, peut-être sur le schéma de Bors-de-Montmoreau ou sur une idée élaborée à partir du type peu à peu mis en place par les chantiers successifs de cette "proto chapelle" récupérée sur les vestiges des piles sur plan carré d'une grande église prévue, si on me permet de m'exprimer ainsi) aux travées sur berceaux en avant du chœur de La Genétouze à la phase "2" de Chenaud : la coupole répondant à ce sens de l'élévation avant le chœur. En revenant vers Viollet-le-Duc (p.306) : " Nous nous occuperons d'abord de ces clochers centraux, qui paraissent avoir été adoptés en France, dans les provinces du Centre, de l'Est et en Normandie, vers le commencement du XI° siècle. Ainsi que nous l'avons dit, cette construction eut une influence sur la plupart de celles qui furent élevées, pendant les XI° et XII° siècles, dans le Périgord, la Saintonge, l'Angoumois et le Poitou". [Le plan rhomboïdal - soit carré aux côtés irréguliers, soit parallélogramme, est celui que les restaurateurs de la flèche de Notre-Dame de Paris, ont retrouvé", donc sur une architecture de Viollet-le-Duc]
Bien sûr nous n'allons pas imaginer une tour de cloche sur le modèle de Notre-Dame qui est de toute façon du XIX° siècle, ni une tour couverte en pierres appareillées, mais les élévations extérieures très ajourées sont visibles tout près de là à Pérignac (réouvertes par la belle restauration d'Edouard Warin), dans une moindre mesure à Médillac, pour des élévations en gâble à Blanzac toute aussi voisine, mais une architecture tout de même très particulière qui reprend, quoi que de façon discrète les plans carrés irréguliers et les retraites des murs autant intérieures qu'extérieures, sur une tour de cloches conçue de fond en fusion de l'avant-chœur aux vaste espaces qu'il faut aussi réduire pour en arriver à ce clocher qui conserve à la fois les proportions extérieures et les réductions intérieures des plans. Sur ce sujet à la fin de cette étude je proposerai un regard sur l'église de Challignac, tout près de Saint-Laurent-des-Combes. Mais à partir de là nous pourrions tout aussi bien revenir vers Villebois-Lavalette en l'église Saint-Cybard à Blanzaguet de l'ancien diocèse de Périgueux.
C'est ce mouvement architectural de réduction des espaces en plan déjà "disloqué" au dernier niveau et de renforcement/évidement des valeurs murales hautes que nous allons commencer à regarder depuis l'intérieur, en tenant compte de l'aménagement de l'escalier.
A Saint-Laurent-des-Combes c'est une vraie recherche, et une recherche savante qui aurait pu s'inscrire dans les développements de Viollet-le-Duc. Cette recherche entre dans celle des ressources au trompe l'œil roman - bien représentée à Passirac en bordure Ouest du bassin de La Tude - et c'est encore le modèle du pseudo-périptère antique qui est appelé pour le décor extérieur du premier étage du clocher de Saint-Laurent-des-Combes mais, comme une voie de conséquence, avec des ouvertures pour libérer le son des cloches, reportées dans le second étage du clocher (Il n'y a aucun béton dans ce clocher sauf peut-être dans la réparation de certains joints. Tout est appareillé, et pas n'importe comment ). A tel point que ce décor haut perché qui fait tout le tour du clocher avec seulement une interruption en façade - en fait comme pour un temple antique, très décoratif et même beau mais surtout insolite pour la perception actuelle du bâtiment - n'aurait t-il pas été un complément ou un écho du décor d'arcades plates de la façade détruite, voire du chevet ? Cet emploi récurrent des modèles antiques que nous retrouvons sur les fonts baptismaux et dont l'antiquité tardive avait fait usage dans les décors de mosaïques, comme vu avec les cuves présentées depuis Montignac-le-Coq jusqu'à Saint-Laurent-des-Combes, est certainement la source iconographique ornementale du clocher de Saint-Laurent-des-Combes. Son emploi en est toutefois complexe et astucieux.
Mais revenons d'abord vers l'analyse intérieure de cette élévation.
Pour bien clarifier cette question du clocher je vous propose ma méthode d'analyse qui nous ramène par ses relevés à l'article d'Eugène Viollet-le-Duc dont je viens de produire des extraits.
Il faut bien reconnaître que nous sommes en plein dans le sujet du tout premier archéologue du bâti de l'histoire de l'art/archéologie.
Eu égard à ce grand maître, ma méthode ne mériterait pas tant de précautions si l'assemblage des deux figures ne permettait pas de mettre à jour une utilisation très astucieuse de cette combinaison de plans qui, ne l'oublions pas, représente l'aboutissement d'un escalier de clocher qui nous a déjà livré beaucoup de surprises et de génie ou d'inventions architecturales dans une église où personne ne pouvait s'y attendre.
L'assemblage des figures
C'est le système d'élévation est une idée simplifiée de l'élévation du mur Nord de la tour ajourée pyramidale de l'abbatiale Saint-Pierre de Brantôme, utilisée en clocher. Sur un bas relief accroché sur le mur Nord du chœur de l'église nous voyons que cette église à son propre clocher juste à côté de cette tour monumentale avec de nombreuses références à l'art carolingien.








.jpg)















.JPG)




















.jpg)


















































5.jpg)
4.jpg)







7.jpg)